Mes articles sur AgoraVox 2013
Mes articles sur AgoraVox 2012
Mes articles sur AgoraVox 2011
Mes articles sur AgoraVox 2010
| Réponse à Régis Debray: Contre-éloge des frontières | 16 décémbre |
| Face à la réforme sarkozienne des retraites, la solidarité des générations s’impose! | le 12 janvier |
Mes articles sur AgoraVox 2008
| Au PS la démocratie se mord la queue |
08 décembre |
| Election fictive au PS et rassemblement |
02 décembre |
| PS: Elections, coups fourrés et pièges à cons |
24 novembre |
| Le capitalisme sauvage est mort, vive le capitalisme régulé! (?) |
17 octobre |
| De Descartes à Benoit XVI ou de l'impossibilité de concilier rationnellement foi et raison. |
15 septembre |
| De l'Alliance entre le PS et le MODEM |
07 septembre |
| De Bergson à Nicolas Sarkozy: de la place du religieux dans la cité |
25 avril |
| Ségolène Royal, la rénovation du PS et le MoDem |
07 Avril |
| La loi, c'est moi! |
25 février |
Histoire, devoir de mémoire et culte des martyrs |
18 février |
| Refusons tout enracinement politico-religieux |
31 janvier |
| Un Rocard, sinon rien... |
16 janvier |
| La direction du PS en plein pataquès |
10 janvier |
| De l’art maîtrisé par Nicolas Sarkozy de la triangulation en politique | 09 janvier |
| La politique civilisationnelle et l'argent-roi. |
02 janvier |
Mes articles sur AgoraVox 2007
| Un président du droit divin... |
27 décembre |
| Défendre
le système de retraite par répartition |
04 décembre |
| Le Conseil
Constitutionnel neutralise le test ADN |
16 novembre |
| Les tests ADN :
un test pour tester notre resistance démocratique |
18 octobre |
Mes articles sur AgoraVox 2006
| Chronique
d'un retour annoncé du TCE |
21 décembre |
|
| De la
fiction démocratique |
04 septembre |
|
| Libéralisme,
social-étatisme et hyper-capitalisme |
07 Juillet |
|
| Du
social-nationalisme |
22 juin |
|
| 20 juin |
| 29 mai | ||
| 28 avril | ||
| 5 avril | ||
| 3 avril | ||
| 31 mars | ||
| 20 mars | ||
| 10 mars | ||
| 8 mars | ||
| 21 février | ||
| 17 février | ||
| 14 février | ||
| 13 février | ||
| 8 février | ||
| 3 février | ||
| 2 février |
Liberté d'expression et islamophobie
La presse dans son ensemble s’élève contre le risque pour la liberté d’expression que ferait courir une interdiction de caricaturer Mahomet. Reste à savoir si ces caricatures ne font pas le jeu de l’intolérance et de l’incitation à la haine islamophobe.
À la première question, le
réponse ne peut être que positive.
Dans leur contenu comme dans leur forme, ces
caricatures présentent celui qui est considéré
comme le prophète par tous les musulmans comme un dangereux
terroriste. C’est indiscutablement une insulte, dès lors que
Mahomet est la référence de tout musulman, terroriste ou
non, et que pour un musulman, la représentation de Dieu et du
prophète est un sacrilège, et ne peut être
vécue que comme la marque d’un mépris insupportable
à l’égard d’une religion à laquelle ils
s’identifient. Cet amalgame méprisant entre la figure
"infigurable" du prophète et les islamistes violents ne peut
qu’attiser la haine entre les musulmans et ceux qui sont sensibles
à l’islamophobie. De même, à une autre
époque, la représentation du juif Shüss, justement
interdite aujourd’hui en tant qu’incitation à la haine raciale
et/ou ethnique, était l’expression d’un antisémitisme
dont on sait les conséquences. Je ne vois entre ces caricatures
islamophobes et celles antisémites d’hier, et qui sont
aujourd’hui interdites, aucune différence quant aux effets
qu’elles visent (ou peuvent) à produire.
D’où la deuxième question : a-t-on raison d’interdire une liberté d’expression qui vise à insuffler le mépris généralisé d’une religion ? La réponse est encore oui.
La liberté a pour condition le respect de celle des autres ; or toute expression outrageusement caricaturale qui est (et/ou peut être précisément interprétée comme) une insulte infamante, visant à attiser la haine, est une atteinte à la liberté de ceux qu’on méprise ouvertement, voire un appel à la violence à leur égard. Ce qui définit l’insulte n’est pas seulement un fait objectif, mais l’aspect humiliant d’une relation, non pas seulement du point de vue de "l’insulteur" présumé, mais tout autant, sinon plus, de celui qui se sent insulté.
Ces caricatures n’ont, en ce sens, rien à voir avec la critique argumentée des idées et comportements de ceux qui se réclament de cette religion, voire de ceux qui prétendent avoir autorité sur les croyants. Mais critiquer n’est pas insulter ; dès lors que des arguments rationnels sont avancés, et qu’on cible les idées et les actes, et non une communauté de croyants dans son ensemble, on respecte chacun d’entre eux en faisant appel à son esprit critique et à sa capacité de réflexion, tout en lui laissant le droit de répondre dans les mêmes conditions.
Que ceux qu’on critique soient eux-mêmes intolérants ne change rien à l’affaire : c’est leur intolérance qui est condamnable, et non leur religion dans son ensemble, ni les symboles plus ou moins sacralisés, du reste toujours polysémiques, auxquels ils sont attachés.
Défendre ces caricatures comme la manifestation de la liberté d’expression, c’est pervertir la liberté en son contraire.
Foi et vérité
On oppose souvent la vérité de la foi à celle(s) de la raison. Cette opposition est juste, dans la mesure où la vérité de la foi est toujours subjective et bien souvent dogmatique, alors que la démarche scientifique par exemple est fondée sur des procédures objectives de preuve et ouvre à la critique permanente de ses énoncés, mais il n’y aurait pas d’opposition si la vérité de la foi admettait qu’elle n’est qu’une croyance subjective, ou une vérité du coeur, comme le disait Pascal, et non de la raison ; ce qu’elle omet en prétendant en faire une vérité pour tous, croyants ou non.
Certains affirment que la foi n’a nul besoin de vérité historique, mais le problème vient qu’elle s’en réclame toujours ; il suffirait qu’elle dise que son contenu est légendaire (mélange de faits incontrôlables et de productions imaginaires) pour qu’aucune contestation ne puisse l’atteindre (on ne conteste pas la vérité d’un rêve) ; mais serait-elle encore la foi, dans la vérité en ce qu’elle a d’indubitable ? Certains affirment que la foi et le doute sont compatibles, mais alors, qu’est-ce qui peut la distinguer de la simple croyance subjective, même collective, sans valeur de vérité établie ?
Si la foi n’est pas aveugle, peut-elle survivre à la recherche critique de la vérité historique ? Si oui, c’est qu’elle est d’un autre ordre que la vérité et/ou que la connaissance, et que sa valeur n’est que symbolique et éthique -c’est-à-dire subjective, comme toute valeur éthique- et donc discutable . Si non, c’est que sa prétention à la vérité est parfaitement illusoire (imagination désirante que l’on prend pour une vérité objective), par exemple, les miracles et la résurrection de Christ.
Mais le problème reste entier : la déchirure du voile d’illusion (de la prétendue vérité) qui caractérise la foi peut la tuer chez la plupart des croyants. Donc ceux qui ont la mission d’administrer et de transmettre la foi ont tendance à refuser la recherche de la vérité, qu’ils ressentent nécessairement comme une menace mortelle pour sa survie et pour l’autorité de leur ministère.
Toute exégèse critique et historique du contenu de la foi en fait une croyance humaine dont le contenu "divin" est de l’ordre de la croyance humaine dépourvue de toute espèce de vérité universelle. Elle prend alors le risque de n’avoir qu’une valeur symbolique, indéfiniment interprétable par tout un chacun, et le pouvoir des Églises de dire la vérité unique et unifiante de la foi s’effondre inéluctablement.
Cela ne condamne pas la foi, mais les
Églises, comme machines de pouvoir spirituel et temporel, qui
prétendent toujours régir la foi et la dresser contre
d’autres formes de croyances, au nom d’une illusoire
vérité, ou d’une idée illusoire de la
vérité unique absolue, et par là,
intolérante.
Violence physique et violence morale
Contrairement à ceux qui pensent que rien n’est pire que la souffrance physique, et que la violence est nécessairement accompagnée et/ou la conséquence d’une souffrance physique, je tiens à dire que cela est démenti par l’expérience humaine la plus générale : la souffrance physique, même extrême, peut être bien vécue, comme un honneur et non comme une violence, par exemple dans un combat à la loyale (boxe par exemple), qui respecte la dignité de l’adversaire. Elle n’est plus alors ressentie comme une violence, mais comme une épreuve valorisante nécessaire. Comme le plaisir peut être mal vécu, c’est-à-dire violent, dès lors qu’il nous soumet à la dépendance dévalorisante d’un autre ou d’une drogue.
On peut accepter en effet de risquer sa vie pour une humiliation subie insupportable. On peut être tenté par le suicide, dès lors qu’on se sent, à tort ou à raison, rejeté, méprisé et méprisable, et qu’on méprise sa propre vie. On peut ressentir le grand malheur dans le sentiment de la perte de toute reconnaissance de soi (échec amoureux ou professionnel, voir aussi le cas du harcèlement sexuel qui transforme le sujet victime en pur objet du désir d’un autre, et qui est bien reconnu par le droit comme une violence criminelle).
L’amputation d’une partie du corps peut être une nécessité médicale, et n’est plus alors ressentie comme une souffrance morale insupportable, mais elle le devient lorsque cette amputation est le résultat d’une torture. Le viol même, s’il ne laisse aucune trace physique, peut être ressenti comme une souffrance pire que le fait d’avoir été hystérectomié ou estropié à la suite d’un accident de la route dont personne ne peut être tenu pour responsable.
Ainsi, la qualité de la vie et son sens dépendent toujours de la relation positive ou non qu’on entretient avec soi et les autres. La souffrance physique devient insurmontable lorsqu’elle nous réduit à une impuissance toujours humiliante, ce qui fait qu’il vaut parfois mieux mourir que de continuer à ne pas souffrir grâce aux médicaments qui nous réduisent à l’état de légume sans espoir d’en sortir.
Par contre, la souffrance physique peut être source de joie, dès lors qu’elle nous confère un statut positif (ex : la souffrance du sportif, de la femme qui accouche, etc.).
Mourir et prendre le risque de souffrir physiquement pour préserver sa dignité, est-si difficile à comprendre ? La plupart de ceux qui affirment que rien n’est pire que la violence physique en dehors de toute violence morale seraient-ils prêts à se coucher devant quelqu’un qui les insulte pour l’éviter ? Permettez-moi d’en douter, toute l’histoire des hommes montre le contraire, à savoir que la violence physique est bien souvent la réponse à la violence morale pour qui croit, à tort ou à raison, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour laver l’affront dont il souffre. Il est donc juste de dire qu’il n’y a de violence physique dans les rapports humains que s’il y a violence morale, c’est-à-dire violation du droit à la dignité morale et de l’intégrité psychologique d’une personne.
Beau débat philosophique, qui ouvre
une autre perspective sur la violence des caricatures islamophobes et
leurs conséquences sur des croyants musulmans, qui n’ont rien
à voir avec le terrorisme islamique.
Le refus français du TCE (traité pour une constitution européenne) a été en partie lié au refus de la circulaire sur les services, dite circulaire Bolkestein ; or, à la lecture de cette circulaire, on peut légitimement douter que celle-ci soit ce qu’on en a dit. Que dit-elle, en effet ?
Les dérogations concernent en particulier la directive sur le détachement des travailleurs (96/71/EC). Toutes les matières couvertes par cette directive (telles que le salaire minimum, le temps de travail, la sécurité, les standards d’hygiène et de sécurité...) sont exclues du principe du pays d’origine. Cela concerne les conditions de travail prévues par la loi et les conventions collectives. Les fournisseurs de services doivent respecter les conditions de travail de l’EM (Etat membre) dans lequel ils détachent leurs travailleurs et les autorités de ces EM doivent en contrôler le respect (Art. 17(5), 24(1))."
La fameuse circulaire Bolkestein a donc été instrumentalisée sans vergogne, alors même que son contenu n’a jamais été intégralement publié et expliqué, seulement cité en des extraits tronqués qui en dénaturent le sens.
1) Remarquons que le fameux "principe de pays d’origine" est toujours appliqué par la France losqu’elle exporte des salariés en Pologne ou ailleurs. Nul doute que ce principe, si principe il y a, a vocation à devenir réciproque, sauf à préserver cette différence de traitement entre les différents pays européens indéfiniment. Si l’on veut supprimer ce principe, alors il faut interdire son usage par la France ; or, je doute que les salariés français qui travaillent en Pologne soient d’accord, comme on l’a vu dans les quelques tentatives mort-nées de certaines entreprises, qui proposaient de délocaliser leur salariés en Roumanie ou en Tchéquie aux conditions de ces pays.
2) Ce principe est donc une nécessité à terme si l’on veut développer le marché commun dans le domaine des services (duquel les services dits "publics monopoles d’Etats" et non marchands, je le rappelle, sont explicitement exclus ; ces services non-marchands restant de la compétence exclusive des Etats) ; mais compte tenu des écarts économiques et sociaux actuels entre les pays européens, il est nécessaire d’introduire des dérogations temporaires à ce principe ; ce que faisait, et fait encore, la fameuse circulaire qui reconnaît que ce principe du pays d’origine ne s’applique qu’aux travailleurs dont la mission dans le pays d’accueil socialement plus favorisé n’excède pas 8 jours.
3) Le principe du pays d’accueil posé comme éternel et qui ne tiendrait pas compte d’une homogénéisation progressive des conditions économiques et sociales (comme on l’a vu dans le cas de l’Irlande, de l’Espagne, etc.) ne serait donc rien d’autre que le refus de voir que cette homogénéisation est aussi la conséquence d’un réel marché commun des services. Il revient à refuser la logique même du marché commun et de la construction européenne pour en revenir au principe du protectionnisme au profit des pays plus favorisés, aux dépens des travailleurs des autres pays qu’on appelle les nouveaux entrants. Il ne signifie rien d’autre que ceci : les salariés des pays moins favorisés seraient assez débiles pour ne rien faire afin que leurs conditions sociales et de travail s’améliorent chez eux et chez nous, et seraient indéfiniment d’accord pour maintenir les écarts actuels. Ce qui est, pour le moins, une vision droitière, car nartionaliste, des conflits sociaux. Je suggère pour ma part une tout autre démarche authentiquement de gauche : celle qui fait de la solidarité active entre salariés français et étrangers, dans les pays d’accueil favorisés, le ressort d’un traitement égal pour tous, comme cela s’est vu dans les luttes des "Chantiers de l’Atlantique" à Saint-Nazaire.
4) C’est bien entre les adversaires de l’intégration européenne et ceux qui veulent son développement que s’est joué le référendum sur le TCE, amalgamé à une circulaire mal lue et mal expliquée. Celle-ci et le TCE posent le problème des règles des échanges dans le cadre hétérogène actuel, tout en inscrivant comme but à l’Europe des services son homogénéisation sous le contrôle d’un Parlement européen aux pouvoirs renforcés. Mais dire non au référendum a tout à la fois affaibli la position de la France vis-à-vis de ses partenaires, qui majoritairement ont ratifié le TCE, et le pouvoir du Parlement européen ; ce qui fait que les adversaires de la circulaire ont précisément affaibli leur position. Peut-être parce que certains d’entre eux ont voulu démagogiquement jouer de la fibre protectionniste et nationaliste pour parvenir au pouvoir tout en prenant le risque délibéré de casser la dynamique européenne.
Conclusion : ces adversaires masqués de la construction européenne auront du mal à expliquer en quoi leur appel à voter non au référendum, sous prétexte de refuser la directive Bolkestein, a favorisé les plus libéraux des Européens qui ne voient que le seul marché commun, sans souci d’harmonisation sociale. Je tiens donc à le faire à leur place, pour qu’on ne s’étonne pas que la directive en question reste d’actualité, et je vous délivre un scoop, le TCE aussi... On en reparlera après 2007...
La liberté d’expression, la violence et la paix.
Sur le plan politique, le résultat de cette provocation est en effet totalement contraire à ce que nombre de défenseurs de la liberté d’expression en espèrent : tous les gouvernements démocratiques ont condamné ces affiches, et ont fait appel au sens de la responsabilité des journalistes, et il est sûr qu’à moins de vouloir la guerre contre plus d’un milliard de musulmans en les solidarisant avec les plus extrémistes d’entre eux, ils ne pouvaient pas faire autrement au regard des conséquences antidémocratiques et antilibérales qu’une attitude d’approbation et de soutien de cette provocation eût générée. (ex : le gouvernement danois n’arrête pas, depuis, de se confondre en excuses, face à la menace de boycott économique et de gel des relations diplomatiques dont leur pays est l’objet). Quant aux conséquences de cette provocation (explicite pour les auteurs, je le répète) dans les pays musulmans, elle sont, sans équivoque possible, négatives ; dès lors qu’elles permettent cette instrumentalisation de la religion par des forces politiques les plus réactionnaires, elles sont pain béni pour la stratégie de guerre des civilisations. Il ne faut pas non plus oublier le fait que c’est la droite extrême qui risque chez nous d’en tirer bénéfice, au risque d’aggraver des tensions entre musulmans et non-musulmans français, pouvant prendre un caractère ethnique, pour ne pas dire raciste (il suffit de lire certains commentaires sur ce blog pour le montrer). À l’heure du développement d’une situation très compliquée au Moyen-Orient, dans laquelle l’Europe joue une partie diplomatique de pacification très difficile (Iran, Palestine, Syrie, etc.), celle-ci se serait bien passée d’une provocation guerrière aussi politiquement contre-performante, dès lors qu’elle affaiblit sérieusement sa crédibilité pacifique (à la différence de la politique US, et cette différence est cruciale pour la paix).
Sur le plan philosophique, la plupart des commentateurs favorables à la publication de cette provocation minimisent le rôle et l’importance de violence de la caricature (Mahomet = terroriste) et de l’offense qu’elle exprime, car ils méconnaissent ou édulcorent le fait qu’une violence morale peut être vécue comme pire qu’une violence physique, et qu’elle peut de plus générer les violences physiques et des troubles pour l’ordre public contre un ensemble d’humains définis par leur religion ; mais cette disproportion apparente entre les caricatures et les violences physiques (dont il ne faut pour l’instant exagérer la gravité, relativement par exemple à certaines violences sociales chez nous) que beaucoup soulignent ne relève que de notre point de vue, subjectif, et n’existe pas en soi ; car la violence est toujours vécue d’abord comme humiliation. Il est même possible de montrer que l’insulte est une violence, et même l’essence de toute violence, car le malheur suprême est toujours la perte de toute dignité et d’estime de soi (au point parfois de désirer en mourir, ou de s’exposer au risque de la mort pour laver l’outrage) .Ainsi on peut avancer que la violence physique n’est vécue comme violence que parce qu’elle nie l’intégrité de la personne dans la relation moins physique que psychique (estime de soi) qu’elle entretient avec elle-même.
Il ne faut donc pas confondre liberté et licence ou laisser-aller insultant et aveugle aux conséquences de ce qu’on dit ou fait ; c’est pourquoi un certain nombre de lois de tolérance existent qui, loin d’interdire la libre critique, l’obligent à prendre une forme raisonnable et respectueuse, la seule admissible dans un pays qui se veut démocratique.
Conclusion : Sur un plan juridique et philosophique (et la philosophie du droit fait partie du droit, même si -et cela est regrettable- elle n’est plus enseignée à l’Ecole supérieure de la magistrature), il n’ y a d’autre liberté absolue ou illimitée que celle de la violence extrême... Le droit a et doit avoir une double finalité : la garantie des libertés essentielles, et le souci de réduire le risque de violence ; ne voir que le premier aspect et négliger le second, c’est tout à la fois menacer l’un et l’autre. La liberté sans limite, même d’expression, est nécessairement liberticide car violente.
Liberté, sociabilité et tolérance
Toute société, pour se
maintenir dans un état relativement stable, a besoin de produire
les conditions d’une identification des individus aux autres membres du
groupe, et ceci d’autant plus qu’elle se sent menacée de
l’intérieur par des forces antagonistes ; c’est alors
l’union sacrée contre les ennemis intérieurs et
extérieurs. Mais cette union sacrée comporte un risque,
celui de mettre en péril la liberté individuelle dont
nous nous réclamons. Comment penser une telle
contradiction ? Est-il possible de la résoudre ?
Cette identification spontanée aux
autres dans toute société est toujours
nécessairement valorisée et valorisante, car elle offre
aux individus une protection suffisante contre la menace
dépressive toujours présente de la perte de soi
(déréliction), du mépris et de l’angoisse de la
mort, et peut répondre de façon fantasmatique
au désir universel de la reconnaissance de soi, y compris
jusqu’au sacrifice valorisant du soi biologique et égocentrique
en faveur du groupe. Elle peut emprunter la forme religieuse ou
nationale(iste), voire raciste particulariste qui n’en est qu’une
variante sécularisée, ou bien se référer
à des valeurs qui sont proclamées universelles,
c’est-à-dire valant pour tous, ce qui est le cas dans les
sociétés occidentales aujourd’hui.
Mais le racisme ou la xénophobie sur
fond de ces valeurs communes, y compris celles qui se présentent
rationnellement comme universelles, corrompent nécessairement
les réactions spontanées de chacun, dans le sens du rejet
de la différence de l’autre. Cela est vrai vis-à-vis de
qui parle une langue qu’on ne comprend pas ou se livre à des
rituels symboliques étranges car étrangers, donc
inquiétants en cela qu’ils menacent le sentiment valorisant
d’être protégé moralement par un groupe uni et sans
faille, dans l’expression d’une identité spontanément
valorisante.
Ainsi, la seule manière de desserrer
cet étau, véritable glu sociale qu’est cette
identification valorisante au groupe et le rejet de la
différence qu’elle provoque (la caricature comme provocation
identitaire), est de refuser de se dissoudre dans un groupe plus ou
moins fusionnel, qui génère une solidarité
automatique (non choisie), pour s’affirmer capable (et donc fier) de
penser et d’agir par soi-même dans le respect des autres, respect
qui est aussi la condition d’une authentique autonomie individuelle.
Cet effort implique qu’on sache traduire les comportements et les
croyances des autres en une langue qui nous soit compréhensible,
tout en combattant d’abord en soi, et ensuite dans la
société, les idées, les comportements et surtout
les émotions qui interdisent cet effort pour se dégager
du racisme spontané et de la xénophobie
réconfortante qu’engendre l’identification aux valeurs de son
groupe.
Or, si dans nos sociétés, le
racisme est dévalorisé au nom d’un humanisme universel,
et c’est tant mieux, il n’est pas vaincu dans la dimension profonde de
notre identification aux autres ; c’est pourquoi il peut
réapparaître lors d’un conflit, en empruntant le masque de
ces mêmes valeurs, mais en en faisant un usage xénophobe.
C’est très exactement , me semble-t-il, ce qui se produit
lorsque, au nom de la valeur universelle de la liberté d’
expression, on s’autorise à insulter ou à offenser les
croyances des autres, sans chercher à les comprendre, ni
à savoir si ces autres sont ou non des criminels liberticides
assimilables à des terroristes, qu’il est tout à fait
nécessaire de combattre par tous les moyens idéologiques
politiques, juridiques et militaires dont nous disposons. Ce dernier
combat suppose donc qu’on s’oblige à dissocier en permanence les
comportements criminels avérés et ceux qui s’y livrent
(ex : les terroristes) des croyants d’une religion dans son
ensemble, avec qui il convient de dialoguer en les respectant, pour
justement qu’ils deviennent, en eux-mêmes, capables de cet effort
qu’exigent les valeurs universelles dont on se réclame à
bon droit, non seulement pour soi, mais tout autant pour les autres. On
est alors aux antipodes d’une prétendue liberté sauvage,
au fond liberticide, mais au plus près d’une liberté
régulée, à savoir respectueuse de celle des autres
et de la notion universelle de droit de l’homme qui, en aucun cas, ne
peut signifier le droit à insulter autrui pour se
défouler ou se faire plaisir dans la réaffirmation de
notre appartenance collective..
De l’Allemagne : une démocratie sans politique ?
Je vous écris de cet étrange pays démocratique qui vient d’abolir quasiment toute vie politique, puisqu’en effet, depuis les dernières élections législatives, les deux grands partis populaires, auparavant opposés, dirigent le pays en un consensus sans faille voulu par les électeurs, et s’entendent sur des mesures sociales très importantes pour assurer la réduction des déficits, à défaut de celle du chômage. Mais une démocratie apolitique ne serait-elle pas un cercle carré ?
L’extension
de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. Accord
La
pression économique renforcée sur les chômeurs pour
trouver un travail rapidement ; des allocations réduites et
la quasi-obligation pour les chômeurs d’assurer un travail
payé 1 € l’heure. Accord
Des
quotas renforcés limitant les actes médicaux et des
prescriptions de chaque médecin pour réduire les
dépenses de santé et l’augmentation de la contribution
des malades aux frais médicaux. Accord
Le
refus renouvelé de l’Etat d’intervenir dans les relations
sociales sur les salaires et les conditions de travail. Accord
La
flexibilisation du temps de travail directement négociée
par branche, voire par entreprise. Accord
L’augmentation
de deux points de la TVA. Accord.
De plus, sur le plan politique, cette coalition sans véritable opposition projette une réforme des institutions très importante :
Le
clarification du partage du pouvoir entre la chambre des
députés par rapport à celui de la chambre des
représentants des régions, laquelle en Allemagne,
contrairement au Sénat en France, disposait d’un quasi-droit de
veto sur l’ensemble des décisions législatives. Une telle
mesure va redéfinir les compétences des uns et des
autres, et donc un des fondements du fédéralisme à
l’allemande.
L’augmentation
de la durée écoulée entre les élections
législatives, qui décident de la composition du
gouvernement et de la nomination du chancelier(e), de 4 à 5 ans,
avec pour première conséquence, la prolongation de la
coalition actuelle et du consensus politique qu’elle implique.
Les médias, quant à eux, contribuent à la démobilisation politique des citoyens en insistant sur les préoccupations consensuelles des électeurs ; ils s’intéressent surtout à la prochaine coupe de monde de foot qui se déroulera en Allemagne (Ah, le foot, comme Dieu selon Voltaire, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer !) et aux mesures de sécurité anti-terroristes qu’elle implique, ainsi qu’à la question de l’extension de la journée scolaire et à la création de crèches pour mettre les femmes aux travail et réduire le déficit démographique galopant (ceci dans le but de réduire le déficit des caisses de retraites et d’assurance maladie), et aux mesures techniques qu’exige la lutte contre la grippe aviaire. Peu de débats réellement politiques sont publiés, sinon à la marge.
Enfin, l’opposition théorique est sans pouvoir, car elle est totalement divisée entre des libéraux plus ou moins ultra (9%) et des socio-nationalistes archaïques (8%) qui refusent toute réforme ; avec entre les deux, si j’ose dire, les verts (8%) qui, selon les sujets, tantôt penchent vers les premiers, tantôt vers les seconds, mais toujours se déchirent entre eux.
Le seule opposition n’est pas politique, et/ou est sans relais politiques, c’est celle des salariés du service public et de leur syndicat (VERDI) qui menacent de faire grève et la font, bien qu’elle soit plus ou moins interdite par leur statut, contre la politique de suppression des postes dans le but de réduire les déficits publics.
Déjà, en 1815, Benjamin Constant nous avait avertis : la liberté des modernes, écrivait-il, est celle des individus, à la différence de celle, politique, des anciens (Grecs) ; ainsi, selon cet auteur, la démocratie n’implique en rien la mobilisation permanente des citoyens (qui le sont donc de moins en moins), dès lors que ceux-ci veulent seulement que les affaires communes soient bien gérées par des hommes de bonne volonté, obligés, par la grâce des électeurs, de travailler ensemble pour définir des mesures techniques, dont le seul but serait de réduire les risques collectifs actuels et, mais dans une bien moindre mesure, à venir.
Faut-il regretter que les passions politiques s’effacent devant la pacification sociale d’une techno-démocratie consensuelle ? Le comble de la démocratie individualiste n’est-il pas dans la disparition de la politique politicienne, et par là d’une certaine idée romantique, plus ou moins héroïque, du combat politique, au profit d’une gestion sage et raisonnable des intérêts sociaux divergents en vue de maintenir la paix civile et le minimum de sécurité qui permette à chacun de vaquer à ses affaires personnelles ?
Remarquons que cette fin de la politique ne serait pas la fin de la démocratie ; car les électeurs se réserveraient le droit de chasser pacifiquement du pouvoir qui refuserait ou serait incapable de leur assurer ce minimum de sécurité personnelle auquel ils estiment avoir un droit supérieur à tout autre droit collectif. Une telle démocratie serait sans peuple souverain, mais non sans individus électeurs.
Cet article est une caricature argumentée
et, j’ose l’espérer, plus aimable que détestable ;
en tout cas propre, au contraire de certaines autres, à
éveiller la réflexion, et à calmer les passions
illusoires et violentes. Mais je ne doute pas que certains se feront un
plaisir de la corriger et de la complexifier, avec ce qu’il faut de
passion (rien de trop) pour intéresser la partie.
Le retour du Traité
constitutionnel européen
Le TCE a été ratifié par la majorité
des Etats de l’Union, comprenant la grande majorité des
populations européennes. C’est un fait incontournable. Peut-on
faire comme si ce fait était nul et non avenu?
En effet, le refus minoritaire par la France et la Hollande, non
seulement pose le problème formel de la démocratie
européenne, car une minorité prétendrait alors
imposer sa position purement négative à la
majorité (aucun plan B), mais pose aussi le problème
politique de la poursuite de la construction de l’UE, car
l’élargissement impose, dès aujourd’hui, pour des raisons
d’efficacité, un changement des règles de fonctionnement
de l’UE.
On le voit déjà à propos de la libre-circulation, sans aucune restriction, des travailleurs en Europe et de la circulaire sur les services -deux questions que l’on ne peut séparer- sur lesquelles les différentes institutions de l’UE sont déjà en train de statuer et/ou s’apprêtent à le faire. La seule loi de l’unanimité et la répartition des voix existantes en ce qui concerne les décisions à majorité qualifiée semblent autant de facteurs de blocages potentiels, comme on l’a vu en ce qui concerne la taux de la TVA dans le BTP et la restauration proposé par la France, ce qui entre parenthèses rend pour le moins caduque l’affirmation que le domaine fiscal échapperait à l’UE.
On comprend alors que les responsables politiques français et allemands, comme nous l’apprennent plusieurs organes de presse allemands, cherchent à négocier les conditions d’une nouvelle ratification par la France du TCE. Les propositions concerneraient la séparation des parties I (Institutions), II (Charte des droits fondamentaux) et IV (Procédures de révisions) du TCE de la partie III (économique, mais aussi sociale) qui avait soulevé l’hostilité que l’on sait, en particulier chez les partisans du «non de gauche». Nombre d’entre eux, et en particulier le premier d’entre eux, Laurent Fabius, ont toujours prétendu qu’ils auraient appelé à voter oui sur les seules partie I et II et que leur opposition ne portait que sur la «constitutionnalisation» («gravée dans le marbre») de la partie III qui, selon eux, ne concernerait que la politique économique et sociale ordinaire, ouverte par nature au débat et à l’alternance politiques.
Ce démembrement du TCE permettrait de refaire voter les Français et les Néerlandais sur les parties I, II et éventuellement IV «agrémentées» d’une déclaration sur la recherche des exigences sociales à mettre en œuvre et à harmoniser en Europe. La partie III, dont on corrigerait à la marge certaines formulations mal interprétées, mais qui s’applique déjà pour l’essentiel du fait même qu’elle ne fait que reprendre les traités antérieurs, ferait l’objet d’un vote du Parlement français, ce qui est dans la nature des lois ordinaires.
Cette procédure aurait le mérite de
permettre de distinguer les «non» de gauche et les
«non» souverainistes, et donc de mettre au pied du mur les
premiers en les prenant au mot. De plus, elle laisserait ouverte la
question du choix politique entre l’ultra-libéralisme et le
social-libéralisme, compte tenu du fait que l’option du
social-nationalisme et/ou du national-souverainisme serait
écartée comme incompatible avec l’idée même
de construction européenne, dont la marché commun et le
principe libéral de concurrence libre et non faussée sont
les conditions nécessaires de possibilité. Mais elle
aurait aussi l’avantage de permettre de distinguer plus nettement
l’ultra-libéralisme et le libéralisme authentique, qui
doit être toujours assorti de règles et d’objectifs
sociaux.
Le mot démocratie signifie étymologiquement le pouvoir du peuple sur le peuple. En cela il désigne un régime politique qui est fondé sur l’idée de souveraineté populaire et qui met en œuvre des procédures légales qui en permettent l’expression effective, tels que le vote au suffrage universel, la représentation indirecte des électeurs-citoyens dans les différentes assemblées législatives et le choix par les citoyens de ceux qui exercent le pouvoir de l’état (législatif et exécutif) etc... il semble donc que l’on ne puisse se passer de ce terme pour penser la démocratie. Or ce terme est à la fois ambigu et peut être source de manipulation politique dans le cadre du langage rhétorique utilisé par des hommes politiques que certains n’hésitent pas à qualifier de populistes ; d’où la question peut-il exister une démocratie sans peuple (au singulier) , mais non pas sans citoyens au pluriel ?
Remarquons d’abord que ce terme est utilisé dans le langage politique commun en deux sens différents, voire opposés :
- Le peuple désigne ensuite ceux d’en bas, en tant qu’ils s’opposent dans l’ensemble juridique qu’est un pays constitué et reconnu, à ceux d’en haut, donc d’abord à l’état et ensuite à ceux qui disposent d’un pouvoir, économique, intellectuel etc.., reconnu comme illégitime, voire despotique. Le peuple est alors l’ensemble des dominés qui s’efforcent de combattre la domination qu’ils subissent. Cette notion est à l’évidence polémique et présuppose
2) qu’il y a un intérêt commun de l’ensemble de ceux qui se sentent opprimés et que cet intérêt peut s’exprimer à travers un programme politique ou une vision positive de la société cohérents.
C’est pourquoi il est particulièrement absurde, en démocratie, pour un individu de se réclamer du peuple, s’il n’a pas été élu ; et même lorsqu’il l’a été, sa représentativité populaire reste douteuse, car il ne l’a été que par une partie des électeurs dont l’unité apparente peut changer à le faveur de circonstances ou de conflits nouveaux. Ainsi est-il est dans la nature de la démocratie de permettre l’alternance politique de telle sorte que la prétendue volonté commune des citoyens ne peut être représentée que dans le cadre d’une majorité nécessairement temporaire ; elle est par définition toujours instable et variable. Pour obtenir un telle majorité de circonstance les hommes politiques sont tentés de flatter le nationalisme ethnique et la xénophobie, de préparer la population a la guerre contre un ennemi intérieur ou extérieur présenté indistinctement et globalement (ou les deux, voir l’antisémitisme ou l’islamophobie) comme mortel (c’est ce qu’on appelle « le populisme » démagogique), bref d’organiser l’union sacrée contre les « étranges étrangers » ou à orchestrer la révolte révolutionnaire contre les dirigeants(ceux d’en haut), car en démocratie pluraliste la révolution n’a plus de sens sauf à vouloir l’abolir au nom d’une dictature (ex : du prolétariat ou démocratie, populaire, c’est à dire dictature unificatrice sur la population pour en faire un peuple uni stable). La révolution n’est, en droit libéral et démocratique, justifiée qu’en dictature ou sous un régime despotique qu’il convient de renverser pour le renverser par la démocratie.
La démocratie est donc pluraliste ou n’est pas ; en cela elle ne peut prétendre unir le peuple mais elle doit se contenter de représenter sur le théâtre des assemblées et des médias et sous une forme non-violente les conflits au sein de la population afin d’élaborer des compromis toujours momentanés entre des positions politiques nécessairement divergentes qui ne sont jamais garanties d’être durablement majoritaires ; en cela elle a toujours besoin d’élites capables de parler et de gouverner au nom des électeurs ; mais à moins de vouloir instaurer la dictature permanente d’une majorité introuvable (et donc qui ne peut être en fait que la dictature d’une minorité), la démocratie exclut nécessairement le renversement révolutionnaire de ces élites politiques, économiques et idéologiques, sauf à se supprimer elle-même.
Ceci veut dire qu’en toute rigueur une démocratie est un cercle carré : le peuple ne peut se gouverner lui-même, car il est en lui-même spontanément toujours divisé . L’idée démocratique n’a de sens qu’à être élective et représentative. La démocratie dite directe est donc une pure illusion qui ne peut conduire qu’au chaos, à la violence et à la dictature despotique d’une minorité inamovible sur une ensemble ultra-majoritaire de citoyens désunis. En ce sens elle n’est pas populaire sauf au sens apolitique d’ensemble de citoyens soumis à l’autorité d’un état , mais elle n’est pas sans citoyens politiquement divers, voire en conflit. Elle tente d’organiser ce conflit pour en faire un facteur d’évolution favorable mais celle-ci est toujours sous la menace de l’impuissance générée par une opposition politique disparate dès lors qu’elle s’entend sur le refus (le non) mais très rarement sur une l’alternative positive unifiée. (Voir le résultat du référendum sur le TCE)
Seule une unification religieuse sous l'autorité transcendante de Dieu et de ses représentants sur terre est susceptible de former un peuple dans une même foi (le peuple de Dieu); or si la république est laïque, il lui manque, pour forger cette unité, une autorité transcendante suffisante. On peut donc comprendre en quoi la notion de peuple est incompatibe avec la démocratie pluraliste et laïque. Vouloir instaurer la souveraineté populaire en puissance unifiée et unificatrice de la démocratie , c'est en fait refuser la laïcité dans sa conséquence inéluctable: Le peuple y est introuvable, seuls existent des électeurs qui font la décision et la défont.
La prostitution et le droit: du rapport entre le droit et la
morale
On ne voit pas très bien ce que le métier de
prostitué(e) aurait de plus moralement dégradant que
d’autres métiers dits "de services"; ce qui l’est c’est, d’une
part, le regard hypocrite d’une société qui le
méprise tout en l’exploitant (en tous les sens du terme) et
surtout, d’autre part, les conditions de cette exploitation, du fait de
cette condamnation morale de façade. Tout
métier de service à la personne pourrait,si on pousse la
logique des choses, être considéré comme de la
prostitution. La condamnation "moraliste" du seul service qu'est le
service sexuel est en droit injustifiable; du reste le droit n’interdit
pas la prostitution, mais le proxénétisme
généré par le refus de soumettre ce métier
au droit social ordinaire.. Il y aurait donc une contradiction
à refuser certains droits sociaux aux
prostitué(e)s, au nom de refus moral de
la prostitution, alors que
celle-ci n'est pas, en droit, interdite et qu'elle est une profession
légalement fiscalisée et donc reconnue.
Examinons les élements de ce paradoxe:
On
ne voit pas, en effet, en quoi le sexe serait un organe corporel
différent de la main qui masse ou qui coupe les cheveux ou qui
soigne...à moins de considérer que la
sexualité en général doit être soumise
à des normes ou interdits moraux particuliers, ce qui
avait peut-être encore un sens à une époque
où la contraception n'existait pas, mais n'en a plus
aujourd'hui. Les seuls motifs de cette différence paraissent
d’ordre religieux et donc ne valent que pour ceux qui y adhèrent
et non pour tous. Le problème
est donc que le point de vue moral des adversaires de la prostitution
n'est pas nécessairement celui de tout le monde; chacun a le
droit de considérer que la prostituion est un service comme un
autre et je ne vois pas au nom de quelle morale valant pour tous on
pourrait imposer aux autres, clien(e)ts et prostitué(e)s
consentant(e)s, la morale particulière qui est celle de ses
adversaires.
Personnellement, je n'aime pas la boxe que j’estime violente mais je
n’en demande pas l’interdiction pour autant, dès lors que les
boxeurs (adultes et vaccinés) ne la voient pas comme telle ou
consentent à cette violence comme un plaisir lié à
leur sport. Si c'est en effet le droit des
adversaires de la prostitution de la refuser pour
eux-mêmes, ce ne l'est pas de l'interdire aux autres.Ce
qui fait que le droit, par principe libéral et universaliste, ne
peut interdire la prostitution (laquelle ne concerne pas que les
femmes), ce qui est effectivement le cas: le droit interdit le
proxénétisme et le racolage sur le voie publique, pas la
prostitution. Il est alors absurde de voir le droit
condamner pour proxénétisme quiconque vit avec un(e)
prostitué(e) ou loue un logement ou une chambre à un(e)
prostitué(e ) etc..
Ainsi si nul ne n'oblige personne à se
prostituer ou à fréquenter les prostitué(e)s
on ne voit pas en quoi il faudrait interdire le prostitution,
comme service rémunéré à la personne,
à ceux qui y consentent . De plus le fausse interdiction
actuelle a pour seul résultat de transformer la prostitution en
esclavage et en entreprise mafieuse dont les pratiques sont contraires
aux droits des hommes et des femmes prostitués.
C'est
un tel déni des droits des prostitué(e)s qui est
injustifiable alors qu'elle ont le droit d'exercer ce métier. Pour sortir de cette contradiction,
il faut donc sortir de l’hypocrisie qui consistent à condamner
la prostitution et surtout les prostituées pour des raisons
«moralistes» particulières et à la
«tolérer» l'exercice de leur métier, dans les
conditions les plus intolérables pour elles et les plus
dangereuses pour la santé publique, du fait même de cette
condamnation injustifiable en droit. Il faut donc
légaliser la prostitution de telle sorte que les
prostituées jouissent du droit social de tous les autres
travailleurs. et que les exigences de santé publique
particulières à cette profession puissent s'appliquer
comme dans les autres.
Réponse
à une objection:
Dans le précédent article, je n’ai fait que montrer qu’il
y a une contradiction entre le fait que l’on ne peut ni en droit, ni en
fait, interdire une profession et le fait de refuser tout droit social
quant à son exercice; cette contradiction conduit donc à
stigmatiser les prostitué(e)s et à accepter, avec
quelques protestations bien-pensantes parfaitement hypocrites, qu’ils
(prostitué(e)s) l’exercent dans des conditions qui, du fait de
cette stigmatisation, sont parfois proches de l’esclavage et dans un
cadre criminogène dont ils sont les premières victimes,
mais aussi la santé publique via leurs clients.
Quant à savoir ce qu’il en est de la jouissance féminine, deux remarques:
Je ne suis pas certain que les prostituées exercent cette profession en vue d’en jouir sexuellement même si cela n’est pas exclu. mais cela est vrai de la plupart des professions qui ne sont pas, ni sexuellement, ni autrement, des parties de plaisir. D’autre part je ne pense pas qu’il y est une grande différence entre la jouissance masculine et féminine mais qu’il y a des différence entre les individus tous sexes confondus.
Le métier de la prostitution ne concerne pas que les femmes mais aussi les hommes, c’est pourquoi je m’efforce d’écrire: prostitué(e)
Je n’ai aucune métaphysique qui essentialiserait la différence sexuelle et du reste ma philosophie est anti-métaphysique en cela qu’elle refuse d’enfermer la réalité dans des grilles conceptuelles qui vaudraient pour tous sans examen rationnel et critique. Elle se soucie des personnes plus que des entités conceptuelles plus ou moins forgées sur fond de préjugés discutables sur la sexualité. Ce que le pense avoir fait dans mon article.
Je soutiens entièrement la cause des
mouvements qui militent pour la légalisation, en terme de droit
du travail, d’une profession qui ne peut pas être
affirmée, en elle-même, comme plus infamante que beaucoup
d’autres.
Il ne faut pas confondre les situations et les problèmes:
C’est une chose de constater que, dans les conditions d’aujourd’hui, il est imposssible d’exercer cette profession dans des conditions de dignité sociale et de santé publique minimales; mais la légalisation et la non discrimination de cette profession ferait que ceux et celles (et je le redis: les prostitué(e)s ne sont pas seulement des femmes) qui désirent l’exercer pourraient le faire sans être socialement discriminées ou méprisées à commencer par le droit; c’est le même problème qu’avec l’homosexualité: le société peut et doit évoluer sur ce point et le droit peut et doit y contribuer.
C’est autre chose que de choisir la prostitution socialement et juridiquement réhabilitée pour soi ou ses proches (et des adultes ne sont pas des enfants et reciproquement: la pédophilie est condamnable car elle est toujours violence faite à l’enfant, pas la prostitution entre adultes consentants); car cela relève de la liberté individuelle.
Chaque famille peut donc choisir d’éduquer et
d’orienter la formation de ses enfants dans le sens de ses convictions;
ce qui ne veut pas dire que les enfant, devenus adultes, ne fassent pas
des choix différents. La seule chose qui paraît devoir
être rigoureusement interdite c’est une éventuelle
formation professionnelle à la prostitution avant la
majorité; cela reviendrait à décriminaliser la
pédophilie. Mais il y a de nombreux métiers qui ne
peuvent pas relever d’une formation "en acte" avant la majorité
(ex: la police et l’armée et toute profession qui peut faire
usage de la violence potentiellement létale).
le 21/03/06
Autorité
politique et représentativité démocratique
La situation politique créée par le conflit autour du CPE
marque une crise qui affecte l’ensemble des institutions et, par
delà celles-ci, la pensée et de la pratique politiques
démocratiques dans notre pays. Qu’est ce qui en cause? Rien
moins que le question de la représentation politique elle
même qui est pourtant le coeur de notre régime politique.
d’un côté le premier
ministre maintient le CPE en arguant de la légitimité du
parlement qui a voté la loi comprenant le CPE en tant que simple
amendement d’une loi sur l’égalité devant l’emploi, alors
qu’il instaure une inégalité au sein même du
contrat de travail et cela sans avoir à le présenter au
préalable au conseil d’état comme cela aurait
été le cas si cet amendement avait été une
loi);
d’un autre coté le
parlement issu d’un scrutin majoritaire tripatouillée par le
découpage électoral a été sommé de
la voter sous la menace sans avoir le droit discuter de ce nouveau
contrat de travail et de présenter des amendements
(procédure du 49-3);
de plus le gouvernement n’a
même pas, par ce subterfuge de l’amendement, mais pas plus du
reste en ce qui concerne de la loi sur l’égalité devant
l’emploi , fait procéder à des consultations avec les
partenaires sociaux alors que sa majorité avait voté une
loi lui en faisant obligation.
Il n’est donc pas étonnant dans ces conditions que la rue
manifeste et exprime sa défiance quant à la
représentativité d’un parlement vidé de sa
fonction législative essentielle au profit de l’exécutif.
Le gouvernement par sa méthode qui relève d’un
autoritarisme quasi-monarchique, voire despotique, prétend faire
la loi tout seul en court-circuitant toutes les médiations
sociales et en neutralisant le parlement. Un tel coup de force est
contraire à l’esprit, sinon à la lettre, de notre
constitution. Même les députés de la
majorité devant les conséquences de cette attitude se
rendent comptent, mais un peu tard, qu’ils ont été
piégés et qu’ils ne jouent plus aucun rôle hormis
celui d’être des soldats aux ordre d’un gouvernement sourd et
aveugle. Le parlement et le gouvernement sont alors disqualifiés
pour donner aux jeunes une leçon de démocratie et leur
légitimité est politiquement, sinon juridiquement,
compromise.
Mais il convient d’aller plus loin dans l’analyse si l’on veut
comprendre la crise et se demander ce qui, dans la vision de la
politique de ceux qui nous gouvernent, peut justifier, à leurs
yeux un tel comportement . Dominique de Villepin semble penser -et il
le dit- que les citoyens français attendent que le gouvernement
faire acte d’autorité, seul moyen d’assurer les réformes
dans le calme et la sécurité. Plus
généralement, seule une attitude inflexible et sans
compromis peut faire que les français se sentent
gouvernés et donc unis par l’autorité incontestable de
ceux qu’ils ont élus et/ou qui a été élu ou
nommé par qui a été élu par eux. C’est le
pouvoir du souverain disait Hobbes qui constitue le peuple et la
citoyenneté des individus, sans ce pouvoir il n’ y a que
multitude divisée et individus naturellement portés
à la violence généralisée et
indifférenciée.
Or cette vision de la politique est justement incapable de transformer
les individus en citoyens responsables dès lors que
l’état, au plus haut niveau, se refuse à ouvrir les
conditions du dialogue social entre des intérêts sociaux
nécessairement divergents dont il confisque le droit à
l’expression; en cela il se croit le seul détenteur d’un
intérêt général ou mutuel dont il peut
décider sans aucune consultation ou , ce qui est pire, il
prétend décider d’abord et discuter après la
décision prise, en phase d’application; ce qui était
encore possible dans une société dominée par de
grands clivages unificateurs d’ options alternatives cohérentes
ne l’est plus dans une société pluraliste et
individualiste complexe. Le pouvoir a besoin de
légitimité or celle-ci ne se trouve plus seulement dans
les urnes et non plus dans une majorité qui serait ipso-facto
détentrice de l’inrérêt général
tombé du ciel et/ou dans l’autorité autoproclamée
de professionnels de la politique omniscients, mais dans ce qu’il faut
aujourd’hui appeler l’art de gouverner (gouvernance) pour tenter, non
pas faire disparaître les conflits, mais d’en sortir par des
compromis mutuellement avantageux de telle sorte que les acteurs soient
convaincus d’avoir été entendus et respectés. Ce
qui manque le plus au CPE , c’est le respect. Or celui-ci implique pour
le moins l’obligation d’expliquer à un employé que l’on
licencie, pourquoi on le fait, obligation bafouée par le CPE.
Cette dénégation de la simple politesse et de la
responsabilité de l’employeur vis-à-vis de son
employé est insupportable dans une société qui
veut gérer le conflit dans le sens des intérêts
mutuels et de la reconnaissance des droits de chacun.
Le CPE ne peut pas ne pas être ressenti, surtout par des jeunes
qui en veulent (comme on dit), que comme la reconnaissance d’un droit
à l’irrespect par qui est en position de force et a un pouvoir
et sa place au soleil, donc d’un droit à faire violence à
qui on peut traite avec un tel mépris, sans risque de sanction
sociale, à savoir l’employé (terme qui veut dire
littéralement: ployé sous une volonté
étrangère) afin de lui apprendre dès
l’accès au premier emploi à se soumettre sans condition.
En cela, non seulement
la méthode suivie par le gouvernement est
anti-démocratique dans son esprit, sinon dans sa lettre, mais la
décision de ce pseudo-contrat (inégalitaire) s’affirme
comme attentatoire aux droits des individus donc au fondement
même d’une société libérale et
contractuelle, dans le seul but de faire prévaloir une
conception autoritariste du pouvoir traditionnel, en l’absence d’une
tradition religieuse ou mythique suffisante pour la légitimer,
ce qui est dangereux pour la paix civile et ne peut aboutir qu’à
son échec
Quand le pouvoir en vient à pratiquer un tel autoritarisme, il
fait l’aveu de son manque d’autorité authentique,
généré pas son incapacité à discuter
avec les citoyens et les corps intermédiaires qui les
représentent et à les assurer du respect qu’il leur doit.
Ce comportement ne peut qu’attiser la violence des uns en riposte
à celle qui, au plus haut niveau, leur est faite. Cette
révolte pourrait être pour le gouvernement salutaire
à court terme , mais ce salut serait gros de risques politiques
à moyen terme pour la démocratie.
Il est temps de rappeler à chacun qu’il n’est d’autre cause
à la révolte violente que l’humiliation subie et que
faire violence à la jeunesse en la poussant à la
violence, c’est condamner l’avenir.
Le CPE,
un contrat d’indignité
Monarchie
élective ou démocratrie représentative ?
Certains commentaires à propos de mon
article précédent sur la crise de notre démocratie
contestent, au nom de la démocratie représentative, mon
analyse; ils mettent en doute le fait que la crise que nous connaissons
concerne la forme et la pratique de nos institutions. D’où la
question: la crise actuelle est-elle aussi une crise de la
Cinquième République, qui mette en cause sa
capacité à mettre en scène la démocratie et
la représentativité des forces sociales dans leur
diversité?
Pour poursuivre la réflexion initiée dans mon
article "L’Autorité
politique et la représentation démocratique" ,
plusieurs remarques de fait et de droit me semblent devoir être
faites.
1) Le droit de manifester, y compris contre une loi mal conçue, voire socialement «choquante» car inégalitaire, est reconnu par la constitution comme un droit démocratique, d’autant plus -et c’est un fait, non une opinion- que la représentativité du Parlement est aujourd’hui en crise; crise qui, dans le cas du CPE, à mon avis, tient à deux éléments factuels et de droit:
- Le non-respect de la loi Fillon qui faisait obligation au gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant toute modification du droit de travail. C’est un fait.
- La procédure du 49.3 qui soumet le législatif à l’exécutif, sauf, pour la majorité parlementaire, à désirer son propre suicide.
On
ne peut éviter, dans ces conditions, que les citoyens
considèrent alors que la représentativité du
Parlement, théoriquement législateur, n’est plus qu’une
illusion. Cette impression justifiée est un fait, comme le
montre:
2) Le suffrage majoritaire interdit une réelle représentativité des minorités, voire la prise en compte de leurs propositions; or il peut très bien être combiné par le suffrage proportionnel, comme en Allemagne, par exemple: la «grande coalition» est aussi un moyen de traiter les problèmes les plus importants avec un soutien réel de la population (je ne dis pas du peuple, qui pour moi est une notion illusoire); quant au cas anglais du scrutin majoritaire à un tour, je ne le trouve pas particulièrement démocratique, et cela ne fonctionne pas trop bien: il interdit pratiquement toute autre représentation que celle de deux grands partis, c’est un fait, et il est aussi un fait que la représentativité de T. Blair, dont j’approuve pas mal d’initiatives, est d’autant plus contestée aujourd’hui (ex: sur l’Irak et sur la réforme de l’école) qu’il peut soumettre le Parlement sans réel débat à des décisions ressenties (à tort ou à raison) comme arbitraires ou injustes.
Mon analyse critique est corroborée par la prise de position du président de la République sur le CPE ; celle-ci, en effet, rend la représentativité du Parlement et du législateur encore plus problématique: promulguer une loi (ce qui veut dire la rendre immédiatement applicable) pour l’invalider aussitôt, en fixant, hors de toute concertation, les modifications à lui apporter, c’est faire du fait du prince le ressort de la décision législative et disqualifier encore plus le rôle du Parlement et le caractère démocratique des institutions.
Nous sommes bien plus dans le cadre dans une
monarchie élective que dans celui d’une démocratie
représentative; Monsieur Jacques Chirac vient d’en faire
éclatante démonstration.
Suite à mon article, il convient de tirer un premier bilan de la situation recambolesque créée par le fait du prince qu’a été l’intervention de Jacques Chirac au sujet du CPE.
Dans un superbe tête à queue dont il a le secret notre président, après avoir court-circuité le parlement et les partenaires sociaux par le biais de son premier ministre et successeur désigné, met se dernier sur la touche (ou en reserve de la république) sans le démissionner mais en confiant au parlement et à son ennemi intime (Sarkozy), chef du parti majoritaire, le soin d’ouvrir des négociations directes avec les syndicats dont chacun sait qu’elles vont enterrer le CPE, déjà condamné à mort par sa décision de le vider de sa substance, tout en le promulgant. (Ouf!)
Les syndicats ne s’y trompent pas: il voient un boulevard s’ouvrir devant eux en vue de négocier en position de force une sécurisation des parcours professionnels pour tous les salariés, jeunes et moins jeunes. La mobilisation va donc changer d’objet et probablement de forme; ce qui aurait dû être fait au départ le sera dans un contexte de mobilisation sans précédent: la démocratie à chaud reprend ses droits.
Mais les institutions n’en sont pas moins en crise, dès lors que tout dépend des contorsions et des manoeuvres contradictoires du chef de l’état qui peut à volonté manipuler un premier ministre ou un parlement à sa guise en fonction des mouvements sociaux et/ou, comme disent certains, de la rue.
Le pays n’apparaît plus dirigé, dès lors que celui qui est le garant des équilibres politiques et du fonctionnement des institutions peut changer de ligne politique au grès des évènements: jouer le premier ministre contre les corps intermédiaires représentatifs ou jouer ceux-ci contre le gouvernement et son chef au profit de son ennemi intime. reste à celui-ci maintenant de faire ses preuves! En attendant, la crédibilité de ceux qui nous gouvernent se détériore irrésistiblement et la crise du régime s’aggrave au profit d’une direction politique à courte vue de plus en plus erratique.
Il est temps de réfléchir sur des aménagements des institutions qui prennent plus et mieux en compte le pays réel.
Quelques pistes pour ouvrir le débat:
Réforme
du mode de scrutin des députés (plus de proportionnelle)
Revalorisation
du rôle du parlement et des commissions de travail parlementaires
souvent très fécondes
Réforme
du Sénat dans le sens de celle préconisée par le
Général de Gaulle qui faisait entrer les partenaires
sociaux et les régions dans le pouvoir législatif.
Négociations
obligatoires entre les représentants des salariés, le
gouvernement et le parlement pour tout ce qui concerne les principes
fondamentaux du droit du travail et qui, pour l’essentiel, doit
être laissé, dans leurs modalités d’application,
à l’initiative des contrats négociés par branche
entre les partenaires sociaux que l’état sera chargé
d’avaliser et de garantir.
Réforme
de la représentativité syndicale, favorisant une plus
grande expression directes des salariés pour décider des
modalités d’action et une procédure et une
régulation de l’usage du droit de grêve qui oblige
à des négociations préalables avant toute
grêve.
Autant de pro-positions dont l’inspiration me
paraît ni ultra-libérale, ni étatiste monarchiste
ou social-étatiste, mais social-libérales ou, si l’on
préfère, social-démocrate en résonnance
indispensable avec les comportements politiques et sociaux de la
plupart de nos partenaires européens.
Le désir de violence est en chacun de nous ; il n’est qu’une forme du désir de puissance transformé par des conditions défavorables en désir du pouvoir instantané et inconditionnel sur les choses et les êtres en tant que source d’affirmation de soi-même gratifiante , et donc de jouissance : ce n’est pas un hasard si, dans toutes les cultures, la violence, sous telles ou telles forme est valorisée (le courage et l’honneur du guerrier, la valeur identificatoire du vainqueur...) ; elle est partout l’objet de spectacles ou d’activités sportives extrêmement populaires. Ceux-ci comme la chasse sont des dérivatifs à la guerre. Mais suffit-il de ne condamner et de ne réprimer que la violence illégale en acte pour s’en croire soi-même absout et vivre en sécurité ?
Or nous n’avons pas tous les mêmes possibilités d’exprimer ce désir de puissance dans le cadre régulé de compétitions sociales codifiées dans lesquelles les chances des uns et des autres sont ressenties (à tort ou à raison) comme égalitaire. De fait dans une société où l’inégalité des chances est acceptée comme naturelle la violence directe et physique contre ceux d’en haut est réduite (au contraire de la violence entre égaux et/ou entre les hommes et les femmes ») ; la société démocratique, contrairement à ce qu’on dit, attise la jalousie, car elle légitime la comparaison permanente entre les situations. De plus nous vivons, pour la première fois dans l’histoire, dans des sociétés en paix qui ne permettent donc pas l’expression guerrière du désir de la violence (chez les jeunes surtout pour qui l’on a même supprimé le service militaire). Si rien n’est fait dans notre société pour accroître le sentiment de l’égalité des chances et de la compétition ouverte et si aucun dérivatif civilisé suffisant au désir de violence n’est proposé alors la violence sous sa forme illégale devient quasi-irrésistible, d’autant plus qu’elle est valorisée dans la cadre de contre-sociétés alternatives valorisantes par rapport à celle, globale qui institue des modes de domination hypocrites dans un cadre social profondément inégalitaire et discriminant.
Si ce déterminisme psychologique et social d’injustice et d’humiliation latente n’implique pas nécessairement un passage à l’acte ; il est clair que on le doit à la répression institutionnelle ; en ce sens le point de vue d’un avocat général qui, pas sa fonction, ne s’attache qu’au sanctionné le caractère illégal de la violence en oubliant la violence légale est tout à la fois nécessaire et insuffisant. Nécessaire car aucune société ne peut tolérer la violence illégale généralisée indifférenciée sauf à sombrer dans le chaos et la guerre civile autodestructrice de tous contre tous et insuffisant dès lors que cette répression ne peut être interprétée par les casseurs ou délinquants que comme une violence faite à ceux qui se sentent socialement exclus ou victimes d’une injustice persistante et qui n’ont plus comme domaine d’affirmation que le repli communautariste, la défense de leur petit territoire de quartier et la haine des autres. Quant à l’éducation elle n’est efficace que si un minimum d’accord existe entre les valeurs enseignée et la réalité des comportements. Ce qui, tout le monde en convient, est loin d’être le cas : la domination en gants blancs est au cœur du fonctionnement de nos sociétés inégalitaires qui, et là est la paradoxe, se réclament de l’égalité démocratique
L’immense majorité des jeunes qui manifestent contre le CPE ns sont pas des violents, mais il est clair que ceux qui agressent indifféremment et les policiers et les jeunes manifestants pacifiques tentent de sur-vivre dans d’autres conditions et d’autres désespérances que celles de ces derniers. Leur éducation comme leur désir de reconnaissance (et les deux sont indissociables) ont été sacrifiés.
Quelle puissance leur reste-il à exprimer en l’absence de guerre contre un ennemi désigné comme commun ? Du foot (PSG) à l’auto-destruction par la drogue ou les défis extrêmes (ex : rodéos) , jusqu’à ces identités religieuses extrémistes et sexuelles d’emprunt en passant par l’expression verbalisée et rythmée du rap (ce qui est un moyen somme toute pacifique et souvent créatif) . Tout devient bon à prendre. Et aucune répression n’y changera quoi que ce soit sauf à la marge et pour les autres (dissuasion). Il seront simplement instrumentalisés en boucs émissaires de la violence sociale.
N’oublions
jamais que nul ne sait comment il aurait évolué dans les
conditions semblables à celles de jeunes en situation de
déréliction sociale et familiale quasi
totale ; même ceux qui s’en sortent disent qu’ils ont eu
beaucoup de chance..
Les propos de Monsieur Sarkozy à propos de l’amour de la
France comme critère de sélection de l’immigration
opère une confusion entre la vie privée et la vie
politique, entre le sentiment subjectif d’appartenance communautaire et
la justice. En quoi cette confusion est-elle politiquement dangereuse?
L’amour, en effet, n’est pas une
catégorie politique mais affective. On aime quelqu’un et pas
quelqu’un d’autre pour des motifs qui ne sont pas nécessairement
justes ou universels. Par contre le désir de justice implique le
respect des règles décidées
démocratiquement et des principes des droits universels (et non
pas seulement français) de l’homme fondement de notre
constitution qui sont et doivent être le seul critère
à considérer en politique.
L’amour est tout à fait autre chose:
c’est une adhésion qui ne relève que de la
subjectivité personnelle. On ne peut donc faire de l’amour un
devoir ou une règle impérative qui s’imposerait à
tous sans condition, car l’amour est par nature exclusif et non
universalisable; être juste ne consiste pas à l’être
seulement vis-à-vis de ceux que l’on aime , mais aussi
vis-à-vis de ceux que l’on n’aime pas particulièrement
,voire vis-à-vis d’adversaires plus ou moins
détestés; de plus la France est une entité
abstraite si on la sépare des français, de la
diversité des modes de vie des populations vivant en France,
mais qui ne sont pas tous nécessairement aimables. L’amour
universel abstrait ne vaut que dans une perspective religieuse utopique
dont on sait qu’elle a pu, et peut encore, dans la
réalité conduire à exterminer les
mécréants par amour et/ou au nom de l’amour de Dieu pour
sauver la vraie foi, la vraie religion et/ou la vraie France (le
patriotisme comme religion politique ou religion
sécularisée).
Ainsi le désir d’être et/ou de
devenir français n’inclut en rien que nous soyons en accord avec
la totalité de l’histoire de France et de sa culture et implique
encore moins l’idée que la France vaut pour nous plus que tout
autre pays et mérite a priori qu’on lui sacrifie les droits
universels de l’homme contre tel ou tel individus et groupes
désignés comme non-français ou d’origine
étrangère en exigeant qu’ils aiment la France, exigence
à laquelle ne sont pas soumis les français dit de souche
qui sont censés (à tort) l’aimer spontanément
Je ne dis pas que c’est le sens authentique
que Monsieur Sarkozy donne à ses propos, mais je
considère que cette expression dans la bouche d’un ministre
candidat à la plus haute fonction politique, peut prêter
à confusion et laisser libre court à cette
interprétation éthnico-xénophobe de l’amour de la
France, elle vise explicitement du reste du reste à rallier un
électorat d’extrême droite qui confond la justice avec la
pratique d’une identification "amoureuse" exclusive, globale et sans
condition au pays dans lequel les gens vivent. Ce qui est une attitude
proprement religieuse, contraire au principe même de la
laïcité.
Du reste le projet de loi sur l’immigration
ne fait en aucun cas référence à un
prétendu amour de la patrie française comme
critère de sélection de l’immigration. C’est bien la
preuve qu’il ne faut pas confondre la conscience citoyenne
intégrée (et non pas assimilée comme l’affirment
Monsieur Le Pen et Monsieur de Villiers) -qui du reste implique aussi
le droit de vote des étrangers vivant en France comme le propose
justement Monsieur Sarkozy (c’est pourquoi on ne peut identifier sa
position à celle de Monsieur Le Pen)- et une catégorie
ethno-idéologique qui n’a aucune valeur dans la pensée
juridique française de la République
le 28/04/06
Laurent Fabius et le silence du PS sur l'Europe
1) reprendre la partie 1 et 2 du TCE assortie d’une charte sociale négociée avec Angela Merkel et éliminer la partie 3 pour mieux la conserver dans les traités existants.
2) forger une économie libérale européenne plus intégrée et une défense commune. Il n’est pas question de (re)nationalisation, mais de l’exportation dans l’ensemble de l’Union de la définition d’un service public, monopole d’Etat, dont on exigerait des autres qu’il soit de type français, et dont on sait les brillantes performances chez nous. Il ne lui vient même pas à l’idée que de nombreuses entreprises d’Etat comme EDF, la SNCF, la RATP sont, sur le plan européen, des entreprises concurrentielles libérales comme les autres ; sauf qu’elles se protègent contre la concurrence étrangère sur le territoire national pour mieux attaquer ses concurrents à l’extérieur ; ce qui ne peut faire l’affaire de nos partenaires. Laurent Fabius voudrait-il élargir le monopole franco-français de ces entreprises à l’ensemble de l’espace européen, ou a-t-il l’intention de rapatrier sur le seul territoire national les activités et les capitaux, en partie publics, de ces entreprises ? Nul ne sait, et pour cause...
3) renforcer l’Eurogroupe en lui donnant pouvoir décisionnaire sur la Banque centrale sans se poser la question de savoir si l’Allemagne et d’autres partenaires seraient d’accord.
4) n’admettre les nouveaux membres qu’à la condition qu’ils aient atteint nos standards économiques, politiques et surtout sociaux, comme s’ils pouvaient le faire en quelques années en dehors de l’Union, tout en condescendant généreusement à les aider, en attendant, de l’extérieur, alors qu’ils sont déjà, de fait, totalement intégrés au marché commun.
Ce qui peut nous rassurer, c’est que le mensonge politique dans le cas de Fabius semble ne pas payer ; ce qui peut nous inquiéter, c’est le vide total de propositions du PS sur la question européenne, qui paraît faire le jeu des démagogues socio-nationalistes, voire souverainistes de tous poils.
Prétendre dépasser le clivage entre les partisans, au sein du PS, du oui et du non (dit de gauche) au TCE qui a déjà été ratifié (et continue de l’être) par la majorité des Etats de l’UE représentant la majorité des populations, est une absurdité manifeste qui masque mal une tactique qui consiste à ne pas décider pour préserver une éventuelle victoire électorale, sans savoir et que sans que l’on puisse savoir sur quel programme européen, lequel est indissociable de la politique économique et sociale chez nous.
Le TCE est devant nous, et non derrière ; le PS le sait mieux que quiconque. Prétendre le contraire c’est, à l’échelon du PS tout entier et non plus seulement de Laurent Fabius, faire acte de mensonge politique électoraliste. Laurent Fabius essaie de se fabriquer une ultime virginité en exploitant ce mensonge à son profit. Comme quoi un mensonge politicien peut toujours en générer un autre.
L’idée de peuple contre la démocratie
Très souvent, en
démocratie, les majorités électorales se
réclament du peuple souverain pour légitimer, d’une
manière définitive et absolue, les décisions
politiques; or cette vision est précisément
antidémocratique en cela qu’elle confère à une
majorité temporaire une puissance permanente et donc
anti-démocratique sur la minorité. Comment sortir de
cette contradiction apparente qui est au cœur de débat sur la
question de savoir si on a le droit démocratique de faire
revoter les citoyens sur un même texte (ex:le TCE), ou un texte
à peine remanié?
Ainsi
l’idée de peuple est une fiction politique de type
métaphysique, c’est-à-dire ne correspondant à
aucune réalité d’expérience possible. Cette
fiction rhétorique devient une illusion si on lui confère
le statut d’une vérité servant à décrire ou
à expliquer une quelconque réalité politique.
Elles n’est qu’un moyen commode de faire croire à la justesse
d’une décision pour la rendre pour un temps incontestable :
un simple moyen rhétorique nécessaire en vue de
stabiliser temporairement une ligne politique ; encore faut-il que
cette ligne et la majorité qui l’a choisie soient un minimum
cohérentes pour être interprétables ; ce qui
est à l’évidence n’est pas le cas du non au
réferendum sur le TCE qui a vu l’alliance de fait et absurde en
droit entre des adversaires de l’Europe politique et des partisans dits
de gauche d’une plus grande intégration politique et sociale, en
oubliant que le TCE ne pouvait être qu’un compromis seulement un
peu meilleur que le compromis antérieur (Traité de Nice)
entre des populations politiques et des Etats différents qui
n’ont pas vocation, pour le moment, de se fondre en un seul Etat.
Un résultat électoral (par exemple
celui d’un référendum) n’est donc qu’un épisode
politique circonstanciel qui peut être dépassé
ultérieurement, voire contredit par d’autres actes majoritaires.
Qui refuse cette fluctuation électorale rejette simplement la
démocratie au profit d’un mythe totalitaire et
liberticide : celui d’une société totalement et
définitivement unie sous la férule de décisions
prises antérieurement par une population électorale
à l’unité prétendûment sans faille,
omnisciente et disposant d’un pouvoir sans borne ; autant dire un
bloc divinisé et providentiel.
Français, encore un effort, si vous voulez être
démocrates, sinon
révolutionnaires : tuez l’idée
pseudo-républicaine de "peuple uni de droit divin". La fiction
de Dieu est politiquement morte chez nous, reste à assassiner
celle de "Peuple-dieu de la politique" qui n’a fait que
séculariser l’idée de "monarchie de droit divin" aux
dépens de celle de démocratie vivante.
PS : J’ai fait volontairement court pour
mieux lancer le débat ; pour approfondir cette analyse
critique, vous pouvez vous reporter aux deux articles suivants :
De nombreux commentateurs politiques de gauche n’acceptent pas la notion de social-nationalisme pour caractériser l’opposition de la gauche française au libéralisme, dès lors que, pour eux, elle se confond avec celle de national-socialisme de type fasciste ou nazi. Or, à l’inverse de tous les partis socio-démocrates européens, le PS français, indiscutablement démocratique, continue à maintenir la vision, quand il est dans l’opposition, que recouvre ce terme pour ses adversaires. Comment comprendre ce paradoxe ?
Essayons pour ce faire de clarifier cette appellation : au sens
général elle vise la croyance qu’il y aurait des
solutions purement nationales au problèmes économiques,
sociaux et politiques français.
1) Sur la plan
économique
Cette vision fait abstraction du fait que nous
sommes dans un monde dans lequel l’idée même
d’économie nationale protégée et auto-suffisante
n’a plus de sens, sauf
2) Sur le plan
social, est exigé par le social-nationalisme
- que l’état garantisse
à tous les salariés un emploi à vie une
progression continue du pouvoir d’achat des salaires en même
temps qu’une réduction du temps de travail et des retraites et
des soins médicaux qui ne soient soumis à aucune
contrainte financière.
- que la capital privé soit imposé
de telle sorte que la couverture financière des coûts
sociaux de ces garanties soit toujours suffisantes.
- le maintien en un état stable de la
société française dans sa culture (comme chacun
sait exceptionnelle) et le sentiment de son éternelle
identité identificatoire nationale symbolique et dans sa
variante extrême de son ethnicité exclusive de tout
mélange (pureté originelle fondatrice)
3) Sur la plan
politique.
Un tel nationalisme "social" supposerait
logiquement
- donc non
seulement la fin du capitalisme transnationalisé mais aussi la
fin de la démocratie libérale.
Or, heureusement, sauf pour une infime
minorité hors jeu, aucun tenant de cette vision ne
déclare vouloir instaurer un état totalitaire de type
national-socialiste fasciste ou socialiste
« purement » national, négateur des
libertés fondamentales et tous se réclament de la
démocratie pluralistes. Il y a là une contradiction
interne : Comment établir un tel programme
économique et social sans révolution politique
nécessairement violente (guerre civile) et donc
répressive des libertés publiques ?
Mystère : les tenants de cette vision se contente à
nous faire croire que tout cela peut, comme par magie, se faire sans
violence et sans mettre en cause les libertés politiques et
publiques.
le 22/06/06
Libéralisme, social-étatisme et hyper-capitalisme
Le langage politique est
aujourd’hui pipé en France: tous les responsables font chorus
pour dénoncer le libéralisme qui serait, selon leur
propos, responsable de la mise à l’écart ou de
l’affaiblissement de la politique par rapport aux intérêts
économiques capitalistes dominants, mais aucun n’ose affirmer
qu’il voudrait étatiser l’économie et remplacer
l’économie concurrentielle de marché par un monopole
d’Etat. Comment comprendre cette étrange contradiction?
On sait qu’au XVIIIe siècle les penseurs libéraux dont Montesquieu avaient fait de la question de la séparation des pouvoirs une question centrale dans la lutte contre le despotisme politique. À cette époque l’économie n’avait pas, aux yeux de beaucoup (saufs chez les philosophes anglo-saxons), la même importance politique qu’aujourd’hui ; c’étaient les questions de la guerre, de la religion et du pouvoir régalien, républicain et/ou monarchique , qui déterminaient la sphère d’intervention propre du politique et sa limitation pour préserver la liberté dite naturelle ou civile des individus-citoyens (pouvoir du roi sur ses sujets et ses limites) ) qui étaient au centre du débat politique, de nos jours, par contre, c’est l’économie qui est au centre des questions de sociétés dans les sociétés libérales individualistes et, pour tout ce qui concerne la vie privée, le libéralisme marchand et les relations contractuelles ont pris le pas, comme l’avait remarqué Marx, sur les types de relations d’allégeance et de hiérarchie traditionnelles.
C’est ainsi que la vie économique est devenue une préoccupation majeure de la vie politique, comme on peut le voir dans tous les discours et débats politiques actuels, y compris sur ce forum. Dans une société libérale moderne (non despotique) il faut donc introduire une nouvelle séparation des pouvoirs, négligée par les penseurs non anglo-saxons du XVIIIe, afin de faire échec au risque de despotisme surtout dans sa forme extrême, le totalitarisme : outre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, il convient de séparer le pouvoir économique. Le pouvoir plus ou moins fragmenté (mais de moins en moins) des décideurs économiques et pouvoir politique plus ou moins centralisé à l’échelon national ou transnational. Pourquoi ?
Parce que, si l’on abolit cette séparation, comme le veulent les anti-libéraux de droite ou de gauche qui voudraient peu ou prou étatiser l’économie ou faire de la politique un simple instrument de l’économie on obtiendrait une nouvelle forme de despotisme encore plus puissante que celle du despotisme politico-religieux décrit par Montesquieu : le despotisme d’un Etat que l’on peut appeler totalitaire dans la mesure où les mêmes hommes disposent à la fois des deux pouvoirs et dans lequel le pouvoir politique, fusionné avec le pouvoir économique, ne peut plus réguler ce dernier ni le limiter et encore moins le contrôler, car il devient juge et partie, de deux choses l’une en effet :
soit le pouvoir politique est extérieur (séparé)
au pouvoir économique pour lui imposer des règles au
regard de l’intérêt général et de la
protection des libertés individuelles par exemple dans le
domaine essentiel de la vie privée qu’est devenue la
consommation
soit il lui est
consubstantiel et alors il n’y a plus aucune limite à sa
puissance de décision et il va s’arroger le rôle de
gestionnaire planificateur de la vie privée des individus pour
leur imposer des choix économiques qui leur interdiraient de
mener leur consommation privée à leur guise et de faire
jouer le concurrence à leur avantage ; comme on a pu le
voir dans toutes les économies étatisées.
C’est dire qu’il est aujourd’hui indispensable de tenir séparer les deux pouvoirs encore plus que ce n’est le cas aujourd’hui si l’on veut éviter la corruption, le népotisme de ceux qui cumulent pouvoir politique et le pouvoir économique, la bureaucratie aveugle et sourde aux désirs des individus, ou la nuisance de quasi-monopoles qui s’accaparent des marges de profit iniques au regard des services qu’ils rendent. Bref, si l’on ne veut pas supprimer les libertés individuelles d’entreprendre et de choisir dans le domaine la production et de la consommation et surtout si l’on veut que l’Etat régule au service des libertés individuelles comme d’un intérêt général toujours en débat, la vie économique elle-même, il faut donc que le pouvoir de l’Etat soit séparé de celui de l’économie pour qu’il puisse limiter celui des décideurs économiques, en particulier des plus puissants d’entre eux, ceux qui disposent du capital financier, qui ont toujours tendance à s’organiser, contre les consommateurs, pour mettre hors jeu la concurrence et compromettre leur liberté économique, celle qui justifie celle des investisseurs-producteurs, comme nous le rappelle sans cesse A. Smith.
Telle est la thèse libérale. Il ne suffit pas quoi de recopier des positions et des analyses valant pour un autre âge, il faut les réinterpréter en les adaptant à notre temps. L’échec catastrophique, liberticide et criminel des pays ex-socialistes doit nous servir de leçon pour revenir aux sources du libéralisme et en tirer des enseignements progressistes nouveaux pour le monde dans lequel nous vivons. Il faut ainsi lutter sur deux fronts : contre la vision sociale-étatiste ou sociale-nationaliste et contre l’ultra-capitalisme despotique (anti-libéral) car tous deux, au fond, sont animés de la même volonté, manifeste ou pas : détruire le rôle régulateur de la politique au profit d’une économie liberticide de monopole, soit en faisant de la politique (étatiste ou non) la source de l’économie, soit en affaiblissant l’exigence de régulation sociale, en faisant de la politique un simple instrument de puissance centralisée au service des intérêts économiques généraux dominants des investisseurs capitalistes.
Le libéralisme authentique vise, au contraire, à élargir l’autonomie réelle de chacun et ses possibilités de développement personnel dans un cadre sociétal plus juste en coupant l’omelette politique sur les deux bords : l’ultra-capitalisme inégalitariste et monopoliste d’un côté et le social-étatisme totalitaire de l’autre qui sont deux ennemis des libertés concrètes de tous les citoyens et qui, nous le savons, peuvent tout à fait fusionner comme dans certains pays d’Extrême-Orient.
J’ai tout à fait conscience que cette mise
au point fait rupture avec les slogans anti-libéraux repris par
la classe politique franco-française et particulièrement
de certains responsables du PS, seuls de ce bord en Europe à les
tenir. Il y a un paradoxe particulier à la France :
voilà un pays qui est un des plus ultra-capitalistes d’Europe et
des plus ouverts sur l’économie financière mondiale et
cela avec l’aval des hommes politiques de tous bords, mais dont les
responsables n’hésitent pas à disqualifier le
libéralisme au nom d’un mythique « patriotisme
économique » qu’ils ont contribué avec raison
à abattre sous le prétexte fallacieux qu’il serait
l’anti-chambre de l’ultra-capitalisme. Quand sortiront-ils de cette
contradiction pour mettre leur discours en relation avec leur pratique
et affirmer que le libéralisme régulé est notre
avenir et le meilleur antidote qui soit contre
l’ultra-capitalisme ? Ce paradoxe est au centre de la crise
politique de notre pays et de la méfiance des citoyens
vis-à-vis de leurs responsables, tous partis de gouvernement
confondus.
Le 07/07/06
L’idée de
démocratie apparaît contradictoire, ou en tout cas suppose
réunies des conditions de possibilité irréalistes.
En quoi?
1) Le peuple est spontanément une multitude
nécessairement désunie et divisée en conflits de
valeurs et d’intérêts incompatibles : les riches
contre les pauvres, les dominants contre les dominés
clivés selon une hiérarchie nécessaire à
tout ordre social spontané, les croyants et les non-croyants,
les puissants et les faibles, etc.
2) Le peuple est formé dans sa
majorité d’ignorants de la chose publique et des exigences
qu’elle implique, et ne peut, de ce fait, être raisonnable, en
cela que les opinions qui s’opposent entre elles, en son sein, sont
toujours particulières, et donc passionnelles, et aveugles
à l’intérêt général et au long terme,
ou pire, se prétendent seules conformes à un
intérêt général contre les autres, rendant
celui-ci introuvable.
3) Ce peuple, qui en tant que tel n’existe
pas, ne peut se réunir en un seul corps pacifique ou
pacifié, et donc se mettre à exister, que sous la
contrainte d’un pouvoir unificateur, et il est contradictoire de faire
que ce pouvoir puisse exercer cette autorité unificatrice
indispensable et, dans le même temps, être soumis à
la multiplicité changeante des opinions et à la
contestation permanente de cette autorité par des gens qui
prétendent dénier cette autorité en la
contrôlant et en la soumettant à leurs revendications
contradictoires et fluctuantes. Sans transcendance d’un pouvoir
autonome fort, il ne peut exister de corps politique ordonné, et
encore moins de souveraineté populaire.
Cette vision de la démocratie a donc
conduit nombre de philosophes à en contester l’idée
même, en la présentant comme la forme la plus
extrême de la tyrannie (Platon), soit de tous contre tous
(anarchie violente), soit sous la forme du despotisme d’un chef
suffisamment charismatique pour diriger les dominés en leur
faisant croire, par identification à sa personne, qu’il est
l’expression même des passions collectives religieuses, ou
politiques pseudo-spontanées qu’il suscite et exploite
(ex : nationalisme exclusif et exacerbé, ainsi que toutes
les formes de ce que l’on appelle aujourd’hui le populisme
démagogique, ou de la flatterie politique). Rousseau
lui-même ne disait-il pas dans son Contrat social que
la démocratie ne peut valoir que pour des dieux parfaits et
parfaitement unis car totalement raisonnables (sans passion), et non
pour des hommes ? De même Kant affirme-t-il que la
démocratie tend à fusionner les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, ce qui est la marque
du despotisme liberticide. Sans vertu des citoyens, pas de
démocratie possible, avait déjà averti
Montesquieu. Hegel rend responsable l’idée de démocratie
directe qui pose les droits subjectifs des citoyens (droits de l’homme
et du citoyen) comme fondement des droits objectifs (collectifs) de la
terreur révolutionnaire. Donc, la démocratie serait le
pire des régimes possibles et, au pire, absence de tout
régime politique et de toute vie civique pacifiée, car
cause originelle de désordres et de violences
généralisés et indifférenciés
(état de nature comme état de guerre).
2) Sauf à prendre ce principe pour une
réalité, donc à transformer cette fiction en
illusion, un tel principe suppose que des spécialistes de la
chose publique élus par la majorité soient chargés
de représenter les citoyens afin de définir une ligne
politique majoritaire cohérente, et de la faire appliquer par
d’autres spécialistes formés à interpréter
la loi et à sanctionner les citoyens qui la violeraient.
3) La démocratie réelle ne peut
être qu’indirecte, et en cela organiser, de quelque façon
que ce soit, la délégation du pouvoir théorique
des citoyens en démocratie au profit d’une minorité de
gouvernants ou de responsables politiques qui décident à
leur place, sous la réserve toutefois de se faire
éventuellement chasser du pouvoir aux élections
suivantes, si la majorité change et s’ils n’ont pas satisfait
aux attentes, même confuses, de leurs électeurs. Autant
dire que la démocratie pure, qui serait considérée
comme réalisable, ne peut être qu’une illusion, et que, si
on veut éviter qu’elle ne le soit, il convient de la limiter
à la démocratie dite indirecte, c’est-à-dire au
pouvoir autonome temporaire (mais pas indépendant) des
responsables majoritairement élus sur les citoyens.
Mais ce pouvoir démocratique indirect
lui-même n’est légitime que s’il prétend se fonder
sur l’idée de souveraineté populaire, et si les
représentants gouvernants se disent au service de tous les
citoyens-électeurs, non seulement de ceux qui les ont
élus mais aussi de ceux qui n’ont pas voté pour eux.
Ainsi les dirigeants démocratiques doivent nécessairement
se soumettre au droit qu’ont les citoyens de critiquer leur action,
voire de résister pacifiquement et publiquement à tel ou
tel projet de loi qui serait jugé contestable par telle ou telle
fraction d’entre eux, majoritaire ou non. Les représentants
élus doivent donc à la fois diriger les citoyens,
décider pour eux, et leur donner le sentiment qu’ils sont
dirigés par eux. La démocratie indirecte ne serait donc
une réalité (une non illusion) qu’au prix d’une
contradiction latente, alors que la pure démocratie, seule
cohérente dans son concept, serait une pure illusion, si on
voulait l’appliquer réellement. Comment sortir de ce paradoxe,
tout en préservant l’idée démocratique comme
principe politique régulateur, dès lors que tout autre
est dépourvu de légitimité, dans un cadre
laïque qui sépare la politique du religieux et les
dirigeants de tout pouvoir divin transcendant (extérieur et
supérieur) ?
Une seule réponse est possible :
il faut améliorer le fonctionnement de la démocratie
indirecte, en faisant participer les citoyens au débat politique
raisonné, sachant que les choix à faire sont toujours des
paris incertains sur l’avenir, et qu’ils peuvent échouer, non
seulement par la faute des dirigeants, ce qui serait un problème
relativement facile à traiter, mais par la résistance du
réel et des rapports de forces sociales qui n’ont pas
été suffisamment pris en compte dans la définition
des objectifs et des programmes.
Un choix politique est toujours celui d’un
moindre mal, et la définition de celui-ci peut évoluer.
Une majorité peut en remplacer une autre, et les gouvernants le
savent : l’arbitraire de leur pouvoir est limité, et non
pas supprimé par le pouvoir de voter des citoyens.
Le 04/09/06
Chronique d’un retour annoncé du TCE
Beaucoup pensent, encore aujourd’hui en France, qu’il suffisait que seule la France et la Hollande, parmi 27 pays européens, refusent le traité constitutionnel européen, plus traité international du reste que constitution, pour que les autres pays qui l’ont ratifié (18 à ce jour sur 27) soient contraints sans condition de l’abandonner à jamais.
Or la "démocratie européenne" ne
semble pas l’entendre de cette oreille
Ainsi à l’initiative de l’Espagne et du
Luxembourg qui ont ratifié le TCE par référendum
(procédure interdite par la loi constitutionnelle en Allemagne)
les pays qui ont ratifié le TCE sont invités le 26
janvier à Madrid pour s’entendre sur les moyens de ranimer le
TCE et la construction politique de l’Europe en panne du fait des refus
français et néerlandais . "Nous pensons, a
déclaré M. Juncker, premier ministre du Luxembourg,
que ceux qui ont ratifié le traité ont le droit de
s’exprimer haut et fort." Mme Merkel, future présidente de
l’UE, n’est pas en reste : elle insiste pour qu’un compromis,
respectant l’essentiel de l’esprit et des mesures du TCE, soit
rapidement trouvé pour que l’impasse actuelle dans une Europe
à 27 soit précisément dépassée.
"Tout le public européen est sous l’influence de ceux qui ont
dit non. Nous devons redonner leur dignité aux
arguments de ceux qui ont dit oui", a-t-elle affirmé.
Elle propose donc de réunir sous sa présidence les pays
qui ont voté non ou qui n’ont pas encore
ratifié le traité et de se réunir en
février pour leur faire prendre position sur la suite du
processus.
Cette volonté ferme de la majorité des pays européens ne peut pas ne pas obliger les candidats aux élections présidentielles en France à prendre une position claire sur les suites à donner à son refus du 29 mai. Qu’en est-il aujourd’hui de la position des différents candidats sur ce thème ?
Pour la droite et l’extrême droite souverainiste, c’est clair : il refuse l’Europe politique dans son ensemble et sont prêts à remettre en cause l’ensemble des traités européens depuis le début, et en particulier celui de Maastricht qui a promu l’euro comme monnaie commune.
Le ou les candidat(s) de l’UMP, à commencer par Nicolas Sarkozy, se prononce(nt) pour une reprise rapide des première et seconde parties du TCE, renvoyant la troisième et la quatrième aux traités antérieurs toujours valides. Nicolas Sarkozy semble privilégier la voie technique permise par le traité de Nice dite "des passerelles" qui permet une simple modification de ce dernier et une ratification rapide par le congrès (Assemblée nationale et Sénat réunis) ; il refuse, jusqu’à nouvel ordre (et, particulièrement avec lui, les retournements sont toujours possibles) un nouveau référendum dont l’initiative du reste appartiendra au seul futur président de la République et il espère, à l’évidence, que ce sera lui.
François Bayrou, lui, ne cache pas sa volonté de voir la France revenir sur un refus, en vue de construire une Europe plus fédérale et politiquement intégrée encore que celle d’aujourd’hui.
Ségolène Royal, elle, parle de "l’Europe par la preuve", qui devra avant toute décision institutionnelle faire la démonstration que l’Europe est nécessaire aux espoirs de bien-être des Français , en particulier en développant des projets européens dans trois domaines prioritaires : l’écologie, la recherche et la formation, et l’énergie. Ce n’est, selon elle, que sur fond de décisions concrètes engageant clairement l’avenir qu’un nouveau traité à renégocier pourra être proposé aux vote des Français . Ces projets à l’évidence mettent en cause le statut de la BCE à qui on devrait ajouter à sa finalité unique (lutte contre l’inflation) celle de la croissance durable et qui ne devrait plus être aussi indépendante vis-à-vis de la politique économique et sociale des gouvernements et parlements européens. Mais ils mettent aussi en cause l’actuel budget européen qui devra être augmenté et réorienté (quid de la Pac ?)
Enfin la gauche de la gauche vient, ce qui était tout à fait prévisible, d’exploser : pas de candidat commun possible, sauf rabibochage de dernière minute, lequel ne réglerait en rien le problème principal, à savoir que le PC ne peut pas se couper du PS sauf à se suicider, car il n’existe plus que par ses élus, alors que les autres ne veulent en aucun cas gouverner ni passer compromis politique avec le PS. De ce point de vue, les différents mouvements trotskystes sont cohérents : ils veulent la révolution de la phrase ou de la tribune, en attendant un grand soir miraculeux, et donc s’interdisent par principe de se compromettre avec aucune force possible de gouvernement dans le cadre actuel de la démocratie institutionnelle.
La position du non de la gauche de la gauche divisée sur la suite est donc parfaitement stérile et peut faire le jeu de Le Pen du fait d’un recentrage rhétorique de ce dernier sur des positions sociales/nationales.
Il faut donc reconnaître que les partisans du oui au TCE, en Europe et en France, qui veulent gouverner, ont de très bonnes raisons de penser que le non à l’économie de marché libre et non faussé (donc pour une économie non libre et faussée) sont sans avenir prévisible et qu’il est temps de mettre les choses au point. Mais nos partenaires s’inquiètent probablement que les deux principaux candidats aux élections présidentielles qui semblent devoir l’emporter, dont il faut rappeler qu’ils étaient partisans du oui en mai 2005 (ainsi que François Bayrou qui lui a le mérite de rester clair sur ce point), ne mettent pas sur le devant de la scène la question européenne et la reprise nécessaire du TCE, et fassent encore croire aux Français qu’ils pourraient encore se vouloir européens en exigeant des autres qu’ils capitulent devant non pas leur volonté positive mais devant leur absence de proposition alterne cohérente.
La majorité du non, en effet, n’est faite que de l’addition du non souverainiste anti-européen et de ceux qui, à la gauche de la gauche, exigent une constitution "socialiste" plus politiquement intégrée encore. Cela, à moins de penser que les deux courants ne se rejoignent dans un même mouvement social-nationaliste (et en effet certains n’hésitent pas, on l’a vu sur AV, à franchir ce pas), ne fait pas une ligne politique majoritaire. Je pense que nos partenaires le savent, et qu’ils veulent nous mettre au pied du mur. Et je pense qu’à leur place, nous ferions de même.
La résurrection du TCE parce que,
après comme avant le 29 mai 2005, celui-ci est une
nécessité pour réguler la mondialisation, s’impose
donc comme une réalité incontournable contre tous les
rêves nationalistes obsolètes.
Le 21/12/06
De la crise de la représentation démocratique
Si
l’on admet que la démocratie organise le pouvoir des citoyens
ordinaires sur la vie et sur le fonctionnement des institutions
précisément politiques, un tel pouvoir est pour le moins
aporétique.
Ainsi la démocratie idéale ne peut être qu’une fiction, sauf sous la forme d’une théocratie élective, mais celle-ci à son tour a besoin qu’on croie que les représentants du peuple sont le peuple et que les gouvernants sont soumis aux gouvernés, ne serait-ce que négativement pour garantir la légitimité de leur pouvoir sur les citoyens.
Cette aporie de la démocratie retournée en contre-démocratie s’exprime à travers une situation de crise permanente : la crise de la représentation.
La crise permanente de la représentation contre la démocratie
Si l’on admet que, dans une société complexe et pluraliste, dans laquelle les intérêts particuliers, voire les valeurs de référence et leur hiérarchie sont contradictoires, et dans laquelle les problèmes politiques exigent un savoir (politique et juridique) et un savoir-faire spécialisé pour décider de ce qui est nécessaire au développement, voire à la survie de la société et à la définition et à la réalisation de ce qu’il est convenu d’appeler l’intérêt général (à défaut d’intérêt commun introuvable), il est indispensable d’établir des formes de démocratie indirecte dans lesquelles les citoyens -qui spontanément ne forment pas un peuple uni- doivent se sentir représentés sans que les représentants soient de simples miroirs des positions contradictoires et particulières, voire passionnelles, de leurs électeurs. L’idée de représention politique ne va donc pas de soi. Elle met paradoxalement en oeuvre plusieurs exigences hétérogènes, voire en conflit :
1) celle de rendre présent sur le plan de la décision politique la position des électeurs-citoyens, ce qui signifie que les représentants doivent être leurs porte-parole et refléter leur aspirations et désirs et les valeurs contradictoires qu’ils manifestent.
2) Celle de décider à la place des citoyens électeurs -car ils sont incapables de le faire eux-mêmes- de ce qui est bon pour la société tout entière par-delà les valeurs et intérêts particuliers que ceux-ci ressentent comme importants pour eux. D’où un décalage, voire un conflit latent, irréductible entre les représentants et les représentés, entre ceux qui sont des responsables politiques et doivent en ce sens répondre, c’est-à-dire trouver des réponses efficaces, cohérentes et réalistes aux aspirations et problèmes que soulèvent leurs électeurs et les électeurs qui sont hors des contraintes réelles et, de leur point de vue, nécessairement particulier, inaptes à décider de ce qui vaut pour tous.
C’est pourquoi la démocratie a toujours hésité entre deux formes de légitimité :
- celle qui fait de la décision directe des électeurs, appelée décision ou souveraineté populaire, la seule forme de démocratie authentique
-celle qui voit dans celle-ci un danger, soit de dissolution de la responsabilité politique et de tout l’ordre politique, qui fait de la démocratie l’antichambre de l’anarchie plus ou moins violente, soit celle d’emballement passionnel au service de démagogues populistes qui deviennent alors capables de se faire plébisciter en vue d’imposer, au nom d’une majorité manipulée et manipulable, une forme de dictature qui abolirait les conditions même de la démocratie pluraliste.
Cette opposition sur l’idée de légitimité au sein de la démocratie s’exprime au plus haut point à propos de la procédure du référendum qui, selon ses partisans, aurait à elle seule valeur constitutionnelle, au contraire du vote parlementaire. En France, la constitution, depuis 1962, admet les deux procédures, et laisse le choix de la procédure au président de la République lui-même issu du suffrage direct. En Allemagne, après l’expérience de 1933, par contre, la procédure référendaire est interdite, en tant que procédure délibérative, par la loi fondamentale, comme une porte ouverte à la démagogie, voire à la dictature populiste ou totalitaire contre la démocratie délibérative pluraliste.
Cette déchirure de la démocratie en son fondement reflète l’ambiguïté même de l’idée de représentativité politique.
Toute représentation politique démocratique, en effet, est transformation de ce qu’elle représente, en ce sens qu’elle déplace dans l’espace d’un jeu théâtral réglé et dans un langage de raison et de dialogue pacifique et pacifiant, sous forme de débat démocratique argumenté, les confits passionnels de la vie politique et sociale, parfois violents ou toujours tentés par la violence. Rappelons quelques-unes de ces règles qui mettent en scène cette tension de la représentativité :
la règle qui exige que la majorité décide et qu’une minorité obéisse ou se soumette, alors même que celle-ci considère que la décision est injuste ou illégitime de son point de vue, mais cette règle, dans le même temps, oblige la majorité à supporter la critique d’une minorité, voire à supporter des manifestations de rue (en principe non violentes), qui visent à délégitimer cette décision auprès des citoyens pour prendre sa place à la faveur de nouvelles élections afin de la changer.
La règle qui exige que les représentants soient par la médiation de leur parti marqués comme étant dans la majorité ou dans l’opposition pour exprimer clairement les conflits politiques en présence dans l’électorat (par exemple, entre la droite et la gauche, ou entre la conservation et le progrès social), mais aussi celle qui exige de ces représentants de représenter l’intérêt général par-delà les clivages d’intérêt et de valeurs particuliers qui s’incarnent dans la politique des partis, majoritaires ou minoritaires.
La règle qui exige de lutter contre des adversaires politiques pour les vaincre, à savoir les décrédibiliser auprès des électeurs comme mauvais représentants, et en même temps de les respecter, de les reconnaître comme légitimes en tant que représentants .
De plus la règle démocratique moderne est en droit individualiste, c’est-à-dire exige que chaque électeur représenté et chaque représentant se prononce en son âme et conscience sans se soumettre à quelque autorité collective ou institutionnelle supérieure (exemple : vote à bulletins secrets pour les représentés ), mais un représentant représente tout à la fois son groupe et/ou son parti et ses électeurs, sans perdre pour autant son droit à se prononcer contre son groupe, voire contre ce qu’il estime être la majorité de ses électeurs, et cela publiquement, c’est-à-dire hors de tout secret, ce qui limite du même coup sa capacité personnelle de décision (discipline collective ou partisane). La représentation démocratique implique donc, chez les représentants, une position holiste anti-individualiste, peu ou prou en tension sinon en conflit avec la règle de la démocratie individualiste. Chaque représentant représente à la fois ses électeurs dans sa personne et en tant que personne est libre de décider par lui-même de ce qui concerne l’idée qu’il se fait de l’intérêt général (de la société tout entière) et dans la fidélité indispensable au parti qui l’a fait élire et lui confère le pouvoir de représenter qui est le sien, ce qui ne va pas nécessairement de soi.
Ces règles ambivalentes sont, sinon impossibles à respecter, au moins non seulement difficiles à mettre en oeuvre par les représentants, mais surtout à faire accepter aux représentés comme conditions nécessaires de la démocratie représentative, d’où la tentation de refuser l’idée même de représentation, d’autant plus que s’approfondit la crise sociale et se perd de vue, du fait de l’aggravation des inégalités, l’idée même d’un intérêt général indissociable de l’idée démocratique qui exige de respecter ces règles. La porte est alors ouverte aux aventures totalitaires de l’extrême droite et de l’extrême gauche, souvent objectivement alliées contre la démocratie libérale.
La question se pose alors de savoir quel usage il
convient de faire de l’idée de représentation
démocratique de telle sorte que ces ambivalences ne soient
pas destructrices du jeu démocratique, mais, au contraire,
source de son évolution vivante et de son adaptabilité
à l’expression citoyenne raisonnable et raisonnée.
Du bon usage de l’idée démocratique
On
peut distinguer avec P. Rosanvallon plusieurs usages de la
démocratie. Le premier et le plus décisif est la
démocratie représentative (indirecte), le second est
l’usage direct (référendum), le troisième est
l’usage délibérant, le quatrième est l’usage
participatif et enfin le cinquième est l’usage purement
contestataire de toute forme de représentation indirecte, voire
anti-institutionnel et anti-étatique donc anarchisant que cet
auteur appelle contre-démocratie.
Mais il y a une
autre raison plus profonde de cette crise de la représentation
inhérente à la procédure même de la
représentation : celle qui oblige les représentants
à se dégager des passions collectives
particulières pour gouverner dans un sens favorable à la
justice "par-dessus les factions et les partis" en vue d’un
hypothétique intérêt général,
lui-même objet d’une mise en cause permanente sous l’effet des
représentations contradictoires de celui-ci du fait des
inégalités sociales, contradiction aggravée par le
jeu des partis politiques. Dans ces conditions, comme nous l’avons
signalé, la procédure de la représentation est
toujours menacée de détournement au profit d’une couche
politique ayant des intérêts de pouvoir propres ; un
tel détournement peut conduire les citoyens à se
détourner à leur tour de la vie politique, voire à
contester plus ou moins violemment l’idée même de
représentativité au profit d’une contre-démocratie
de la rue qui, dans les cas d’extrême détresse politique
et sociale et sous l’influence charismatique de chefs dotés de
pouvoirs unificateurs transcendants qui exploitent cette
détresse, peut conduire à l’antidémocratie
"populiste" peu ou prou totalitaire.
La
contre-démocratie ne peut donc être que l’expression de
cette crise et en aucun cas un usage réparateur de l’idée
démocratique , puisqu’il a pour effet, sinon toujours comme but,
de mettre en cause la possibilité d’une représentation
indirecte au profit d’une expression directe et collective
spontanée des demandes sociales disparates toujours
passionnelles, voire haineuses vis-à-vis des procédures
démocratiques elles-mêmes (ex : élection,
piège à cons !).
Pour sortir de
cette impasse, Rosanvallon propose de développer les
médiations discursives entre les citoyens et les
représentants en instituant des instances du débat public
raisonné dans lesquelles experts de différentes options
permettraient aux citoyens de prendre conscience des termes des
débats sociaux et de leurs enjeux en les associant aux
débats. On peut citer l’exemple de la commission parlementaire
mise en place après le procès d’Outreau pour faire des
propositions en vue de rendre la Justice plus juste. On peut aussi se
référer aux comités de bio-éthiques,
national et locaux, etc. Mais la pratique des partis politique et des
syndicats devrait aller dans ce sens pour renforcer l’idée
démocratique et limiter le risque de voir la réaction
contre-démocratique se transformer en refus violent de la
démocratie.
Cette idée de démocratie délibérante et discursive, interne et externe aux partis politiques, semble trouver une inscription dans celle de démocratie participative, qu’aujourd’hui, sous l’influence de Ségolène Royal, le PS tente de mettre en place sous le couvert de débats et de "jurys" - ou réunions - participatifs de citoyens . Il est encore trop tôt pour évaluer cette tentative, mais retenons qu’elle a le mérite de prendre en compte la réalité de la crise de la représentation et de l’idée de démocratie que nous venons d’esquisser . "Ne pas promettre ce que l’on n’est pas certain de tenir" est une règle indispensable de la démocratie vivante, ce qui implique prendre la mesure de la limite du pouvoir politique national dans le monde ouvert qui est le nôtre, sans renoncer à changer ici et dans le monde, via l’Europe politique, ce qui peut l’être en est la condition nécessaire ; cela veut dire qu’il faut privilégier une optique plus pragmatique que convictionnelle ou idéologique de la vie politique.
À la crise plus ou moins permanente de l’idée démocratique et pour éviter les illusions mortelles qu’elle génère (pouvoir unique du peuple sur le peuple, par le peuple et pour le peuple ) une seule réponse est possible : il faut améliorer le fonctionnement de la démocratie indirecte en faisant participer les citoyens au débat politique raisonné, sachant que les choix à faire sont toujours des paris incertains sur l’avenir et qu’ils peuvent échouer non seulement par la faute des dirigeants, ce qui serait un problème relativement facile à traiter, mais aussi par la résistance du réel et des rapports de forces sociales qui n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le définition des objectifs et des programmes.
Il y a deux visions philosophiques de la politique, celle que l’on peut attribuer à Platon qui voit dans une élite qui connaît a priori ce qui relève du Bien en soi ou bien commun (les philosophes), et cela contre les opinions spontanées de la foule, nécessairement particulières et illusoires , la source exclusive du pouvoir juste (rationnel et raisonnable), et celle d’Aristote qui considère qu’il n’y a pas de Bien en soi, ni même de vérité exclusive possible en politique, dans ces conditions toute opinion argumentée et rationalisée participe d’une justesse politique à construire par un examen critique afin déterminer ce qui est conforme à l’intérêt du plus grand nombre et ce qui convient, à savoir ce qui est à la fois souhaitable et possible dans telle ou telle situation concrète complexe. La seconde position est seule démocratique et elle suppose un débat public permanent raisonné et correctif pour décider de ce qui est convenable.
Ségolène
Royal paraît engager son action en ce sens, au contraire de
Nicolas Sarkozy qui tente de remythifier la vie politique autour d’une
image charismatique classiquement "salique" du chef viril
incontestable, sinon incontesté. Il m’apparaît donc
raisonnable de soutenir l’expérimentation politique de la
candidate du PS, sans illusion excessive, car sa démarche
n’écarte pas, même si elle essaie de le limiter, le risque
de populisme contre-démocratique ; mais cette prise de
risque est inhérente pour qui cherche à redonner vie
à l’idée démocratique ; il est plus que temps
de changer le rapport des citoyens et des citoyennes à la
politique et à leur représentants dans le sens d’une plus
grande participation citoyenne à l’action publique pour
éviter le pire : le refus extrémiste, de gauche ou
de droite, de la démocratie.
François Bayrou, le centrisme ou l'illusion religieuse en
politique
Tout le pari
politique de F. Bayrou, repose sur une triple croyance. Or rien ne
permet d'affirmer que ces croyances ne soient pas des illusions et que
son pari politique ne repose(asse) pas sur des
présuppositions tout à fait irréalistes. Je
voudrais ici exposer les arguments forts ce qui me semble pouvoir les
invalider. (FN est François Bayrou, SR est
Ségolène Royal, NS est Nicolas Sarkosy et JMLP est
Jean-Marie Le Pen)
- La première croyance est que FB pourrait être élu
seul contre les deux autres partis de gouvernement (en excluant JMLP
avec qui personne ne peut faire alliance sans se compromettre
définitivement en France et en Europe), sans s'allier donc sur
un programme politique qui ne serait plus tout à fait le sien
avec l'un ou l'autre des formations de droite ou de gauche de
gouvernement; et ainsi qu'il pourrait ne pas avoir à choisir en
conséquence entre le centre droit et le centre gauche, selon son
adversaire au deuxième tour; ce qui me semble totalement
irréaliste. Toute alliance suppose, en effet,
négociation, et donc la reformulation du programme ou projet du
candidat, d'autant que nul ne voudrait plus de type d'alliance qui
s'est faite autour de J. Chirac en 2002 et qui n'était
"légitime " aux yeux par exemple du PS et du PC que pour
s'opposer à JMLP. Il est clair que FB est un républicain,
ce que n'était le chef du FN pour tous les électeurs de
gauche qui avaient voté pour l'actuel président de la
république.
- La seconde croyance est qu'il (FB) pourrait,
après son (très éventuelle ) élection au
deuxième tour et dans sa foulée ,constituer en vue
des élections législatives ou tout de suite après,
un grand parti démocratique du centre,. Or cette croyance
repose à son tour sur l'hypothèse que son
élection entraînerait nécessairement les
ralliements de droite et de gauche qui lui permettraient de former le
grand parti apolitique de techniciens compétent à son
service (ni à droite, ni à gauche). Mais ceci supposerait
l'éclatement des deux formations que sont l'UMP et le PS. Or
nulle personnalité de premier plan, dans aucun de ces partis,
n'a intérêt vis-à-vis de ses électeurs de
rompre avec son parti sauf à se couper de ses fondements
idéologiques de légitimité et du soutien de la
formation politique dont il est issu. Tout donne à penser,
au contraire que les formations (de droite ou de gauche) ,victimes de
ces ralliements , feraient tout pour enrayer un tel processus de
rupture, en menaçant ceux-ci de représailles
extrêmement efficaces (au regard des élections futures
) contre les ralliés. Aucun (ex)adversaires au sein du
PS de SR ne voudrait pas , par exemple, ne pas profiter de la
défaite (très éventuelle) de celle-ci au premier
tour, pour l'emporter sur elle au sein du parti, en vue de
préparer à son avantage son éviction pour les
futures élections cinq ans après; et il en est de
même au sein de l'UMP. Nul n'a donc d'intérêt de se
soumettre au leader-chip de FB au risque de ne pouvoir
prétendre se présenter aux élections majeures
suivantes comme son successeur à la plus haute fonction. Seuls
donc des ralliements de seconds ou troisièmes couteaux aux
ordre exclusif de FB, seraient envisageables, lesquels ne permettraient
pas de résister longtemps au tirs de barrage permanents qu'ils
subiraient de la part de leur ancienne formation (et les ralliements
dans le sens de l'UMP et venant de l'UDF -et non le contraire- sont
là pour nous le montrer dès aujourd'hui).
-La troisième croyance , plus profondément, est qu'il
serait possible dans notre pays de renoncer au débat
démocratique entre la droite et la gauche et que l'on pourrait
se dispenser de renouveler la gauche en un sens plus libéral
pour fonder une alternance démocratique crédible (
et quoiqu'en pensent certains c'est bien le sens des efforts de SR)
dont toute démocratie a besoin. Le rêve d'un gouvernement
de techniciens neutres soumis à l'homme providentiel
qu'est FB est un rêve dangereux pour la démocratie
elle-même. Notre pays comme tous les pays démocratiques
connaît de profondes divisions sociales qui obligent
à faire des choix courageux entre les intérêts des
uns et des autres et/ou à trouver des compromis qui ne peuvent
convenir tout à fait, ni aux uns, ni aux autres. et donc qui
doivent trouver des majorités alternatives difficiles pour
pouvoir être effectués ou sanctionnés par les
électeurs dont on ne pourrait, par la grâce d'un
président tout puissant, faire disparaître comme par
enchantement (et il y a de l'enchantement dans le démarche de
FB) . Rien n'indique qu'une politique centriste ne soit pas autre chose
qu'une politique immobiliste ou un mirage unanimiste absurde en
démocratie. Un tel unanimisme politique ferait probablement le
lit de l’extrémisme de gauche ou de droite
Ces trois croyances sont donc, si j'ose dire, un acte de foi, de nature
religieuse, dans une société réconciliée
qui n'existe que dans l'esprit du chef de l'UDF et de celui de
ses amis (bien instables du reste) et sous le pouvoir exorbitant dont
il rêve de faire cesser le conflit gauche/droite; elle est
d'ailleurs à relier avec la volonté de FB de renforcer
les pouvoirs du président de la république, qui, dans son
projet de VIème république, deviendrait seul responsable
de la politique concrète indissociable de celui
d'introduire une part du suffrage proportionnel aux élections
législatives; ce qui, loin de réduire le pouvoir du
chef de l'état, ferait qu'il serait seul à même
d'effacer, mais d'une manière très instable, les
clivages politiques à son profit exclusif.
Le rêve de FB réside donc dans la volonté de faire
de celle-ci l'expression d'une pensée unique dans une
société à son image: celle de la paroisse des
croyants dans un réconciliation généralisée
de tous les citoyens; paroisse qui serait telle qu'elle
confierait à un seul le pouvoir de dépasser, dans une
même communauté de croyants, la politique et son
théâtre (ou pouvoir de représentation) en tant
qu'expression régulée des luttes sociales.
Le 06/03/07
Suite:
intérêt général et pluralisme
Je ne pense pas que le MEDEF et la CGT puissent avoir la même idée de l’intérêt général et de la justice sociale.
Dans cette situation, il n’ y a pas d’autre choix que de tenter d’établir un rapport de force favorable pour trouver un compromis et ce rapport des forces doit pouvoir se traduire électoralement sous peine de voir se prolonger le dégoût de beaucoup de français pour la politique: c’est cela la démocratie et non une réconciliation qui ferait l’impasse sur les désaccords. La pensée unique n’existe pas et l’accord ne peut se faire ni sur la position du MEDEF ni sur celle de la CGT et encore moins un mixte incohérent entre les deux qui ne peut satisfaire personne, mais le résultat d’un négociation donnant/donnant, en une position de force relativement égalitaire (Hobbes).
Ce n’est pas par la présence miraculeuse et transcendante d’un candidat réconciliateur qui voudrait prendre la place du légisateur divin, central dans la problématique du Contrat Social de Rousseau, que cet accord sur l’intérêt général peut s’affirmer, car, comme le disait Rousseau lui-même, cette possibilité elle-même supposerait l’égalité des conditions et donc que ceux d’en haut renoncent à tous leurs privilèges sous la haute autorité de ce législateur.
Il ne me semble pas que FB puisse jouer le rôle auquel, sans le dire, tout en le disant, il prétend, non seulement il n’est investi d’aucun pouvoir de médiateur transcendant ou divin dans notre société laïcisée, mais il n’est pas non plus, que je sache, égalitariste quant au la question de la propriété privée des moyens de production et d’échanges.
Dans ces conditions la position de FB se place, me semble-t-il, hors du champs de la démocratie pluraliste et donc conflictuelle. Elle est religieuse sans avoir les moyens organisationnels et politiques d’une religion dominante. Que beaucoup d’électeurs soient dégoûtés de la politique, on peut le comprendre, mais je crains que le vote FB soit en partie le fait de ce dégoût qui leur ferait voter pour lui pour dire non à la politique, comme en ce qui concerne le non référendum sur le TCE. Il y a un indice de cette attitude: les mêmes qui ont voté non s’apprête à voter pour un candidat qui a été le plus ardent défenseur du oui.
Mais cette attitude disqualifie la
démocratie en la transformant en nihilisme irresponsable. On n’a
pas
besoin de cela pour sortir la France du marasme économique et
sociétal.
Le 08/03/07
Pensée religieuse et philosophie politique
Ma position est de déclarer religieuse toute position qui prétendrait dispenser un pensée unique de l’intérêt général transcendant les divisions sociales. Cette position religieuse peut valoir en état de guerre (union sacrée) contre l’étranger ; en l’absence de guerre, elle ne vise qu’à perpétuer la domination les inégalités existantes au nom d’un prétendu intérêt général qui ferait fi des injustices .
Il ne s’agit donc pas de religion catho ou autre mais de la vision religieuse de la politique qui consiste à refuser la nécessaire lutte politique en démocratie entre ceux d’en haut et ceux d’en bas et à faire croire qu’un sauveur suprême peut sauver la société par delà ses clivages, sans rapport des forces et recherche de compromis donnant/donnant nécessairement lié à ce rapport des forces.
Toute vision religieuse de la politique est mystificatrice en cela qu’elle fait rêver les gens pour qu’ils n’aient pas à lutter contre la réalité l’oppression. Elle substitue nécessairement la charité religieuse-humaniste apolitique à la justice.
Le 08/03/07
De la
démocratie comme régulation des conflits sociaux
Personne ne
peut prétendre légitimement gouverner dans et par
la guerre civile, mais cette guerre menace
spontanément dans toute société , dans les
injustices subies et
exploitées, lorsqu’aucune régulation démocratique
ne vient la pacifier
par le jeu d’un rapport des forces entre des camps qui ont toujours
intérêt à trouver un compromis.
Or un tel compromis n’est possible que si les forces en questions sont suffisamment équilibrées dans leur pouvoir de nuisance réciproque, sinon le camp le plus fort impose nécessairement son intérêt propre, au risque d’une révolte plus ou moins violente. L’intérêt général est donc "mobile" et dépend du rapport entre ces forces dans une stratégie donnant/donnant qui n’a rien de religieux dès lors qu’elle n’exige aucun sacrifice en vertu d’un prétendu intérêt supérieur dont les dominants prétendrait détenir le monopole.
Le religieux est relation à la transcendance ; or, précisément, le jeu donnant/ donnant est immanent c’est à dire horizontal, dans l’égalité et la réciprocité des droits et des devoirs (ce sur quoi SR insiste à juste titre).
Cette vision de la politique est réaliste et ne présuppose pas que les gens soient a priori d’accord sur un hypothétique intérêt général, qui reste toujours l’enjeu d’un conflit entre intérêts particuliers, chacun des camps s’efforçant de présenter le sien comme l’intérêt général contre la définitioin qu’en donne son adversaire du jeu.
La politique démocratique admet le conflit et son expression publique permanente comme un droit fondamental (expression contestataire des positions, élections, droit de grève etc..) et par le jeu des élections fait place à la compétition entre ces visions de l’IG divergentes. La seule manière de sortir non de la guerre civile mais d’un conflit stérile est alors de chercher un compromis.
Un dirigeant politique, dans ces conditions, se fait élire sur une certaine vision de l’intérêt général reconnu comme majoritaire à tel ou tel moment dans le cadre de ce rapport des forces démocratiques, mais doit aussi faire place à la possibilité du compromis qui sera le plus favorable à ceux qui l’ont élu, tout en prenant en compte le point de vue de ses adversaires afin de réguler le conflit et d’éviter précisément la guerre civile, ce qui ne manquerait pas de se produire s’il refusait toute négociation en vue du compromis.
Ma conception de la politique est la seule réaliste et la seule qui fonctionne et peut fonctionner dans u ne démocratie pluraliste et conflictuelle. Tout autre est idéaliste et donc illusoire et toujours déçue...
CE SONT LES VISIONS ABSOLUES ET UNANIMISTES
DE L’IG QUI PROVOQUENT LES GUERRES CIVILES ET NON MA VISION RELATIVE,
PLURALISTE ET CRITIQUE ASSUMEE
Le 08/03/07
Ségolène Royal, la crise sociétale et la démocratie
La
république démocratique suppose l’existence d’une
population sinon
unie, du moins convaincue d’une nécessaire solidarité
sociale, voire de
destin historique, de telle sorte que la possibilité d’un
compromis
demeure au moins crédible entre les différents groupes ou
couches qui
composent la société. Or, n’est-ce pas cette
solidarité qui fait
défaut? Comment la reconstruire ou, à défaut, en
neutraliser les effets
corrosifs, voire mortifères, sur nos institutions politiques?
La
possibilité et la crédibilité, lesquelles sont
indissociables, de cette
solidarité sont, en effet, compromises dès lors que les
inégalités , en
particulier celle des chances, s’accroissent dans un
société qui ne
reconnaît pas de hiérarchie prétendue naturelle ou
sexuelle entre les
individus, laquelle non-reconnaissance est un principe de base de
l’idée démocratique.. Ceux d’en bas ne se sentent alors
plus protégés
par ceux d’en haut et encore moins appelés à partager le
pouvoir, la
richesse produite par leur travail, ni même à voir leur
sort
s’améliorer au fil du temps et des générations.
Alors que ceux d’en
haut, qui disposent des capitaux économiques et culturels, voire
politiques et symboliques, accroissent leur sécurité
personnelle, leurs
revenus et privilèges, ceux du milieu et a plus forte raison
d’en bas
qui font l’immense majorité (80%) se voient condamnés
à la précarité et
à l’abandon de toute promesse de promotion par rapport à
la situation
de leurs parents : l’ascenseur social est aujourd’hui plus
descendant
que montant pour la plupart, et les inégalités entre les
hommes et les
femmes persistent. Or une société qui se veut
démocratique et qui
laisse aller l’aggravation des inégalités et de la
précarité aux dépens
du plus grand nombre, ce qui ne peut être ressenti du point de
vue
démocratique que comme une injustice, se
décrédibilise elle-même et, en
se décridibilisant, décridibilise l’idéal
démocratique qu’elle
revendique. Cette idéal n’apparaît plus alors que comme
une fiction
mensongère ou mystificatrice. Aristote signalait
déjà que la démocratie
n’est possible que dans une cité composée d’une classe
moyenne
largement majoritaire (disposant donc du pouvoir) ouverte à ceux
d’en
bas et d’une infime minorité de très riches,
elle-même ouverte, et de
très pauvres, très minoritaires, espérant
s’extraire de leur misère.
Ainsi l’idéal démocratique et donc sa mise en oeuvre réelle sont dévoyés dès lors qu’ils "couvrent", voire légalisent, l’affirmation du pouvoir économique et politique exclusif des riches sur les pauvres ; le droit de propriété, en principe égal pour tous, est alors perçu et devient réellement alors le droit des propriétaires de moyens de production et d’échange d’exploiter les dépossédés, selon la critique que fait Marx du droit bourgeois fondé sur le droit de propriété.
Il apparaît alors un conflit irréductible entre la démocratie politique et le capitalisme économique dérégulé ou désencastré (Poliany) de toute finalité politique de justice pour tous. La capitalisme, contrairement au libéralisme régulé par le droit social, est par nature antidémocratique : rien de moins démocratique que son fonctionnement, le pouvoir exclusif du capital et des investisseurs, et sa finalité, le profit privé maximal. La capitalisme, dans sa logique propre, ne tient aucun compte d’un quelconque intérêt général qu’il confond du reste avec la somme des intérêts particuliers privés et de la seule demande solvable. ce conflit est au coeur de la réalité démocratique égalitaire en droit, mais inégalitaire en fait, pour qui ne la confond pas avec la fiction démocratique et l’image qu’elle se donne elle-même. Dans ces conditions, ceux qui, dans le cadre d’une dérégulation du droit du travail et de l’extension du chômage et de la précarité liées aux conditions de la mondialisation, souffrent de la fusion progressive du pouvoir politique et du pouvoir économique à laquelle nous assistons et qui s’exprime sous la forme de l’affaiblissement de l’état face au capitalisme mondialisé, sont alors tentés par des alternatives antidémocratiques et totalitaires de droite ou de gauche, à connotations religieuses ou non.
Cette tentation s’exprime sous les deux variants du social-nationalisme étatiste :
- Celui d’extrême droite qui au nom du peuple racial et raciste (Volk) tente d’unifier la société sous la dictature charismatique d’un chef disposant d’un pouvoir absolu et transcendant pour rétablir contre la réalité, perçue comme dissolvante, l’unité d’un destin triomphant contre les autres, tous, plus ou moins assimilés à des ennemis mortels extérieurs et intérieurs . La guerre nationaliste et communautariste est utilisée comme alors la seule alternative pour instaurer l’unité du peuple menacée et faire rêver d’une solidarité sociale impossible en démocratie libérale, individualiste et pluraliste.
- Celui d’une certaine extrême gauche étatiste totalitaire qui prétend chasser le mal (l’injustice) en dépossédant par la violence les détenteurs des richesses et faire de l’Etat dit de "démocratie populaire" ou "dictature du prolétariat" sans liberté politique et à parti unique le seul garant de la justice pour tous : la justice de classe contre la bourgeoisie propriétaire des moyens de production et d’échange.
Toute vision d’une société homogène et sans conflit social et politique, qu’elle soit de race ou sans classe, ne peut donc mener qu’au pire : au refus du pluralisme et des libertés fondamentales ; au déni et/ou au dévoiement de l’idée démocratique en son contraire : la soumission des individus à l’ordre collectif incontestable déterminé par ceux qui, au sommet de l’Etat, prétendent l’incarner sans contestation possible en lui sacrifiant les libertés individuelles. cette vision conduit donc à l’idée mystificatrice et liberticide d’une égalité réelle des positions (et non pas seulement des droits et des chances) garantie par l’Etat, alors même que le pouvoir exécutif devient le lieu par excellence de domination et d’exploitation en concentrant le pouvoir politique, le pouvoir législatif, juridique et surtout économique, Nous savons où (a) conduit nécessairement cette vision : au désastre, militaire, politique et économique, voire au meurtre de masse et au génocide.
D’où la tentation contraire de récuser le pouvoir de l’Etat par l’affirmation, à la fois politique et suprapolitique des droits de l’homme contre ceux de l’Etat et du collectif même démocratique, de l’individu contre toute suprématie autoritaire du lien social.
Lorsque l’Etat démocratique ne peut plus assurer sa mission de justice d’en haut, que la société s’individualise et que, sous le coup d’une compétition sociale de moins en moins ouverte et de plus en plus négative pour le plus grand nombre, surtout pour ceux de plus en plus nombreux qui en sont exclus, l’Etat rentre alors en crise ; son autorité n’est plus légitime, les individus quand ils ne refusent pas la démocratie, en transforment profondément la signification : l’intérêt général n’est plus perçu comme sa finalité principale, s’y substitue le respect des droits des individus dans le recherche de leur bonheur propre et collectif particulier. L’Etat ne peut rien exiger a nom de d’un intérêt général de plus en plus problématique dès lors que, sous la pression d’une économie marchande de plus en plus socialement dérégulée, il supprime ou privatise en en faisant une simple excroissance de l’économie de profit privé ses missions de service public. Le citoyen devient un consommateur des moyens d’assurer son droit au bonheur privé. L’Etat ne peut même plus exiger de faire et de se préparer à faire la guerre. L’idée de sacrifice pour l’Etat et la collectivité, comme celle d’impôt entre en une crise profonde de légitimité. Les individus se désidentifient de la communauté nationale, d’autant plus qu’il n’y a plus de risque de guerre d’agression violente et militaire extérieure sur le territoire ; l’idée de patriotisme s’efface, c’est-à-dire l’exigence du sacrifice personnel au profit du bien commun.
Les droits de l’homme deviennent donc la seule référence et priment sur les droits du citoyen, la distinction entre les deux devient même ambiguë : d’un côté , ils sont confondus, au profit des droits des individus, d’un autre côté, les droits des citoyens toujours accompagnés de devoirs vis-à-vis des autres et l’Etat sont rejetés au nom des droits de l’homme.
Les questions de société mettent tous les jours en évidence ce conflit : chacun et/ou chaque groupe revendique son droit au bonheur contre la loi démocratiquement votée ; les femmes, les enfants, les homosexuels, les immigrés réguliers et clandestins etc. refusent les règles politiques que l’on prétend leur imposer pour conquérir le droit à avoir des droits égaux, au nom des droits de l’homme avec ceux des autres : les hommes, les adultes, les hétérosexuels, les nationaux.
Mais il faut aussi comprendre ce qu’a de profondément, non seulement d’irrésistible, mais aussi justifié, cette montée des droits de l’homme contre le droit contraignant des Etats dans le contexte de l’idée démocratique dominante et ce qui conduit nécessairement l’Etat démocratique à ajuster en permanence et progressivement les droits du citoyens avec les droits de l’homme pour préserver un minimum de légitimité démocratique. Des droits démocratiques accordés aux citoyens qui ne seraient pas soumis aux droits des hommes et des femmes seraient perçus comme tyranniques par ceux qui se sentiraient nécessairement victimes d’une inégalité des droits, à savoir qu’ils feraient passer la loi majoritaire comme une loi qui pourraient contredire les droits individuels de l’homme ; ce qui, à terme, compromettrait la garantie des droits des citoyens en les soumettant aux devoirs collectifs décidés par telle ou telle majorité de circonstance ; c’est pourquoi, par exemple, l’abolition de la peine de mort, bien qu’elle ait été contraire à l’opinion de la majorité des électeurs à l’époque (1981-82), a été décidée par leurs représentants . C’est pourquoi le droit de vote des femmes s’est imposé comme un principe démocratique au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes du point de vue des droits universels de l’homme. Et c’est pourquoi, enfin, la question du droit de vote et des droits sociaux des immigrés se trouve posée au regard des fondements même de la démocratie dont je rappelle qu’elle ne peut être telle que si elle est universelle.
Ainsi
s’introduit un décalage entre le droit positif des citoyens et
l’universalité des droits de l’homme. Un tel décalage
voire, une telle
opposition plus ou moins temporaire, crée une dynamique pour
faire
évoluer la démocratie dans un sens plus
universaliste : on le voit en
ce qui concerne la question des femmes , l’homosexualité et
l’homoparentalité dont on peut déjà prévoir
qu’elle ne pourra pas être
longtemps interdite. La liberté universelle tend à
s’imposer contre
toutes les formes de discrimination dans l’usage des droits.
Ce
décalage entre droits de l’homme et droit positif dans tous les
Etats
démocratiques exige donc des corrections permanentes de celui-ci
au
regard de ceux-là sous le coup des revendications et des luttes
pour
les faire aboutir.
Or ces luttes ne peuvent aboutir que si les citoyens peuvent s’exprimer directement et participer et éventuellement contrôler, voire contester le travail des élus, donc que si l’exigence de la démocratie délibérative est à la source de la formation de l’opinion et par conséquent de la démocratie électorale et représentative.
La crise sociétale, via le développement des inégalités dans le sens d’un recul de l’idée d’égalité des chances et des droits, met donc en cause l’Etat démocratique classique comme exercice de la souveraineté populaire unifiée et unifiante. Cette mise en cause exige, pour ne pas voir contestée l’idée démocratique elle-même, d’en finir avec une certaine idée de la république représentative capturée par des élites masculines de préférence, dont la supériorité statutaire ne peut plus être considérée comme l’incarnation de l’intérêt général , il est alors nécessaire de réinventer une démocratie pluraliste délibérative ou mieux délibérante qui met la multiplicité des intérêts et des conflits qu’ils génèrent au cœur de son fonctionnement normal. Quatre exigences doivent être prises en compte :
-
Celle d’écoute de tous ceux qui sont dans une situation de
discrimination et de perte d’avenir, donc de tout ceux qui souffrent,
de plus en plus nombreux, de l’inégalité croissante des
chances et des
situations d‘enfermement dans l‘exclusion.
- Celle de mettre la réduction des inégalités au centre de tout programme politique démocratique par la redistribution, la cogestion et l’encouragement par la puissance publique de l’initiative et de la responsabilité personnelles.
- Celle de la diversification et la décentralisation des pratiques éducatives pour que tous puissent y trouver et y inscrire un projet personnel de développement de ses "capabilités" (A. Sen) dans un cadre de valeurs générales rationnelles concernant les savoirs et leurs usages responsable au profit de la société toute entière et en particulier des plus défavorisés ainsi des équilibres écologiques.
- Celle de préparer les esprits à une intégration européenne à finalité libérale et sociale qui seule peut faire de l’ouverture au monde une chance pour redynamiser la société, crispée sur elle-même et ses angoisses par la crise sociale et la décrédibilisation de la politique ; ce qui suppose une régulation des échanges économiques et sociaux en externe que seul l’espace européen peut offrir.
Ségolène Royal a le grand mérite de bousculer cette défiance mortelle vis-à-vis de la réalité paradoxale de démocratie représentative dans une société inégalitaire, laquelle est au cœur de la crise sociale et politique. En redonnant la parole aux citoyens les plus éloignés du pouvoir et par la réforme de nos institutions dans le sens de la participation (débats, jurys et budgets participatifs, non-cumul des mandats, réforme du Sénat, cogestion etc.) elle anime cette campagne, au point que tous les autres candidats sont obligés, chacun à leur manière, de faire écho à ses propositions et à sa démarche.
Le fait qu’elle revendique sa « féminitude » est un appel à ce que notre société, change son rapport au pouvoir et la représentation qu’elle a des priorités de la politique au profit de celles que d‘aucuns considèrent absurdement comme secondaires telles que : l’éducation , la vie familiale le sens des responsabilités vis-à-vis des plus défavorisés. La société ne peut renouer avec la démocratie vivante qu’en abandonnant le croyance que la royauté et le féodalisme virils et dominateurs, le machisme, sont indissociables de la symbolique politique et de l’autorité compétente.
C’est du reste pourquoi sa démarche suscite les mouvements de détestation et de rejets violents que l’on sait chez qui ne peut concevoir un pouvoir qui serait plus féminin sur le plan symbolique, ce qui veut dire plus authentiquement démocratique. Changer une idée monarchique obsolète de la démocratie , en réalité participative et citoyenne est aussi et surtout l’affaire du "féminin", en sachant que celui-ci appartient aussi aux hommes qui ont trop souvent tendance à le refouler derrière des simagrées viriles. Que ceci soit affirmé clairement par la candidate est une excellente nouvelle .
L’universel démocratique, nécessairement pluraliste, dans le crise sociétale et poltique que nous vivons, implique qu’une femme prenne enfin le relais de la responsabilité suprême pour que nous puissions "déviriliser" notre relation à la chose publique.
À l’heure ou la
machisme ordinaire tue une femme pas jour dans notre pays, il nous faut
délibérément abolir loi salique qui structure
notre inconscient
politique.
Si être juste c’est aussi se
battre pour la cause des femmes, et contre toutes les discriminations
dont elles sont les premières "victimes" (et je n’ai pas peur,
contrairement à d’autres, de ce terme), cela passe aujourd’hui
par
l’élection de Ségolène Royal : en tant que
femme et que socialiste
libérale, elle est la seule candidate, pouvant être
élue à l’élection
présidentielle, à incarner ce qui reste du désir
de justice ,
indissociable de l’idéal démocratique, dans notre
société.
Lire, du même auteur :
"La crise de le représentation démocratique" : http://agoravox.fr/article.php3 ?id_article=18323
et "Du bon usage de la démocratie" http://agoravox.fr/article.php3 ?id_article=19036Le 26/03/07
Ségolène Royal et la question nationale
"Je
suis une Européenne résolue. Je suis partisane d’une
France ouverte au
monde, internationaliste et généreuse et je
considère que la Nation a
un autre nom qui est celui de la République." a
déclaré Ségolène Royal
au quotidien Libération. S’agit-il là de nationalisme
comme le
prétendent nombres de ses adversaires de droite et/ou soi-disant
de
gauche?
Ségolène Royal voyant un danger de perversion de la symbolique nationale républicaine dans cette interprétation nationaliste, anti-étrangers et anti-immigrés du sentiment national, a décidé à son tour d’aborder cette thématique et de réhabiliter l’usage des symboles nationaux (marseillaise, drapeaux tricolore aux fenêtres le 14 juillet, fête nationale etc..). A-t-elle raison de se lancer dans ce qui semble être une offensive, voire une surenchère nationaliste comme certains l’en accusent à droite (ce qui ne manque pas de toupet) mais aussi à gauche, ce qui se comprend mieux a regard de l’option internationaliste du socialisme ?
Je reconnais qu’il s’agit là d’un point
qui mérite un examen attentif et qu’il est légitime pour
les
internationalistes de gauche de s’inquiéter d’une dérive
sociale-nationaliste qui a souvent menacé la gauche et
singulièrement,
comme l’a vu, lors du rejet par une partie d’entre elle du TCE.
Or
cet examen des propos de SR nous permet d’exclure toute trace de
nationalisme dans son discours, comme l’indique la formule citée
ci-dessus, son idée de nation se réfère
exclusivement aux valeurs et
principes de la république et particulièrement ceux de
l’égalité et de
la solidarité (que je préfère pour mon compte
à celui de fraternité,
mais c’est un autre débat). Elle insiste en permanence sur deux
thèmes
indissociables : celui de la diversité des origines comme
un facteur de
créativité et de dynamisme social, voire sociétal
et celui de la
construction du sentiment national par la volonté de partager un
avenir
commun dans la solidarité, en terme d’égalité des
chances, vis-à-vis
des plus socialement fragilisés et des plus
défavorisés . Le sentiment
national doit, selon elle, se penser au futur et faire de l’histoire de
la république, un socle sur quoi fonder le liberté dans
la solidarité à
construire et à reconstruire sans cesse avec tous ceux qui
vivent et
travaillent sur le territoire dit "national". Faut-il rappeler que la
nation et le drapeau sont inscrits dans la constitution qu’il ne s’agit
pas certainement pas, selon elle, de changer sur ce point en tant
qu’elle brigue la présidence de la République qui en est
le garant ?
Ce discours de Ségolène Royal, est donc, n’en déplaise à ceux qui ne comprennent pas qu’un symbole ne vaut que dans un contexte de sens et d’action déterminé, et qui restent figés sur une interprétation nationaliste du sentiment national, un discours de gauche internationaliste en cela qu’il est, pris à la lettre, ouvert sur toutes les nations et populations avec qui nous avons à partager notre histoire pour vivre nos principes dans leur universalité. Ces valeurs loin d’être le monopole exclusif de la nation française ont vocation d’être partagées par toutes les populations de monde qui ont à souffrir des effets de l’hyper-capitalisme financier spéculatif . Les symboles poltiques ou religieux sont toujours polysémiques et donc disponible à interprétations divergentes, voire opposés. Toute l’histoire du du symbole national est là pour nous le prouver qui a été de gauche, puis de droite et de nouveau de gauche avec des contenus politiques conflictuels. Il fait référence à l’idée de solidarité mais celle-ci, comme nous le rappelle Jean Jaurès, peut être
- Soit de l’ordre de l’Union Sacrée autour de ceux qui utilisent les populations au service de l’intérêt privé des dominants contre les étrangers ou une partie des nationaux désignés comme coupables de leur misère.
- Soit de l’ordre de la justice sociale au profit de tous c’est à dire des plus défavorisés y compris ceux qui sont des immigrés dans le pays qui les accueilli et dans lequel ils vivent et travaillent..
Or, comme le déclare précisément Ségolène Royal, c’est en se réappropriant cette idée de solidarité nationale ouverte aux autres et juste que les français sauront reprendre confiance en eux et dans le politique pour nouer avec les autres pays des liens de solidarité indispensables à leur propre essor et surtout qu’ils désireront reprendre sur le plan européen la construction d’une Europe plus démocratique qui a été mise à mal par le non au référendum, . La confiance des français dans les principes généreux de la république et en particulier chez ceux qui ont le plus à souffrir d’une mondialisation soumise à l’hyper capitalisme sauvage dérégulé est indispensable pour sortir notre pays du marasme historique dans lequel il est embourbé par la faute de dirigeants obnubilés par un nationalisme myope aux réalités du monde ou considérablement aveugles aux effets délétères sur la solidarité vis-à-vis des plus défavorisés du développement de la précarité et des inégalités sociales.
Ségolène Royal a donc le courage de
mener le combat sur deux fronts à la fois :
-
Sur le plan du symbole national , contre tous les nationalismes de
droite ou de prétendument de gauche, parfois
déguisé en
social-nationalisme.
- Sur le plan international contre l’internationalisme de droite qui tente de soumettre toutes les populations à la seule loi du profit privé, contre toute forme de solidarité sociale nationale et internationale.
Ceux qui savent entendre ses propos loyalement et sans préjugés, après les avoir examiner sérieusement dans leur lettre et dans leur esprit, doivent reconnaître et comprendre qu’ils opposent le sentiment de la solidarité nationale républicain au nationalisme identitaire ethnique. On peut rassurer alors tous ceux qui s’inquiètent de l’accent que met SR sur les symboles nationaux : la nation française pour SR doit être et rester résolument anti-nationaliste pour s’affirmer, à l’intérieur et à l’extérieur, comme l’expression d’un désir généreux de justice et de solidarité dynamique anti-communautariste.
Laisser
aux nationalistes le monopole de l’usage de la solidarité
nationale,
comme celui de la liberté aux prétendus
neo-libéraux, ne serait pas
seulement une erreur, mais une faute politique qui porterait un coup
mortel à l’idée démocratique.
Lire l’ entretien de Ségolène Royal au journal "Libération"
Le 29/03/07
Les tests ADN : un test pour tester notre résistance démocratique
Les
tests ADN pour une recherche de paternité du fait de la libre
décision
de la personne sont une chose, la quasi obligation d’y recourir sous la
pression d’une loi pour faire valoir un droit fondamental (regroupement
familial) en est une autre.
Il faut remarquer que ce test concerne la mère et non le père , or rien ne prouve que celle-ci soit l’épouse légale de celui-là ; il n’ y a pour cela aucun test génétique qui puisse certifier le mariage. Cette procédure est d’une telle absurdité logique que l’on est en droit de se dire que l’obstination du gouvernement sur ce point cache une volonté d’introduire ce test afin de faire accepter le flicage génétique généralisée comme une procédure normale de contrôle et cela en dehors de toute procédure criminelle.
Rappelons, en effet, que ceux qui veulent faire venir leur famille sont des immigrés légaux ! Ils travaillent et vivent chez nous et pour nous dans le BTP, les hôpitaux, les restaurants, l’agriculture etc..90% de nos autoroutes sont construites par des immigrés. Je ne vois pas en quoi du reste des travailleurs immigrés seraient socialement mieux intégrés sans leur famille qu’avec, puisqu’il n’est pas question de les expulser dès lors qu’ils sont légalement établis en France.
Enfin la famille n’est, pas plus chez eux que chez nous, une institution biologique, mais elle est culturelle et affective. Distinguer les enfants soi-disant naturels des enfants adoptés est en droit insensé. Aucun français ne l’admettrait et il n’y a aucune raison qu’on impose aux autres un droit familial qui serait injuste pour nous et qui n’existe pas. Le droit est universel ou il n’a aucune légitimité. Si par malheur une majorité se prononçaient pour une loi qui ferait que les juifs soient chassés de la fonction publique ou portent l’étoile jaune, aucun démocrate ne pourrait prétendre que cette loi est démocratique. Qui prétendrait le contraire ferait la démonstration qu’il refuse la démocratie dans son principe même. Il en est de même pour une loi qui discrimine sur un droit fondamental les immigrés légaux et les français
Je n’ai rencontré personne chez les soi-disant partisans de ce test qui ait répondu à l’argument des enfants adoptés. C’est un signe que leur raisonnement est en droit totalement fallacieux et donc, en toute rigueur, que leur position est injuste dans tous les sens du terme.
Les tests ADN
sont absurdes en droit et politiquement iniques
Le Conseil constitutionnel neutralise l’article "ADN"
Le
mine effondrée de M.Hortefeux lors de la publication de l’avis
juridiquement contraignant du Conseil constitutionnel concernant la loi
sur l’immigration ne peut laisser de doute: l’article sur l’ADN n’est
pas retoqué il est tout simplement rendu quasi inapplicable dans
les
faits et plus encore vidé de son intention politique
première: limiter
le regroupement familial.
Le test ADN ne pourra être proposé qu’au cas par cas au consentement de la mère, sous l’autorité de tutelle et avec l’autorisation du tribunal de Nantes qui devra vérifier que cette proposition n’intervient qu’en dernière instance, au risque permanent d’être invalidée dans le cas contraire.
Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de juger la loi sur un fondement moral ou éthique, mais seulement de sa conformité à la constitution. En entourant cet article de contraintes juridiques et d’application aussi draconiennes le conseil admet donc implicitement que cet article en sa forme et intention originales ne peut être conforme à la constitution que si son usage arbitraire reste quasi impossible par le gouvernement . De plus en retoquant toute statistique ethnique en France, le conseil réaffirme le principe d’universalité des droits du citoyen, voire des résidents dans notre pays.
C’est une victoire pour la démocratie et une défaite pour tous les xénophobes et pour un gouvernement qui a cru pouvoir jouer avec la peur des étrangers. Je suppose que nombre de députés de la majorité doivent se sentir soulagés. Leur bonne conscience est sauve, sans que soit mise en cause leur fidélité politique. C’est aussi une preuve vis-à-vis des pays africains, justement indignés par la teneur de cet amendement, que la France reste fidèle à ses principes républicains.
Enfin il n’est pas assuré que si cette question des tests ADN avait fait l’objet d’un référendum, lequel aurait exclu les immigrés, celui-ci nous aurait préserver d’un déni d’un principe fondamental de la démocratie et des droits de l’homme qui est le droit au regroupement familial.
La démocratie n’est pas réductible au vote direct dit populaire.
Défendre le principe du système de retraite par répartition
Les
propositions de Thomas Piketty sur les retraites sont à ce jour
les
seules qui répondent à l’enjeu qui consiste à
sauver le régime de
répartition et donc la solidarité entre tous les
salariés.
Il propose :
1) d’unifier tous les régimes de retraites dans un cadre unique en fusionnant le régime général avec les régimes Arrco (non-cadres) et Agirc (cadres) ainsi que le régime de l’Etat et du privé dès lors que ce serait une bonne chose pour tous de pouvoir passer volontairement de la fonction publique au privé et vice versa ;
2) que toutes les années de cotisations devront compter de telle sorte d’arriver après 40 années cotisées à un taux de remplacement garanti par l’Etat. Il convient donc pour cela de supprimer le durée minimale de cotisation de 15 ans dans le fonction publique ;
3) d’appliquer le taux de remplacement après 40 ans de cotisation (ou taux plein) à l’ensemble des salaires et non pas à ceux des 6 derniers mois (fonction publique) ou des 25 meilleures années (privé). Chacun pourra donc, comme en Suède, partir quand il le souhaite et toucher une retraite en proportion des points qu’il a accumulé et qui lui seront délivrés pendant toute la durée de ses cotisations ;
4) que le coefficient de conversion devra dépendre des évolutions démographiques (espérance de vie, ratio, actifs/inactifs) ;
5) de calculer la décote/surcote, fonction du nombre de cotisations en dessous ou au-dessus des 40 ans, sur la base de l’âge de départ à la retraite et de l’espérance de vie prévisible afin d’assurer l’équilibre financier du système unique. Il convient de prendre en compte, en effet, le fait que partir à la retraite un an plus tard conduit non seulement à verser une année supplémentaire de cotisations, mais surtout à toucher sa pension une année de moins (par exemple dix-neuf ans au lieu de vingt ans, soit 5 % de pension totale en moins).
Ces propositions sont limpides et traitent de tous les problèmes à la fois en les liant (unification, transparence, équilibre financier), au contraire de la démarche de NS qui consiste à séparer le régime de la fonction publique de celui du privé afin de diviser les salariés, voire les dresser les uns contre les autres, pour mieux les manipuler. Or nous savons que la question des régimes spéciaux ne concerne qu’une toute petite partie du déficit de l’ensemble des régimes de retraite. On peut donc s’étonner que, mis à part Ségolène royale et François Bayrou, d’accord sur ce point (et à mon sens sur d’autres), aucun responsable politique ou syndical ne s’en inspire, voire y fasse allusion, ne serait-ce que pour les discuter (et ne parlons pas des journalistes qui considèrent que ce qui ne vient pas des institutions est peu ou prou sans intérêt). Il faut donc supposer qu’elles heurtent encore trop le désir de certains de préserver des avantages acquis (ex : privé/public) derrière la complexité de différents régimes qui entretient une opacité propice et celui des autres de mettre en cause la régime de répartition au profit de régimes privés de capitalisation.
Or, comme le souligne Thomas Piketty, ce qui justifie la retraite par répartition c’est, d’une part, que les marchés financiers et immobiliers sont incapables de transférer une épargne garantie sur plusieurs dizaines d’années, et que, d’autre part, certains actifs risqueraient de ne pas épargner suffisamment pour leurs vieux jours.Je signale que Thomas Piketty est un économiste mondialement reconnu ; il est directeur d’études à l’EHESS et Professeur à l’Ecole d’économie de Paris dont il a été le fondateur qui regroupe des économistes français et étrangers.
Le 04/12/07
Un président de droit divin
Dans son discours au pape, lequel lui a accordé un titre ecclésiastique catholique, Nicolas Sarkozy prétend défendre l’esprit la loi de 1905 sur la laïcité qui, je le rappelle, interdit à l’Etat et donc à son chef de soutenir un culte quelconque. Or, dans ce discours, il fusionne ouvertement sa fonction avec celle du titre hiérarchique religieux que l’Eglise lui a conféré pour annoncer que le christianisme, confondu du reste avec le catholicisme, était depuis Clovis la religion de référence traditionnelle de la France et qu’à ce titre elle méritait en effet le titre de "fille aînée de l’Eglise". Comment comprendre un telle contradiction manifeste et que peut signifier sa vision d’une laïcité "positive" sur fond de cette contradiction?
Une phrase de son discours est particulièrement significative de cette vision :
"Aujourd’hui
encore, la République maintient les congrégations sous une forme de
tutelle, refusant de reconnaître un caractère cultuel à l’action
caritative, en répugnant à reconnaître la valeur des diplômes délivrés
dans les établissements d’enseignement supérieur catholique, en
n’accordant aucune valeur aux diplômes de théologie, considérant
qu’elle ne doit pas s’intéresser à la formation des ministres du culte.
Je pense que cette situation est dommageable pour notre pays."
Ainsi,
la République devrait, selon notre président, reconnaître la valeur des
diplômes délivrés par les universités catholiques (donc la plus
importante est celle d’Angers). Or, qu’en est-il aujourd’hui selon la
loi de 1905 et ses modalités d’application ultérieures ? Celles-ci
accordent par contrat à ces universités le droit de préparer lesdits
diplômes que les étudiants doivent passer devant des jurys des
universités publiques ; ces jurys peuvent admettre des enseignants de
ces universités privées dans la mesure où ils disposent des titres
publics requis pour le faire. Transformer ces universités privées
religieuses en centres de délivrances de diplômes publics reconnus par
l’Etat, comme aussi valides que des diplômes passés dans les
universités publiques, paraît ouvrir une boîte de pandore. De deux
choses l’une en effet : ou bien cette autorisation vaut pour toutes les
religions selon la vision "positive" de la neutralité laïque conforme à
l’esprit sinon à la lettre de la loi de1905 et donc devrait valoir pour
toutes les religions, islam compris, ou bien cette reconnaissance ne
vaut que pour les universités catholiques en contradiction avec le
principe de la neutralité laïcité. Ce qui signifierait que cette
laïcité dite "positive" serait positivement anti-laïque.
Mais une autre interprétation est encore possible : il s’agirait d’abolir les diplômes d’Etat et de privatiser entièrement l’enseignement supérieur et, pourquoi pas, le secondaire quand on sait que le bac est en droit le premier diplôme de l’enseignement supérieur et de proche en proche l’école en général. L’État se contenterait alors de valider tous les diplômes selon des procédures programmatiques et des exigences pédagogiques contractuelles négociables, comme c’est déjà le cas pour nombres d’écoles supérieures privées. L’école publique résiduelle gratuite serait alors réservée aux élèves dont les parents ne pourraient pas financer les écoles privées ou dont les principes laïcs et républicains s’opposeraient à la privatisation, religieuse et/ou commerciale, de l’éducation des citoyens.
De telles dérives, pour être mises en œuvre, devraient, de toute manière, faire l’objet d’une abolition de la loi de 1905, voire d’une modification de la Constitution. La contradiction entre la vision dite positive de la laïcité et la loi laïque existante serait, en effet, inévitable.
Or,
Nicolas Sarkozy va plus loin : il affirme que l’État devrait aussi
reconnaître la valeur républicaine des diplômes de théologie. Cela peut
signifier deux choses : soit que la République, pour reconnaître une
autorité publique à ces diplômes, devrait se soumettre aux diktats des
théologiens patentés par les Eglises qui les délivreront, soit que
l’État serait habilité à décider du contenu républicain de ces diplômes
de théologie, ce qui ferait donc de celui-là une autorité théologique
qui devrait s’intéresser, comme Nicolas Sarkozy l’a dit par ailleurs à
propos de l’islam, au contenu de la formation des ministres du culte.
Ce qui veut dire que la République, dans le plus style gallican, se
doterait d’une religion officielle pour chaque religion particulière ou
pour le moins d’un droit de regard sur le contenu des enseignements
théologiques.
On ne voit pas en quoi l’État républicain, dans un tel
cadre, pourrait prétendre encore s’affirmer laïc.
Une deuxième passage de son discours nous révèle les présupposés idéologiques de cette remise en cause de la loi sur la laïcité ; je cite :
"Bien sûr, ceux qui ne croient pas
doivent être protégés de toute forme d’intolérance et de prosélytisme.
Mais un homme qui croit, c’est un homme qui espère. Et l’intérêt de la
République, c’est qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes qui
espèrent. La désaffection progressive des paroisses rurales, le désert
spirituel des banlieues, la disparition des patronages, la pénurie de
prêtres, n’ont pas rendu les Français plus heureux. C’est une évidence.
Et puis je veux dire également que, s’il existe incontestablement une
morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a
intérêt à ce qu’il existe aussi une réflexion morale inspirée de
convictions religieuses. D’abord parce que la morale laïque risque
toujours de s’épuiser quand elle n’est pas adossée à une espérance qui
comble l’aspiration à l’infini. Ensuite et surtout parce qu’une morale
dépourvue de liens avec la transcendance est davantage exposée aux
contingences historiques et finalement à la facilité. Comme l’écrivait
Joseph Ratzinger dans son ouvrage sur l’Europe, ’le principe qui a
cours maintenant est que la capacité de l’homme soit la mesure de son
action. Ce que l’on sait faire, on peut également le faire’. A terme,
le danger est que le critère de l’éthique ne soit plus d’essayer de
faire ce que l’on doit faire, mais de faire ce que l’on peut faire.
Mais c’est une très grande question".
Sur le fond de sa
vision religieuse et morale de la société dans laquelle les incroyants
ne sont mentionnés que pour être tolérés, Nicolas Sarkozy n’hésite pas
ici à mettre en cause, malgré le fait par lui réaffirmé de l’existence
de l’incroyance qui doit être respectée (et c’est la moins qu’il puisse
dire aujourd’hui), la morale laïque en affirmant que la morale
authentique ne peut être que religieuse et qu’une morale purement
laïque ou rationnelle - à savoir, sans référence à une transcendance
surnaturelle - est nécessairement limitée dans ses ambitions à ce que
l’on peut faire. Elle manque en effet, selon lui, du sens de ce qui
doit être fait au nom d’un idéal divin "infini" et d’une espérance
supérieure post-mortem, laquelle permet aux hommes de supporter les
souffrances ici-bas sans trop se révolter, dans l’espoir d’être sauvés.
Cette vision traditionnelle de la morale reprend ce que disait Locke à
propos des athées, déclarés par lui asociaux car incapables de se
soumettre à des valeurs communes incontestables ; mais à la différence
de ce dernier qui contestait l’autorité politique du pape, considérée
comme nécessairement anti-démocratique, notre président fait de
l’autorité du pape une autorité politique, que, par le titre de
chanoine de l’Eglise, en tant que président, il s’engage de faire
respecter, en se prononçant contre la désaffection des Français
vis-à-vis du culte et en promettant de favoriser la croissance des
ministres du culte.
Nous sommes donc bien, malgré des dénégations qui ne peuvent tromper que ceux qui ne savent ou ne veulent pas lire, en face d’une remise en cause radicale par Nicolas Sarkozy du principe républicain de la séparation de l’Eglise catholique et de l’État, sur la forme et sur le fond. Sa vision religieuse de la société, plus tolérante à l’égard des autres religions qu’à celui de l’athéisme dont la mention est aussitôt disqualifiée au nom d’une morale religieuse intrinsèquement supérieure. Elle exige que le christianisme, confondu avec le catholicisme (les églises protestantes ne sont même pas mentionnées, alors que les guerres de religions sont une des origines de l’affirmation française de la laïcité), soit admis comme la religion majoritaire et donc dominante de la République française sous l’autorité spirituelle du pape. Elle fait de la France une nation par essence catholique, au même titre que les Africains sont jugés, dans son discours de Dakar, par essence inaptes au progrès. En cela, elle renoue avec l’antique alliance entre le monarque républicain - élevé au rang de chanoine catholique ou prêtre de haut rang - et le pape considéré comme le guide moral des Français, croyants ou non.
Cette entrevue et ce discours "vaticanesques" visent à changer pour le moins de République sans le dire, en consacrant le président en tant que monarque élu et grand prêtre catholique de droit divin.
Cette
profession de foi sarkozyste ouvre la possibilité virtuelle d’une
restauration d’une sorte de République de droit divin, inacceptable
pour tous les défenseurs de la laïcité, croyants ou non.
Lr 27/12/07
La politique civilisationnelle et l’argent-roi
Certains
qui se présentent comme soucieux de justice sociale, c’est-à-dire comme
favorables à la réduction des inégalités des chances et des droits
réels, se gaussent de la dénonciation par le PS ou le MoDem des cadeaux
que le président de la République accepte de la part d’amis très
fortunés et par ailleurs industriels aux intérêts fortement liés à
l’État dans la communication et l’énergie, au risque de faire de
celui-ci l’obligé de ces derniers.
Sur AVet
ailleurs, ils ne voient, semble-il, ou ne veulent voir, aucun
rapport entre l’acceptation ouverte, pour ne pas dire cynique, de ces
cadeaux par Nicolas Sarkozy et sa politique sociale. Ils refusent de
voir que celui-ci, en tant que personne privée, prend le risque
avoué
d’un possible conflit d’intérêt avec sa fonction publique,
sinon d’un
possible trafic d’influence. Ils vont même jusqu’à
dénoncer la dénonciation de ce comportement par le PS et
le MoDem, comme une
diversion qui occulterait l’essentiel, la politique anti-sociale du
chef de l’État.
Leur critique prend appui sur l’idée qu’ils se font de la séparation entre la politique réelle et la politique symbolique ou entre la vie privée et la vie publique. Or c’est cette prétendue séparation entre politique idéologique et politique sociale qui est, en l’occurrence, un leurre trompeur exploité subtilement par Nicolas Sarkozy au profit d’une vision de la rupture symbolique qu’il tente d’introduire dans la conscience politique de nos concitoyens quant aux rapports entre la richesse et le pouvoir politique, ainsi qu’entre la vie prétendument privée, alors qu’elle vise expressément à la notoriété publique, et la vie publique.
Nicolas
Sarkozy vient d’affirmer dans ses voeux aux Français, en effet, qu’il
désire impulser une "politique de la civilisation" ; or, en fait de
civilisation, son comportement, dans ses rapports aux plus fortunés
dont il accepte les cadeaux personnels en tout genre, tente
manifestement de changer la vision que chaque citoyen se fait d’un chef
de l’Etat et de son rôle au service de l’intérêt général, en
accréditant l’idée que la puissance de l’argent devrait être admise
comme un des fondements légitimes du pouvoir politique.
Il s’agit
en cela d’un véritable coup de force idéologique contre les valeurs
républicaines et démocratiques, dont nul ne peut estimer qu’il est
secondaire dès lors qu’il a pour but de préparer manifestement les
coups de force sociaux que les critiques de la politique du chef de
l’État dénoncent à juste titre.
Nous savons tous, en effet, que tout est lié en politique : un changement de symbolique de cette importance est toujours, comme NS le dit lui-même, civilisationnel : il vise à préparer délibérément la soumission à un ordre des valeurs qui fait de la valeur de l’argent une valeur incontournable, sinon incontestable, de la vie publique et de ceux qui en ont la disposition, les alliés "quasi-naturels" du pouvoir politique au sommet.
Or c’est cette confusion entre le pouvoir politique et la pouvoir économique qui corrompt la démocratie américaine, dès lors qu’elle affecte cette "exigence d’égalité" que Tocqueville admettait comme la valeur centrale de la vie politique nord-américaine : l’argent roi en tant que valeur sociale dominante, dans la tête des citoyens, tend à devenir une condition idéologique et symbolique pour faire que la puissance des plus fortunés soit perçue par tous comme un pouvoir symbolique et politique légitime. Dire que la France est en "retard sur le monde", comme NS l’affirme dans ses voeux, c’est dire qu’elle doit se plier, ainsi que l’Europe, au culte économiste de l’argent roi, mâtiné d’une dose de religiosité transcendante pour compenser les frustrations qu’il génère, en vue de réduire le risque de révolte violente contre les injustices subies par la majorité de la population.
Ainsi c’est tout un de dénoncer la politique sociale de Nicolas Sarkozy et de déligitimer aux yeux de tous les cadeaux qu’il affiche comme "normaux", comme c’est tout un de dénoncer sa vision de la politique civilisationnelle, son discours à Rome, et les décisions anti-sociales qu’il veut faire passer comme modernes.
Nous
ne pouvons donc que nous féliciter que le PS et le MoDem soient en
première ligne de ce combat pour la démocratie. Sans leur dénonciation,
que l’on doit espérer efficace, de ce changement de valeur, celle-ci
serait en grave danger, car cette rupture vis-à-vis des valeurs de la
démocratie (qui comme l’affirmait Montesquieu suppose, comme fondement
idéologique, la vertu ou l’amour de l’intérêt général), subtilement
orchestrée par Nicolas Sarkozy, favoriserait l’extrémisme
politico-religieux violent et liberticide, comme les nuées portent
l’orage...
Le 02/01/08
De l’art maîtrisé de la triangulation en politique
Sous réserve d’une analyse plus en profondeur, on ne peut qu’admirer la manière dont Nicolas Sarkozy, lors de la conférence de presse du 08/01/08, a su pratiquer la fameuse stratégie de la triangulation dans les domaines économique, social et culturel.
Qu’est
ce que la triangulation? C’est le fait de reprendre les propositions de
ses adversaires politiques, en l’occurrence du PS, voire de Ségolène
Royal, à son compte, en étant en position , contrairement à eux ,de les
faire aboutir contre la droite et certaines forces conservatrices qui,
pourtant, le soutiennent.
Il ne s’est pas agi seulement
d’ouverture à des personnalités mais aussi à une politique réputée de
gauche sur plusieurs points.
Ainsi
il a voulu placer l’ensemble de son intervention politique sous le
concept de "politique de civilisation" qu’il emprunte à E. Morin,
réputé tête pensante de gauche de la vie sociale et philosophe de la
complexité, et qu’il a reconnu avoir reçu la veille, ce que celui-ci
n’avait pourtant pas révélé dans une émission tardive à laquelle il
était invité sur France-Inter le même jour. "Remettre l’homme au coeur
de la politique", tel est son credo, dans les entreprises, la ville,
l’accès aux savoirs et à la formation, l’université. Un tel mot d’ordre
semble faire écho aux propos de Ségolène Royal sur l’exigence que "la
valeur humaine doit l’emporter sur les valeurs financières", ce qui ne
semble - et c’est le moins que l’on puisse dire - pas un principe du
capitalisme financier mondialisé dominant.
Qu’en
est-il concrètement de ses intentions politiques ? Je retiens pour ma
part plusieurs éléments de ses propos significatifs de sa volonté de
gommer son image de président de droite conservateur : "Il nous faut
d’abord changer, a-t-il dit, nos façons de produire, de travailler,
d’apprendre et de vivre", dans les domaines de l’économie, de
l’urbanisme de la formation et de l’information publique.
1) Economie :
Il s’est prononcé "pour un autre type de croissance, et pour cela, il faut changer l’instrument de mesure de la croissance" afin d’en établir un qui tienne compte de la qualité de vie des Français et non pas seulement du PIB ; un groupe d’experts sera chargé de définir les critères de cette nouvelle façon de mesurer la santé économique du pays qui prendront en compte la santé tout court, l’éducation, l’habitat, l’environnement et à ce sujet, les décisions du sommet dit de Grenelle devront être suivies d’effet ("Il faut sauver le soldat Grenelle"). Il faut repenser les indicateurs statistiques sur le coût de la vie auxquels plus personne ne croit aujourd’hui, en faisant intervenir des moyennes ciblées par catégorie de population et non plus seulement un critère global qui ne représente personne, c’est-à-dire au fond rien. Ségolène Royal n’a cessé de répéter ce genre de propos pendant et après l’élection présidentielle !
Il avoue ne pas pouvoir
redresser le pouvoir d’achat autrement qu’en élargissant la
participation de tous aux résultats des entreprises, y compris de moins
de 50 personnes, en contrepartie de réductions fiscales, selon la règle
chère à Ségolène Royal du donnant/donnant et qu’en défiscalisant de
charges sociales les HS. Il a refusé, sans en préciser personnellement
la ou les raisons, toute augmentation générale du SMIC, pourtant seul
moyen réglementé par la loi et donc relevant du domaine de compétence
de l’État ; mais il faut remarquer, à ce sujet, que Ségolène Royal
avait elle aussi critiqué cette mesure unique comme portant le risque
d’écrasement général des salaires et faisant du SMIC une trappe pour le
pouvoir d’achat du plus grand nombre.
2) Social :
Il n’a rien dit de très neuf sur ce plan, si ce n’est la confirmation de l’abandon des 35 heures, toujours au nom de la valeur travail, et du désordre introduit par la loi dans le service des hôpitaux et a confirmé le rachat des RTT sans préciser, du reste, dans quelles conditions et à quel prix.
Mais il a insisté sur sa volonté de protection d’un capitalisme industriel national des effets délétères de la mondialisation financière, en prenant deux exemples, l’un négatif, la disparition de Péchiney du fait de la spéculation mondiale, l’autre positif ; Alsthom sauvé de la liquidation par ses soins. Il pense que grâce à l’Europe dont il prendra la présidence dans 6 mois et le refus des inégalités dans les échanges mondiaux par une politique de réciprocité, il pourra parvenir à sécuriser et à développer l’outil industriel français en s’appuyant sur un instrument financier national, jusqu’alors réservé plutôt à la construction immobilière, la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu’actionnaire des entreprises. Il emprunte cette idée directement à une proposition centrale de PS. Nous ne sommes plus très loin d’une nationalisation rampante que la droite reprochait à la gauche comme l’expression d’un archaïsme étatique anti-économique...
2) Urbanisme :
"J’ai lancé, a-t-il dit, une réflexion sur le Grand Paris, sous l’angle de l’urbanisme, de l’architecture. On n’en parle jamais. Je vais m’impliquer personnellement dans ce dossier. Je ne laisserai pas ce procès s’enliser. La situation de la vie parisienne est devenue inacceptable" a-t-il promis, mais nous ne savons pas quelles sont concrètement ses intentions surtout en ce qui concerne le prix du foncier qui conditionne tout, et les principes qu’il entend mettre en oeuvre dans ce domaine. Manifestement il s’agit d’une pierre dans le jardin de B. Delanoë.
A propos des banlieues, il s’engage à réduire l’inégalité des chances selon un plan qui sera révélé en février par Amara Fadela ; il proclame qu’il veut en faire sa priorité, ce qui est à mettre en relation avec son éloge de la diversité à propos de laquelle il abandonne le terme de discrimination positive tout en marquant sa volonté de reprendre la signification de ces termes à son compte. Là encore, il s’agit d’une reprise du mot de diversité cher à Ségolène Royal pour marquer, au moins dans les termes, une convergence droite/gauche d’ouverture.
3) Les médias :
Cette ouverture à gauche est encore plus manifeste en ce qui concerne la télévision publique. Il reprend en effet la proposition la plus radicale de la gauche, à savoir la fin de la publicité privée sur les chaînes publiques, compensée sur le plan financier par une taxe sur les recettes publicitaires des chaînes privées. Il prend ainsi le contrepied de certains de ses amis à droite qui rêvent d’une privatisation généralisée du service public dans ce domaine dont ils espéraient profiter (suivez mon regard), mais dans le même temps il approuve les concentrations dans la presse écrite ne voyant là aucun danger pour la pluralité et l’indépendance de celle-ci. Nul doute qu’il s’agit là d’un compromis donnant/donnant. Le seul problème de la presse écrite selon lui est un problème de capitalisation et surtout de distribution, ce qui donne à penser qu’il remettra en cause le quasi-monopole de la distribution indirecte par les NMPP.
4) L’université et la formation :
Il s’est félicité de la réforme en cours (autonomie des universités) et surtout a promis un effort financier sans précédent en faveur des universités, sans rien dire du rapport d’inégalité entre elles et les grandes écoles. Tout son discours à ce propos est centré sur l’égalité des chances et du droit de chacun à avoir une seconde chance grâce à une offre de formation tout au long de la vie. Ce qui est traditionnellement une exigence de la gauche.
Je n’insisterai pas sur ce qu’il a dit de la politique étrangère dont il a défendu avec un talent et une grande pertinence les différents aspects, à l’encontre de ceux qui pensent que l’on peut traiter avec des chefs d’Etat dont on a besoin et que la pacification des guerres actuelles et futures exige en les méprisant ou en les humiliant. Il a même repris la formule de Ségolène Royal que beaucoup, à droite et à gauche, lui avait reprochée quant à la nécessité de "parler avec tout le monde".
Ainsi
va la politique de Nicolas Sarkozy, génial stratège, selon l’expression
d’E. Morin ; il ne veut être prisonnier de personne à droite, en tout
cas pas de la partie de son électorat la plus conservatrice et la plus
radicalement xénophobe et souverainiste. L’immigration dite choisie ne
va pas tarir au contraire, les flux migratoires, derrière les faux-nez
des tests ADN inapplicables en fait, et les reconduites à la frontière,
dans la mesure où on peut estimer que les quotas d’expulsion seront de
plus en plus difficiles, voire impossibles à tenir, ne serait-ce que
pour des motifs humanitaires et compte tenu de l’élargissement de la
zone Schengen , vont se poursuivre en liaison avec les pays concernés
pour mieux répondre aux besoins économiques de la France et aux besoins
de développement des pays dont sont issus les immigrants. Il reprend à
ce sujet le terme de codéveloppement constamment utilisé par Ségolène
Royal.
Bilan de ce discours :
On peut voir
dans cette stratégie de détournement et contournement de positions de
gauche un paradoxe pour affaiblir celle-ci, voire pour l’éliminer du
jeu politique en l’obligeant à s’opposer à Nicolas Sarkozy par un
discours hyper-critique et irresponsable d’extrême gauche ; ce qui
serait le piège par excellence. Mais on doit, me semble-t-il, à la
gauche et à sa capacité de faire des propositions souhaitables et
réalistes le fait que Nicolas Sarkozy accepte certaines mesures
socialement et économiquement utiles et peut se libérer par une
stratégie de triangulation efficace des pesanteurs des forces sociales
les plus conservatrices et/ou les plus néo ou pseudo-libérales. De même
que Mitterrand était seul à pouvoir faire accepter à la gauche, à
partir de 1983, des mesures de privatisation des banques et entreprises
et de libéralisation sans précédent des médias, de même c’est,
semble-t-il, l’intention de Nicolas Sarkozy de faire avaler à la droite
des mesures que celle-ci a considéré jusqu’à présent comme étatistes
voire gauchistes.
Reste que sur la question du pouvoir d’achat et surtout, comme l’a signalé avec justesse E. Morin, la vision par Nicolas Sarkozy de la valeur travail, considérée comme plus fondamentale que celle des loisirs, reste foncièrement de droite et totalement tributaire de la civilisation de la contrainte sociale économiste et donc antilibérale. Le temps de travail pour tout libéral conséquent ne peut être, et cela vaut pour la plupart des employés (ce qui veut dire ployés sous l’autorité sociale d’un employeur), qu’un mal nécessaire, non une activité de liberté mais soumise à la contrainte sociale. La réduction du temps de travail et le loisir sont pour tout penseur de la liberté depuis Platon et Aristote la condition pour vivre mieux, c’est-à-dire plus autonome.
"Travailler moins pour consommer moins et vivre mieux" selon l’auteur détourné par Nicolas Sarkozy, E. Morin, est, pour ce dernier, le principe premier d’une politique progressiste et libérale de civilisation. Nicolas Sarkozy sait donc très bien utiliser les auteurs et les héros historiques à contresens. Son art de la triangulation est à son comble.
Bravo
l’artiste ! Que la gauche, ainsi que Ségolène Royal qui a tenté de le
faire contre un grand nombre de dirigeants de son parti (et non pas des
adhérents), retiennent cette magistrale leçon.
Le 08/01/08
La direction du PS en plein pataquès
François Hollande et J-M Ayrault ont déclaré que les parlementaires PS refuseront de se rendre au congrès de Versailles qui est convoqué pour voter pour ou contre le changement constitutionnel en vue de la ratification ultérieure du traité modificatif de Lisbonne.
Un nombre important de parlementaires du PS ont immédiatement dénoncé ce qu’ils considèrent comme un coup de force, car selon leurs dires, ils n’ont jamais été consultés sur cette décision. L’actuel secrétaire et le chef du groupe PS de l’Assemblée nationale, selon leur propre déclaration , veulent, par là, masquer les divisions du PS sur la question de savoir s’il fallait approuver ou non, non pas le traité de Lisbonne, mais la procédure parlementaire promise par le président de la République pour le ratifier.
Or nous savons par ailleurs que la majorité des parlementaires du PS, ainsi que François Hollande et J-M Ayraut sont d’accord pour approuver le traité par la voie parlementaire, donc sans référendum. Une minorité, par contre, demande un référendum sur la ratification du traité en espérant renouveler l’opération de 2005 qui a vu le non l’emporter contre la majorité et la direction du Parti, et est prête à voter non à la modification de la constitution pour voter non par référendum à la ratification du traité, ce qui est cohérent. Une autre minorité, sans doute plus petite, se déclare prête à voter non au changement de la constitution par le congrès, donc à participer au vote concernant ce point, pour exiger un référendum sur le traité afin de l’approuver par cette voie. Ce qui est passablement tordu, mais a sa logique (complexe) dès lors que le PS s’est prononcé pour la procédure référendaire.
François Hollande et J-M Ayrault, pour préserver un faux-semblant d’unité en forme de faux-nez ostentatoire, ce qui ne peut que les décrédibiliser, croient pouvoir réconcilier l’inconciliable en refusant la procédure parlementaire sur ce qui n’est pas le traité, afin d’approuver celui-ci par cette voie. Aucun adhérent du PS dont je suis ne peut accepter une telle confusion politicienne qui confine au grotesque.
Il est triste de voir des dirigeants politiques, pour préserver un leadership chancelant, se conduire d’une manière aussi irresponsable et se prendre à ce point les pieds dans le tapis, et encore plus de les voir prendre leurs électeurs et les adhérents, voire les parlementaires de leur parti, pour des imbéciles.
10/01/08
Dans un article donné à Libération (1), Michel Rocard se livre à un jeu de massacre généralisé contre tous les candidats potentiels au secrétariat du PS. Quelle mouche a piqué notre grand sage en socialisme moderne?
Il assortit son pamphlet au vitriol d’une critique juste des insuffisances du PS, gangrené par une contradiction, que la direction actuelle de ce parti ne parvient ni à escamoter ni à dépasser, entre ceux qui se prononcent pour un socialisme étatique, national et/ou européen qui soumettrait le marché à sa botte et ceux qui veulent un marché régulé par un droit social ouvert sur l’Europe et qui, en première étape, acceptent le traité modificatif de Lisbonne comme une étape nécessaire de la construction d’une Europe politique, condition d’une Europe plus sociale.
Or
à la question de savoir qui pourrait assurer une direction et
éventuellement la candidature du parti aux élections présidentielles de
2012, il écarte dans cet article, un à un, tous les candidats
potentiels sans en désigner un seul sinon en creux puisqu’il ne
mentionne pas sa personne. Mais, et il faut voir là le but réel de ses
propos, il réserve à Ségolène Royal un jugement sans appel le plus
dur ; il affirme sans l’ombre d’une analyse que celle-ci je cite n’a,
je cite, "à l’évidence pas les capacités nécessaires aux responsabilités qu’elle postule" et "qu’elle représente une certitude de défaite, au prix en plus d’une très grave crise dans le Parti".
Cette évidence est telle, selon lui, qu’elle n’a pas à
être justifiée à défaut d’être
universellement reconnue.
Cette
attaque personnelle contre Ségolène Royal n’a à l’évidence aucun
caractère politique, car on ne voit pas du tout, dans son texte, ce qui
distingue le projet de rénovation de celle-ci du diagnostic et des
orientations de Michel Rocard quant à la lutte entre les deux lignes au
sein du PS qu’il décrit si justement. De plus, cette attaque est lancée
sans aucun argument et comme valant d’une manière définitive :
l’incapacité de SR serait, selon lui, non seulement évidente, mais,
faut-il le supposer au regard de telles évidences et si les mots ont un
sens, congénitale pour ne pas dire génétique ou sexuelle. De la part
d’un homme politique respectable, mais qui n’a jamais brillé par sa
capacité à prévoir les événements (il affirmait dès avant le premier
tour que SR n’obtiendrait pas plus de 40 % des voix au second tour !)
il s’agit d’une outrecuidance tout à fait insultante qui fait verser le
débat politique dans la pure rhétorique démagogique.
On
doit alors se demander pourquoi Michel Rocard qui nous a toujours
rappelé aux normes et à la dignité du débat démocratique sacrifie, à
son tour, son image d’homme politique responsable - sur nombre de
points justifiés - à de tels procédés.
Je ne vois pour ma part
aucune autre explication que celle de la panique qui le prend face au
fait que les adhérents et électeurs de gauche ne semblent pas
spontanément partager l’ "évidence" de l’incapacité "atavique" de SR à
exercer les plus hautes fonctions politiques. Elle serait, selon lui,
mais au contraire de lui, "trop avenante et charismatique" pour cela,
disons trop séduisante, pour être à même de faire preuve de l’esprit de
décision et de l’autorité nécessaire ; à moins qu’il ne s’agisse de sa
débilité intellectuelle à se saisir des grands problèmes du monde. En
un mot, elle aurait les qualités d’une femme et non d’un homme.
Mais
qui ne voit que, par cette manière de disqualifier l’ex et/ou la future
candidate, il donne au contraire un argument de poids à tous ceux qui
ne veulent voir dans ses propos qu’une simple réaction sexiste face à
une personne qui remettrait en cause ses propres ambitions passées ou
futures. Que faut-il de rancœur et de ressentiment pour en arriver à ce
point de bassesse chez un personnage qui nous avait habitués à plus de
hauteur...
Cher Michel nous ne sommes pas au café
du coin, en train de siroter un verre de pastis, pendant que Madame
prépare le repas !
1 : article de Libération
16/01/08
Refusons tout enracinement politico-religieux
Il revient d’une manière récurrente sur le tapis médiatique, comme dans dans les discours de Nicolas Sarkosy à Rome et ailleurs, la référence aux racines chrétiennes de la France (mais aussi dans les textes européens les racines religieuses et/ou philosophiques de l’Europe).
Ce n’est pas tant le fait, en effet historique, des sources chrétiennes et/ou philosophiques de(s) la culture(s) française(s) et de celles de l’Europe qui pose problème, mais précisément que l’on fasse de ces sources, des racines. Quelle est le différence entre les deux termes ?
Cette différence réside dans l’opposition de sens qu’il y a entre un héritage dont on peut disposer comme on l’entend, y compris en le refusant , en le dilapidant, ou en le transformant profondément en une racine immuable qui nous lie(rait) à jamais à une prétendue identité culturelle et/ou idéologique invariante , qui donc nous enracinerait dans une identité religieuse ou philosophique qu’il nous serait interdit de remettre en question. Ce terme de « racines » a toutes les caractéristique d’une assignation performative, comme disent les linguistes, à une essence éternelle qui transcende(rait) l’histoire. De même que le fait de déclarer mari et femme un couple signifie que le mariage n’existe que par cette déclaration, prétendre que nos racines sont chrétienne (ou autres) c’est prétendre que chaque français est, par cette déclaration même chrétien, et engagé à l’être ou à le (re)devenir ; c’est affirmer qu’il doit être reconnu et se reconnaître comme tel, ce qui lui confère le devoir de suivre les commandements moraux prétendument divins du christianisme et de ceux qui ont le monopole de droit divin de leur énonciation : les églises. Cela vaut, chez nous, particulièrement pour l’église catholique qui reste la plus monarchique (de droit divin) de toutes les églises chrétiennes dans le domaine éthique et moral, voire parfois encore politique (avortement, contraception, recherche sur l’embryon humain à finalité thérapeutique, mariage civil des homosexuels, homoparentalité etc..).
Or affirmer que des racines historiques d’une population sont chrétiennes (ou autres : musulmanes par exemple) c’est affirmer cela non seulement comme une déclaration performative, mais aussi comme un fait incontesté sinon incontestable, c’est à dire définir un norme comportementale religieuse ou idéologique déterminée comme une vérité historique objective, à laquelle on ne peut et on ne doit pas se soustraire ; c’est faire d’une norme religieuse particulière une norme valant pour tous, alors même qu’elle ne vaut que pour les croyants (et encore, plus en théorie qu’en pratique). C’est ce tour de passe-passe logique entre fait et norme qui est tout à la fois anti-laïque et anti-démocratique . Anti-laïque, car dans une société qui ne reconnaît pas (et ne se reconnaît pas dans une) de religion officielle, une racine religieuse n’a aucune valeur politique, sauf à revenir sur la caractère non-religieux de l’Etat dont le chef doit obligatoirement être le garant. Anti-démocratique car une démocratie est nécessairement pluraliste et doit respecter, à travers son chef et ses déclarations officielles (et elles le sont toutes) cette pluralité des références idéologiques, ce qui interdit de faire d’une religion ou d’une idéologie particulière une norme morale et encore moins politique uniformisante.
À cet égard il est faux d’affirmer comme une vérité historique que le christianisme soit (serait) la seule référence idéologique constitutive de l’identité culturelle de la population (ou mieux des populations) française(s) . Nous savons que notre histoire est marquée par une lutte , non seulement entre plusieurs interprétations du christianisme, mais surtout entre une vision cléricale de la vie sociale et une conception laïque, voire anti-religieuse de la vie politique. La philosophie des Lumières par exemple est, en France particulièrement, animée par un fort mouvement rationaliste contre tout ce qui a été appelé par Condorcet la superstition ou l’obscurantisme religieux, particulièrement contre le pouvoir non seulement spirituel mais temporel de l’église catholique. Nous sommes en tant que français tout autant marqués par nos origines chrétiennes que par la lutte pour les droits de l’homme dont notre démocratie est l’héritière directe et en particulier par celui de penser contre la religion dominante. Il faut se souvenir que les droits de l’homme n’ont pu historiquement s’imposer que contre les prétendus droits divins et/ou royaux qui se réclamaient d’eux. Vouloir ressusciter de prétendues racines chrétiennes porte donc le risque de voir resurgir ce conflit violent que la loi de 1905 avait fini par apaiser dans le sens de la tolérance et de la raison dialoguante., dans le sens de l’intérêt général et donc de la république.
C’est dire qu’il
nous revient, en tant que démocrates et républicains,
de rejeter le notion de « racines » qui nous
fixe dans une identité, à la fois fausse historiquement
et perverse dans ses conséquences politiques, au profit de
celle de sources au pluriel , y compris contraires, qui nous
ont libérées de tout fanatisme et de toute vision
théocratique de la vie et de la pratique politique, bref des
guerres interminables des dieux et des religions.
Le 31/01/08
Remarques concernant certains des commentaires :
je n'ai en rien voulu disqualifier les français qui se veulent chrétiens, ce qui est parfaitement
leur droit comme l'est celui de s'exprimer en tant que tels ;
Ce que je conteste c'est 2 choses :
1) que le président prétende, es-qualité et non pas en tant que simple
croyant, définir le France en général comme ayant essentiellement des
racines chrétienne alors que seuls est concerné un certain nombre (peu
importe du reste le nombre) de français, alors que d'autres n 'ont pas ces
racines, par exemple tous ceux qui ne sont même pas baptisés et tous ceux
qui le sont mais qui ne pratiquent plus, voire qui ne se reconnaissent plus
comme appartenant à cette religion et ceux qui , même baptisés, ne
connaissent rien de la théologie chrétienne et je sais, par expérience en
tant qu'enseignant de philo, qu'ils sont de loin les plus nombreux (ce qui
est d'ailleurs plutôt regrettable), plus tout ceux qui s'en fichent et ne
vont à l'église que par convention lors de cérémonies rituelles (baptème,
mariage ou enterrement) qui n'engagent en rien la foi religieuse, mais
leurs relations familiales ou amicales.
2) que l'on fasse du christianisme une racine qui nous attache et nous lie
à des valeurs religieuses incontestables et non pas une des sources de la
culture française. Une source est dans ses conséquences extrêmement mobile
et n'engage à rien de prédéterminé ni sur le plan éthique ni sur le plan
politique ; elle n'a rien de sacrée, sauf à être affirmée comme
miraculeuse, car elle est toujours plus ou moins mélangées à d'autres,
voire détournée ou tarie ; ce qui semble bien être le cas pour beaucoup,
même baptisés.
Ce qui est inadmissible, car anti-laïque et antidémocratique, c'est de
faire d'une religion un fondement de vie politique qui vaudrait pour tous,
croyants ou non.
Je n'admets tout simplement pas d'être, sans me demander mon avis,
embrigadé, parce que français, par un président de la république garant de
la neutralité religieuse de l'Etat, dans un quelconque enracinement
religieux duquel devrait découler ma pensée, mes choix et mes comportements
politiques, d'autant moins que cela est affirmé comme un projet par le pape
en personne à qui je ne dois aucune obéissance puisque je ne suis pas
chrétien.
Je considère que cette mise au point permettra de faire clairement la
différence, que certains me semblent avoir du mal à comprendre, entre
source(s) et racine(s) !
le 04/02/08
Histoire, devoir de mémoire et culte des martyrs
Le président de la république vient d’ordonner, sans consultation des enseignants et sans débat au parlement, que, dans chaque classe de CM2, chaque enfant s’identifie à un enfant juif de son âge mort en déportation pendant l’occupation allemande. Remarquons qu’il n’a pas demandé de faire de ce prétendu devoir de mémoire un authentique travail de mémorisation historique, c’est à dire de recherche des causes et des responsabilités politiques, y compris celle du régime de Vichy, pourtant en première ligne des rafles anti-juives à l’époque des faits.
Un tel commandement ou fait du prince, peut être largement approuvé dans son intention première explicite : cultiver la mémoire par identification affective personnalisée aux victimes afin d’éradiquer toute tentation raciste ou anti-sémite chez les élèves dont certains, issus de l’immigration arabo-musulmane ou autre, pourraient être sujets.
Mais, ce qui est profondément dangereux, aux dires des pédo-psychiatres et des enseignants, dans leur très grande majorité, c’est d’imposer un devoir à un enfant de 10 ans de prendre en charge un enfant mort sans qu’il ait aucun moyen d’assumer cette mort autrement que sur un mode pathologique de l’émotion éprouvée devant un mal vis-à-vis duquel il ne peut que se sentir impuissant. En s’identifiant personnellement à cet enfant il ne peut que s’identifier à l’impuissance même de cet enfant mort sans aucun moyen de résister au mal absolu qui lui a été fait. Le souffrance que cette identification sera, en de telles conditions et à cet âge, nécessairement accompagnée d’un sentiment de culpabilité sans cause du fait même de cette impuissance et génèrera des fantasmes mortifères, voire une fascination pour ce mort qui est si proche de lui et qu’il lui faut aimer au point d’en aimer ou désirer inconsciemment cette mort sacrificielle (martyrologie) qui seule pourrait le délivrer d’une culpabilité sans motif, c’est à dire sans limite, ni condition et sans autre résolution possible que religieuse. Celle-ci , nous le savons, fait en effet dépendre la délivrance de nos péchés de l’obéissance à Dieu et aux autorités politico-religieuses dont le pouvoir politique prétend traditionnellement se réclamer.
On voit donc que, par delà l’apparente bonne idée éducative de Nicolas Sarkosy, à savoir lutter contre le racisme et l’antisémitisme dès l’enfance, le moyen qu’il ordonne renvoie à la dimension sacrificielle et religieuse de l’éducation chrétienne traditionnelle : faire du péché infini dont chacun est porteur le ressort essentiel de l’obéissance et de la civilité. Nicolas Sarkosy, nous l’avons vu, est hanté par l’idée fausse et admise comme telle dans nos sociétés laïques et anti-théocratiques, que seul le religieux peut civiliser la société, en oubliant que le religieux divise plus encore qu’il n’unit, sauf à n’admettre qu’une seule religion officielle, sous l’autorité d’une seule église, et à exclure les autres comme attentatoire à l’unité du corps social confondu avec la communauté des croyants, Mais dans une société pluraliste comme la nôtre, rien en effet ne pourrait alors empêcher chaque communauté de faire valoir ses martyrs et le culte qui leur est dû pour valider la valeur particulière qu’il convient de lui accorder : une surenchère sans fin dans le devoir de mémoire aiguiserait la compétition des mémoires entre les prétentions religieuses ou communautaires, au point de mettre en cause, de la une manière la plus radicale, cette civilité que Nicolas Sarkosy, prétend promouvoir. Sans cesse, celui-ci, dans ses discours autour de ce qu’il appelle la « laïcité positive », néglige le fait que chaque religion dans sa prétention à l’absolu du sens et de la vérité universelle s’affronte nécessairement aux autres sans compromis possible en ce qui concerne le fantasme rituel qui la fait vivre : le culte des « ses » morts et "ses" souffrants de "ses" martyrs et de "ses" saints comme condition du salut post-mortem, espérance que Nicolas Sarkosy, affirme comme nécessaire à toute morale authentique.
Cette vision religieuse de la politique est confirmée par la manière dont Nicolas Sarkosy ordonne, sans consultation des acteurs, associations et institutions concernés, une pratique pédagogique et morale d’essence religieuse, sans débat parlementaire et sans prendre l’avis des enseignants, et surtout sans rien dire de la manière de faire réfléchir les enfants, dans la mesure où ils le peuvent à cet âge (10 ans), aux causes politiques et historiques du génocides, y compris l’implication du gouvernement français de l’époque, qui au nom de la France a collaboré avec l’assentiment d’une partie de la population française à l’entreprise génocidaire nazie. Il se veut donc le monarque élu de droit divin, au dessus des lois humaines, qui décide seul du contenu d’un enseignement prétendument « civilisationnel » guidé par une vision transcendante et émotionnelle de l’identité nationale qu’il faudrait transmettre hors tout contexte et mise en perspective rationnelle explicative, laquelle nuirait à l’identification émotionnelle exigée.
Devant le tollé suscité par un tel commandement , le (son) Ministre de l’EN Monsieur Darcos s’est vu contraint de rectifier le tir en affirmant que ce devoir de mémoire devait être entrepris par les enseignants dans le cadre de leur enseignement de l’histoire en faisant faire aux élèves un vrai travail de recherche historique sur les conditions de vie et de mort de l’enfant auquel chacun est invité de s’identifier personnellement ; mais un telle mise au point ne règle rien quant au fond : la contradiction demeure entre une vision émotionnelle et cultuelle de l’histoire transformée en histoire sainte des martyrs de la république, et un authentique savoir générateur d’une prise de conscience active indispensable pour permettre à chacun d’agir sur lui-même pour combattre les réflexe communautaire et religieux d’appartenance exclusive.
Reste que les réactions
critiques et tout à fait lucides de Simone Weil , des
historiens, des pédo-psychiatres, des enseignants et d’un
grand nombre d’intellectuels sont telles que les propos de NS
risquent fort de n’être rien d’autre que l’expression d’un
délire personnel de puissance, de nature religieuse, qu’il
n’aura aucun moyen (et on doit tout mettre en oeuvre pour cela) de
faire passer tel quel dans les classes. Il faut refuser avant tout
comme l’exige S. Weil, toute identification personnelle,
pédagogiquement perverse, des enfants bien vivants à
des enfants morts. C’est la condition de la libération de
la pensée critique des futurs adultes-citoyens en vue de leur
permettre d’assumer l’histoire passée en vue d’un avenir plus
responsable, plus actif et moins « serviliste »
de soi et des autres.
Refusons tout enracinement politico-religieux
Un président de droit divinLa loi, c’est moi !
Considérant du haut de sa fonction que ses décisions ont valeur absolue, il n’hésite pas à aller sur les traces des monarques absolus et à prétendre que la loi ne doit être autre que sa volonté souveraine.
L’article 62 de notre Constitution stipule, en effet, sans ambiguïté, qu’une disposition du Conseil constitutionnel déclarée inconstitutionnelle est sans appel et ne peut être ni promulguée ni mise en application (lire la note 2).
Or,
semble croire le président, puisque la loi a été déclarée
constitutionnelle, même sous condition d’une non-rétroactivité de son
application, cela permettrait, selon lui, de l’appliquer quand même en
tant que constitutionnelle, y compris en ce qui concerne la
rétroactivité. Mais c’est oublier que cette interdiction de la
rétroactivité déclarée inconstitutionnelle est non pas une loi, mais une
disposition, ce qui correspond précisément au libellé de l’article 62.
Ce
faisant, la demande du président est donc anticonstitutionnelle et il
est douteux que la Cour de cassation s’y soumette, sauf à se dresser
elle-même contre la Constitution, ce qui ruinerait instantanément toute
légalité à un éventuel jugement ou avis de sa part contredisant l’interdiction
par le Conseil constitutionnel de l’application rétroactive de la loi de rétention de sûreté
Je fais crédit à Nicolas Sarkozy,
avocat de profession, et à ses conseillers de le savoir, comment
alors comprendre ces propos ?
Une
seule réponse est possible : tenter de jouer l’opinion contre la
Constitution pour instaurer un pouvoir personnel qui prétendrait, au
nom du suffrage universel, outrepasser toute limite constitutionnelle,
garante de nos libertés fondamentales. Il s’agit, à un premier niveau
d’analyse, de jouer le besoin de sûreté dans l’opinion, c’est-à-dire la
peur, contre nos libertés, à quelques jours des élections municipales
Mais, plus profondément, ce qui est en cause dans cette manœuvre, me semble être une conception de la démocratie comme état de non-droit, à savoir une tyrannie majoritaire incarnée par un président disposant du pouvoir absolu de décider de la loi et de son application selon son bon plaisir.
Un Etat despotique disait déjà Kant, après Montesquieu, est un Etat qui
refuse la séparation constitutionnelle des pouvoirs, y compris et
peut-être surtout lorsque cet Etat repose sur le suffrage universel. Nous y
sommes, au moins en parole et il faut tout mettre en œuvre pour qu’elle ne reste que verbale.
"Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement."
Note 2 : article 62 de la Constitution :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Commentaires en réponse
1) NS, que je sache, ne propose aucun modification de la constitution concernant les attributions et l’autorité suprême du Conseil Constitutionnel, laquelle s’impose donc à lui, sans condition.
2) Il n’a pas demandé, non plus, son avis au président de la cour de cassation (qui, en tant que tel, engage cette cour) pour engager une telle modification qu’il ne lui a pas soumis
3) Une telle modification ne pourrait intervenir qu’après un vote du congrès ou un référendum ; ce qui est une toute autre paire de manche et un tout autre problème que celui de la validité constitutionnelle ou non, dans le cadre constitutionnel actuel, de la loi de rétention.
Je n’ai en aucun cas traité du problème de la sécurité dans mon article, mais de la volonté du chef de l’état de contourner et/ou de contredire (et en l’occurrence je ne vois pas la différence) la décision de Conseil constitutionnel ; ce qui ouvre à la possibilité d’une déconstitutionnalisation de l’état, par un coup de force illégal du la président de la République contre un fondement essentiel des droits démocratiques: le respect du principe du droit de la non-rétroactivité de l’application d’une loi. Je ne vois pas en effet comment le président de la cour de cassation qui est interrogé es-qualité et donc engage l’institution qu’il préside, peut , sans mettre cul par dessus tête nos instituions et la hiérarchie constitutionnelle des normes et des institutions qui en ont la charge..
Sur le fond, Je reste persuadé que la sûreté dans un pays de liberté ne peut être totale, sauf à soumettre chacun à en surveillance et à un contrôle permanents. Mais surtout sur ce point, la loi me semble inconséquente et dangereuse dès lors qu’elle se fonde sur l’affirmation de NS que certains criminels sont des monstres, c’est à dire naturellement des criminels à vie.
Inconséquent en ce sens que si l’on pense qu’ils sont tels, alors ils ne sont pas criminels mais définitivement irresponsables donc fous, car incapables de se réhabiliter, et cela ne relève pas d’une procédure et d’une sanction juridique classiques mais d’un enfermement thérapeutique sous contrainte ; lequel existe déjà en droit. (Nul besoin de faire une loi nouvelle pour répondre devant un cas difficile au besoin de sécurité, voire à l’angoisse sécuritaire)
Dangereux en ce sens qu’une telle suspicion concerne non l’acte mais l’intention supposée de récidive ce qui fait de tout criminel un coupable par anticipation et un criminel à vie ; c’est au psy et à eux seuls de dire ce qu’il en est et le CC à eu raison d’assortir cette peine de sûreté de garanties de recours régulier et d’un suivi et d’expertises médicales conséquents.
Enfin il est particulièrement dangereux pour la démocratie de confondre la justice avec la seule défense des victimes ou plus exactement avec l’’exercice par l’institution judiciaire de leur désir de vengeance.
Ce me semble être le cas, (selon la loi du talion) de la peine de mort, maintenant interdite pour ce motif, et/ou de l’emprisonnement à vie qu’implique l’idée même de monstruosité appliquée aux personnes et non aux seuls actes comme l’a fait NS. Je ne peux pas ne pas voir une lien entre cette déclaration par NS de monstruosité quasi-biologique personnelle et sa volonté de faire que les fous déclarés irresponsables soient condamnés comme s’ils étaient coupables, pour satisfaire le désir des victimes, même si on les dispense de punition (et non pas de traitement ; ce qui nous ramène au point développé plus haut.) .
Nous sommes dans une régression du droit, comme l’a dit la plupart des juristes et R. Badinter: Nous passons d’ un droit libéral à d’un droit purement sécuritaire afin de purger fantastiquement et donc fallacieusement l’angoisse des gens.
La question de l’autorité de le Cour Constitutionnelle et du respect de la Constitution est en politique aussi une question de fond. C’est même un question fondamentale en démocratie.
La question de la responsabilité du criminel pédophile ou autre récidiviste que l’on prétend inamendable reste posée du seul point de vue logique. Cette confusion entre surêté et peine est liée à celle qui porte sur la question de la responsabilité et donc de la culpabilité face à la démence.
On sait que NS voudrait que les malades mentaux déclarés irresponsables soient jugés, mais non punis, au nom du désir des victimes d’être reconnues comme telles, en oubliant que le fait d’être victime d’un dément fait de l’acte un accident et ne dénie en rien le fait pour une victime d’être victime de cet acte et donc son droit à réparation à ce titre, sauf à croire qu’une condamnation dépénalisée, laquelle est absurde car elle suppose culpabilité et donc responsabilité donc peine, serait un motif de reconnaissance plus satisfaisant qu’une réparation.
S’ouvre
alors un pas supplémentaire qui réduirait cette absurdité d’un jugement
et d’une condamnation sans peine: faire que tous les fous soient jugés
en tant que tels et punis comme tous les autres au nom d’une justice
non de la responsabilité mais de la seule sûreté. 0n serait alors dans
une vision anti-libérale et démagogique du droit.
La plupart des arguments en faveur de la loi du sûreté repose sur une erreur grave, à savoir que l’on ne peut rien faire juridiquement contre un individu condamné et estimé dangereux au moment de sa libération: nombre de textes impressionnants existent: obligation de suivi médical, contrôles réguliers, assignation à résidence ou limite des déplacements , bracelet médical , internement administratif etc. Le seul problème est que ces mesures ne sont pas appliquées faute de moyens et dire qu’ils ne sont pas suffisants sans avoir constaté qu’ils sont tels pour ne pas les avoir appliqués est d’une totale mauvaise foi.
Le CC à statué par une manoeuvre qui consiste à rendre inapplicable avant 15 ans une loi qui heurte non seulement le principe de la non-rétroactivité de loi tout en admettant pourtant que, en principe, cette rétention n’est pas une peine et donc ne relevant pas du principe, mais une mesure de sûreté qui parce qu’elle prolonge indéfiniment la rétention juridique relève quand même de ce principe(ouf). mais elle heurte aussi la déclaration des droits de l’homme et celle de la charte européenne du même nom au titre des deux articles suivants.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Le CC sait que l’application de cette loi risquerait toujours d’être contestée devant la cour de cassation ou celle des droits des l’homme de Strasbourg, c’est pourquoi il assortit cette application de conditions de suivi médical en détention et de remise en cause régulière de la prolongation de la rétention dans le cadre d’un droit de la défense, lesquelles conditions feront de cette loi une loi qui imposera à l’institution judiciaire et à l’état des moyens à la hauteur du droit du condamné à être soigné et à être défendu.
De deux choses l’une, soit le gouvernement de NS se soumet à la cour constitutionnelle, soit il passe outre mais alors il sera dans la situation de voir l’application de cette loi rejetée par les juges qui sont obligés d’appliquer la censure partielle du Conseil Constitutionnel et les conditions constitutionnelles de son application, quel que soit l’avis du gouvernement, soit il organise une modification de la constitution pour révoquer la déclaration des droits de l’homme. Ce dont il na pas les moyens, me semble-t-il, sauf à organiser un référendum qui, en cas de succès, mettrait la France hors la loi en l’Europe alors que le traité de Lisbonne, y compris la déclaration des droits de l’homme, vient d’être ratifié par le congrès et NS.
Pour le moment la seule issue politique de NS est de mettre réellement en oeuvre les mesures de sûreté existantes et d’en donner les moyens a priori suffisants à l’institution judiciaires de façon à assurer la sûreté des victimes réelles et potentielles des quelques condamnés libérables.
Je rappelle, ainsi que R . Badinter, que nous ne connaissons dans les annales judiciaires qu’un seul cas de récidive d’une pédophile libéré après avoir purgé sa peine.
Tout
ce foin pour un seul cas ? Si ce n’est pas de la démagogie
électoraliste de bas étage, je ne sais pas ce que c’est...
Ségolène Royal, la rénovation du PS et le MoDem
Prenant
à contre-pied les atermoiements et autres querelles personnelles de et
en vue de la direction du PS, Ségolène Royal lance un grand débat
participatif ouvert à tous les militants socialistes sur dix grandes
questions auxquelles sont confrontés les citoyens au vue de l’évolution
du capitalisme mondialisé et de la dérive monarchique de la démocratie
en France générée par la pratique du pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Les questions auxquelles elle demande à tous les socialistes de répondre et au-delà à tous les démocrates de réfléchir afin d’élaborer une ligne politique cohérente au sein de son parti en vue d’une alliance avec ses futurs alliés (dont le MoDem) dans le cadre d’une majorité de centre gauche sont les suivantes :
1. Il faut sortir du fossé entre un discours pseudo révolutionnaire dans l’opposition et un conformisme économique au pouvoir : de quelle façon ?
2. Le socialisme ne peut pas se contenter d’aménager le capitalisme financier à la marge : comment produire et répartir autrement la richesse ?
3. Que reprendre des modèles progressistes des autres pays et que rejeter ?
4. Il faut pousser l’agilité des entreprises, le goût du risque et l’esprit d’entreprendre, tout en améliorant la situation des salariés et leurs sécurités sociales. Avec quel compromis ?
5. Il faut rééquilibrer le rapport de force entre le travail et le capital par une meilleure répartition du profit. Quels contre-pouvoirs dans l’entreprise ?
6. Comment rompre avec la redistribution passive et bureaucratique comme principal moyen de s’attaquer aux injustices sociales ?
7. Comment améliorer le projet européen pour ne pas oublier les intérêts des peuples et des pays ?
8. Les peuples du Nord doivent être protégés de la concurrence internationale sans que les peuples du Sud ne soient victimes du protectionnisme. Avec quelles nouvelles règles ?
9. Les Etats et le marché doivent assurer la sauvegarde écologique de la planète : quel nouveau modèle de développement ?
10. Le Parti socialiste doit intégrer toutes les nouvelles formes de militantisme et d’engagement citoyen, ainsi que les réussites du travail des élus locaux. Il doit aussi décider efficacement, avec le sens de la discipline collective. Quelles nouvelles règles communes pour y parvenir sereinement ?
Remarquons que seule la dernière question est directement adressée au PS en vue de sa rénovation interne, mais toutes les autres sont posées et rendues publiques sur son site "Désir d’avenir" qui s’adresse à tous, pour que chacun, membre ou non de ce parti, puissent y répondre en vue de l’orientation qu’elle entend donner à sa candidature au secrétariat général du PS et à la définition de la ligne de ce parti. Cette rénovation vaut aussi en ce qui concerne les rapports du PS avec le MoDem dont elle a demandé à plusieurs reprise, depuis la campagne du second tour des présidentielles, les élections législatives et les élections municipales récentes, qu’il devienne un partenaire à part entière du PS en vue de la formation d’une majorité de centre gauche nouvelle qui seule pourra(it) l’empoter lors des élections présidentielles en 2012.
Cette dernière demande d’alliance générale a, jusqu’à présent, été refusée par la direction du PS au motif que la MoDem n’était pas un parti situé clairement à gauche ; bien que nombre de responsables du PS dont Martine Aubry à Lille, Guérini à Marseille, Rebsamen à Dijon, etc. l’ont instaurée de fait lors des élections municipales. B. Denanoë a refusé la demande du MoDem d’une alliance à Paris ; mais nous savons que ce refus qui lui a coûté certains arrondissements n’est qu’un gage tactique à courte vue donné aux adversaires au sein de la direction PS d’une telle alliance de centre gauche en vue de préserver ses chances, à mon avis à tort, contre Ségolène Royal au sein de ce parti, alors même que son programme est, sur le fond, indiscernable de celui de cette dernière.
Or, chacun sait que nombre de militants du MoDem sont sur une ligne de centre gauche, voire, me semble-t-il, François Bayrou lui-même aujourd’hui, et que l’on ne pourra vaincre la droite décompléxée de Nicolas Sarkozy, dangereuse pour la démocratie en cela qu’elle tente d’abolir la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, voire d’information et plus fondamentalement politique et économique, sans une alliance entre le PS et le MoDem en vue d’une alternative nationale en 2012. Tous les démocrates doivent dès maintenant engager le dialogue en vue d’impulser cette alliance et militer pour qu’elle devienne générale et officielle au sein des deux formations.
C’est sur la base des questions posées par Ségolène Royal dont ils acceptent la teneur que des militants du MoDem (et qui entendent le rester) ont publié une lettre ouverte à Ségolène Royal pour impulser dans les deux partis ainsi qu’entre eux l’exigence d’un tel dialogue.
Ils y font en effet la déclaration
suivante, en forme d’engagement militant :
« Votre parti et le nôtre sont face à un problème commun : comment envisager son voisin politique ? Méfiance, défiance et rejet ou séduction, alliance et partenariat ? Nous pensons que cette question ne peut pas être sans arrêt repoussée par les dirigeants du Mouvement Démocrate. Elle est devenue pour nous nécessaire. Notre identité est liée à tout cela. En tant que simples militants nous souhaiterions avancer sur ce sujet.
Depuis plusieurs mois déjà, nous observons le respect que vous avez à l’égard de notre formation politique, pour nos valeurs et pour notre leader, alors que bon nombre de personnalités politiques s’empressent de délégitimer notre existence même. Pour beaucoup, notre présence est condamnable. Vous avez le mérite de considérer notre démarche comme nécessaire et utile. Beaucoup d’électeurs de François Bayrou vous ont fait confiance au second tour de l’élection présidentielle. Nous en faisons partie.
Depuis mai 2007, nous continuons à construire notre voie, la troisième voie, sans relâche. Nous ne renonçons pas. Notre combat est juste. Mais, le centre ne signifie pas pour nous le sectarisme. Bien au contraire. "Travailler avec des gens de sensibilités différentes" : telle est notre ambition. Pourquoi ne pas commencer tout de suite ? Nous avons conscience que, par une telle démarche, nous allons choquer, au sein même de notre propre "camp". Mais nous avons soif de dialogue, de débat et de partage avec les autres familles politiques. La démarche nouvelle que vous inaugurez dans Le Monde, cette après-midi, fait preuve d’ouverture : "La consultation s’adresse aux militants du PS, en lien avec les sympathisants et les forces vives qui attendent beaucoup de nous face aux dégradations de toutes sortes commises par la droite".
Aujourd’hui, nous pensons utile d’engager une discussion avec vous. Pourquoi un partenariat PS-MoDem à l’avenir ? Pour aller où ? Sur quel projet ? Sur quelle conception de la politique ? Notre combat a été de sortir du giron d’un appareil politique, en l’occurrence, le RPR-UMP. Et nous ne souhaitons nullement retourner sous un régime de domination avec le PS. Alors, comment réfléchir à un nouveau type de partenariat, capable de respecter nos idées et notre indépendance ? Toutes ces questions, nous souhaiterions en débattre. Nous aimons le MoDem. Nous y sommes bien. Nous sommes fiers de notre parcours politique.
Dans le texte que vous venez de publier, vous vous intéressez à ce qui fait la force d’une formation politique : les adhérents, les militants avant tout. Ce respect du militant : nous l’admirons.
Nous entamons maintenant la quête de notre projet. Nos aventures se suivent en parallèle. Nous avons observé beaucoup d’idées communes : refus de la loi de rétention de sûreté, des tests ADN, de la réforme de la justice, collusion entre puissances économiques et puissances médiatiques, la quête d’un état impartial, etc. Dans Le Monde d’aujourd’hui : vous lancez dix questions : ce sont les mêmes que nous partageons, et qui font débat auprès des militants. »
Nul doute que cette initiative doit réjouir tous ceux qui veulent un authentique changement démocratique et social en France et plus largement en Europe et dans le monde. Les choses avancent, à chacun, sans abdiquer de son esprit critique, de se montrer à la hauteur de cette évolution en participant, comme nous y invitent ces militants du MoDem, au dialogue proposé par Ségolène Royal, François Rebsamen Vincent Peillon, Jean-Louis Bianco, Manuel Valls, Gilles Pargneaux, Delphine Batho, David Assouline, Guillaume Garot, Aurélie Fillipetti, Michel Sapin, Jean-Pierre Mignard, Jean-Jack Queyranne, Jacques Auxiette, Nadjat Belkacem, Pascal Terrasse, Dominique Bertinotti, Michèle Delaunay, Jean Guerard. Et, très modestement, l’auteur de ce présent article, membre du PS.
Reste à Ségolène Royal, dont on doit saluer le courage politique, à répondre favorablement, contre certains de son parti et sans hésitation tactique qui risquerait de disqualifier sa proposition aux yeux des nombreux militants du PS qui la soutiennent, à cette avancée politique qui LUI est faite directement par ces militants du MoDem.De Bergson à Nicolas Sarkozy : la place du religieux dans le cité
La position de NS, comme l’a excellemment souligné l’auteur de l’article publié dans AV, intitulé « Derrière le rideau du néo-sarkovatisme » (lien à la fin de l’article), est un compactage purement rhétorique d’une pseudo-rationalité économiste automatique dans laquelle la société se dissoudrait dans un individualisme de l’intérêt privé sans aucune perspective d’ensemble qui serait liée à une définition quelconque de la justice en termes de rapports de forces sociaux et de réduction des inégalités réelles et sa compensation fantasmatique par la truchement de valeurs traditionalistes afin de faire diversion vis-à-vis de la frustration que génèrent ces inégalités. Comment comprendre un syncrétisme aussi baroque, que d’aucuns appelleraient post-moderne ?
Nous retrouvons là, semble-t-il, le fameux supplément d’âme que Bergson revendiquait pour que survive la possibilité d’une sociabilité par-delà le prétendu matérialisme de l’idéologie économiste qui consiste à prétendre mensongèrement qu’il serait possible de transformer les rapports économiques en simples calculs d’efficience à la marge sans que les rapports sociaux et idéologiques en soient la condition, alors même que cette idéologie pseudo libérale s’affirme comme une idéologie mystifiante et mystificatrice en ce que, précisément, elle dénie, à savoir :
que tout rapport économique est un rapport social qui met en jeu des désirs et des valeurs et des relations de pouvoirs déterminés entre ceux qui commandent, ceux qui se soumettent ; et
que la confiance est la condition de tout échange économique et que celle-ci est toujours politique et psychologique, c’est-à-dire commandée par des valeurs et des désirs en conflit.
Mais Nicolas Sarkozy n’est pas Bergsonnien, car il n’est en rien mystique. Bergson en effet faisait d’individus exceptionnels, mais sans pouvoir de commandement, marqués par une expérience révélatrice strictement individuelle, des exemples entraînant les autres, sans aucune contrainte ou menace, vers de plus hautes valeurs que les valeurs matérielles, des valeurs spirituelles généreuses et d’amour désintéressé, ouvrant la société vers un dépassement des égoïsmes individuels.
Il refusait le pouvoir clérical dominant les esprits qui, selon lui, ne pouvait provoquer que la démoralisation intérieure sous le couvert hypocrite d’une morale extérieure rigide. Tout au contraire, Nicolas Sarkozy voit dans les églises des machines de pouvoir indispensables sur les âmes pour assurer une police sociale qui vise à imposer le respect des traditions définissant la société close ou conservatrice, à l’opposé de la société ouverte à l’initiative de chacun et donc authentiquement libérale que Bergson appelait de ses vœux. Il s’agit probablement d’un rêve utopique si l’on prétend en faire une politique : aucune société ouverte et pluraliste ne peut être mystique, sauf à se transformer en secte totalitaire.
Or, Nicolas Sarkozy, lui, ne rêve pas : le partage des pouvoirs, mais non leur autonomie et encore moins leur séparation, est par lui clairement défini :
 à l’argent et à ceux qui en ont pour investir de
commander l’économie dans le cadre d’une économie de la
croissance du profit prise comme fin en soi ;
à l’argent et à ceux qui en ont pour investir de
commander l’économie dans le cadre d’une économie de la
croissance du profit prise comme fin en soi ;
 à l’Etat, dans lequel la police et
l’administration ont barre sur la justice le pouvoir de réprimer
les corps et à restaurer le pouvoir du capital, menacé
par les contradictions sociales qu’il génère comme les
nuées portent l’orage ;
à l’Etat, dans lequel la police et
l’administration ont barre sur la justice le pouvoir de réprimer
les corps et à restaurer le pouvoir du capital, menacé
par les contradictions sociales qu’il génère comme les
nuées portent l’orage ;
 aux Eglises (y compris aux imams) de prendre le contrôle
sur les esprits, dans le sens de la restauration des traditions
anti-libérales et des morales liberticides.
aux Eglises (y compris aux imams) de prendre le contrôle
sur les esprits, dans le sens de la restauration des traditions
anti-libérales et des morales liberticides.
Le seul problème est que pour lui la France reste encore très attachée aux principes de la laïcité. Or, c’est là, pour son projet, un obstacle essentiel : les deux premiers pouvoirs ne peuvent apparaître comme légitimes que s’ils se donnent l’alibi religieux traditionaliste qui ne peut s’imposer que sous la férule des Eglises et des prêtres de toutes confessions. Rien de tel que les Eglises et les prêtres pour assurer en dernier recours la police sociale, mais encore faut-il des croyants et des fidèles qui ne peuvent être tels à l’âge adulte que si on soumet l’éducation des enfants, à savoir l’école, de moins en moins publique et de moins en moins ouverte à l’esprit critique, à la douce tutelle religieuse.
Ce projet est chez nous résistible, j’en veux pour preuve que les propos de Nicolas Sarkozy apparaissent de plus en plus pour ce qu’ils sont : de très triviales tentatives de manipulations sur fond de culte des morts ; ses propos sur la mémoire et l’Histoire sont débarrassés de toutes signification politique ; ils sont aussi éculés, face à la montée des inégalités et d’un capitalisme irresponsable, y compris sur le plan économique (vis-à-vis duquel il n’a du reste qu’un pouvoir dérisoire de diversion ponctuelle) que celui des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, lorsqu’ils prétendent que seule l’Eglise catholique à vocation de droit divin (infaillibilité pontificale) à incarner la splendeur de la vérité moralisatrice et civilisatrice dans le monde.
Cette manipulation est aussi platement cynique que l’injonction économique à prétention morale de feu Guizot : « Enrichissez-vous par le travail et l’épargne ! » ici-bas, auquel il suffit alors à Nicolas Sarkozy d’ajouter : « et la religion vous promet le paradis au ciel »...
Lire
Article sur AV : "Derrière le rideau du néo-sarkovatisme"
"Bergson entre la logique de la guerre et la mystique de la paix"
Et Bergson : "Les deux sources de la morale et de la religion."« C’est en franchissant les frontières que l’on bâtit les pays pionniers »
C’est fait, François
Bayrou a franchi le Rubicon : il prône ouvertement le
« rassemblement » avec les socialistes. « Nous
aurons bien besoin les uns des autres », a-t-il affirmé, lors de
l’université d’été du MoDem le 07/09/08 ; c’est là enfin la formule
décisive en vue de promouvoir la nécessaire alliance de centre-gauche
qui est la seule alternative crédible de gouvernement au pouvoir
ultra-personnel et trop peu soucieux des libertés démocratiques de
Nicolas Sarkozy dans notre pays ; elle ouvre, enfin franchement, une
porte déjà entrebâillée par certains au PS dont Ségolène Royal entre
les deux tours des élections présidentielle de 2007 et Vincent Peillon
tout récemment dans un entretien à Libération.
Quelles évolutions politiques un tel rassemblement exige-t-il et un tel objectif exprime-t-il ?
Dans la famille dite « centriste » tout d’abord, François Bayrou dirigeant du MoDem brise un tabou que le ralliement à Nicolas Sarkozy de nombreux de ses amis du Nouveau Centre avait déjà désacralisé : celui d’un centre ni droite ni gauche. Tout indique aujourd’hui que, face au danger pour la démocratie politique et sociale qu’incarne la politique de droite décomplexée de Nicolas Sarkozy (Edvige, justice, presse, démantèlement des droits sociaux et bouclier fiscal, etc.), ce que j’avais toujours affirmé dans mes article et commentaires précédents sur Agoravox se confirme : face à la droite dure, les centristes du MoDem, au contraire de leurs ex-amis du Nouveau Centre ralliés à Nicolas Sarkozy, sinon à l’UMP, ne peuvent maintenir leurs valeurs humanistes et démocratiques qu’en s’alliant avec un PS rénové débarrassé des oripeaux sectaires de la gauche prétendument marxiste qui prétendrait opposer démocratie socialiste et démocratie politique et, sur cette base, refuserait l’Europe plus ou moins démocratique telle qu’elle se construit progressivement dans le débat indépassable entre la gauche et la droite et sur fond de la tension fructueuse entre les libertés personnelles et la solidarité sociale.
Au
PS et à gauche ensuite, ce rassemblement signifie la fin d’une union de
la gauche dite « plurielle » intégrant l’extrême gauche et qui
refuserait toute collaboration avec les authentiques démocrates qui
font confiance au MoDem et à son chef pour faire avancer la démocratie
politique et donc sociale dans notre pays. Il passe, au sein du PS, par
la victoire à sa direction, maintenant ou plus tard, de tous ceux qui
refusent la division et assument en le déclarant nettement ce choix
stratégique que certains condamnent expressément sur le plan national
pendant que d’autres ou les mêmes le pratiquent, sans toujours dire
pourquoi et en vue de quoi, sur le plan local. La conclusion des études
des élections lors des dernières municipales est claire : la grande
majorité des électeurs du MoDem ont voté pour l’alliance avec le PS et
non avec l’UMP. Mais, pour élargir l’espace démocratique dans notre
pays, le PS doit, face à cette avancée politique de centre gauche, se
débarrasser de ses mythes et de ses dogmes étatistes confondant la
défense du service public avec celle des intérêts corporatistes de ses
fonctionnaires et le socialisme démocratique avec l’étatisme
hyper-centralisé que Nicolas Sarkozy est en train de ressusciter à
droite, aux dépens des libertés individuelles et des acteurs sociaux.
La crise de la direction que connaît le PS aujourd’hui doit être
considérée comme une crise de croissance et cette question de
l’alliance avec le MoDem comme une des conditions de son issue
positive. C’est ce qu’ont compris, chacun dans son camp et à sa
manière, aussi bien François Bayrou que Ségolène Royal et Vincent
Peillon. On ne peut que s’en féliciter pour la défense de la démocratie
dans notre pays.
Toute crispation identitaire qui menacerait ce nécessaire
rassemblement ne pourrait être qu’un royal cadeau fait à la politique
de Nicolas Sarkozy...
De Descartes à Benoît XVI ou de l’impossibilité de concilier rationnellement foi et raison
Benoît XVI prétend nous (re)faire le coup classique de sauver la foi au nom de la raison et la raison au nom de la foi. Mais, pour ce faire, il lui faut faire l’impasse sur le fait que la preuve rationnelle de l’existence de Dieu que l’on attribue à tort ou à raison à Descartes a été contestée par Pascal, au nom de la foi, et par Kant, au nom de la raison. Qu’en est-il de cette prétendue réconciliation du point de vue de l’histoire réelle, de Descartes à Pascal et Kant, du conflit bien réel entre la philosophie rationnelle et la révélation ?Descartes pouvait penser, par le recours au doute méthodique, que la pensée pouvait être ontologiquement une substance indépendante de l’étendue ou du corps et du cerveau. Selon lui, je peux penser que je n’ai point de corps, mais je ne peux penser que je ne pense pas et, tant bien même la pensée que je n’ai point de corps serait fausse, il reste vrai que je pense. Ainsi la pensée serait donc première par rapport au corps du fait que mon corps ne peut exister pour moi qu’en tant que je pense vraiment ou faussement qu’il existe et que la pensée est, en cela et par soi, irréfutable dans son indépendance par rapport au corps. Ceci veut dire que pour Descartes on ne peut penser la dépendance de la pensée par rapport au corps dès lors que cette prétendue dépendance dépendrait ontologiquement de la pensée que j’en ai et que par conséquent cette pensée se contredirait elle-même. Nous serions dans la contradiction bien connue du menteur avoué qui affirme qu’il ment. S’il dit vrai il dit faux et s’il dit faux il dit vrai.
Ceci dit si la pensée, lorsqu’elle pense le corps, peut se tromper, y compris quant à la pensée (croyance et non pas savoir) de l’existence objective (indépendante) de ce dernier, rien ne dit que lorsqu’elle pense le corps et le monde, voire les autres, elle ne se trompe pas toujours en croyant que ceux-ci existent en dehors de la pensée du sujet qui les pense. La pensée serait alors dans un doute radical, sauf à affirmer que rien n’existe en dehors d’elle et que le monde extérieur à elle n’est que sa création ex-nihilo, Dieu compris. Cette affirmation condamnerait la pensée à ne pas pouvoir sortir d’elle-même (solipsisme) et à ne rien dire du monde extérieur ni de Dieu qui puisse correspondre, selon la définition classique de la vérité, à un objet réellement existant. Elle pourrait affirmer tout et le contraire de tout sur n’importe quoi, sauf que la pensée existe et est la seule substance existante par soi. La vérité des choses lui échapperait définitivement. L’affirmation du doute deviendrait à ce point radicale qu’elle conduirait au scepticisme intégral. Rien de ce que la pensée peut penser en dehors d’elle-même ne pourrait être vrai. La certitude de la vérité de la pensée de l’existence indépendante de la pensée conduirait donc à l’impossibilité de toute vérité objective !
Refusant cette pente fatale, Descartes réinvente la preuve ontologique, sans sortir de la pensée, de l’existence de Dieu comme fondement de la vérité d’une pensée qui peut penser le corps et le monde extérieur comme réellement existants. C’est ce qu’il est convenu d’appeler la preuve ontologique de l’existence de Dieu que, à la suite de Descartes lui-même dans sa correspondance, on peut résumer de la manière suivante : si je pense que Dieu est parfait, cette idée de perfection ne peut exclure l’existence objective de Dieu, laquelle existence est une perfection, sauf à se contredire ; donc Dieu existe par définition en tant qu’il est par définition parfait.
On peut rétorquer que cette preuve n’en est pas vraiment une, car la cohérence de la pensée ne dit rien sur la réalité de son objet. Ce sera la critique qu’adresse Kant à cette prétendue preuve : on ne peut conclure de l’idée à la réalité de son objet qui pourrait, même cohérente, n’être une pure illusion de l’esprit qui pense que Dieu est parfait. Rien ne permet d’assurer, sinon une définition idéale et toujours discutable, que Dieu est parfait et qu’il existe à ce seul titre. Toute définition est en soi susceptible d’être arbitraire ou sans fondement objectif quant à la réalité de ce qu’elle affirme. Et du reste Pascal déjà avait vu que derrière cette prétendue preuve il n’y a que la foi et non la raison pure. Dieu reste une vérité du cœur (ou du désir de ne pas mourir) et non de la raison. Une révélation mystique (et donc un mystère) et non un objet rationnel démontrable. La preuve de Descartes ne serait qu’une rationalisation sophistique d’une vérité plus haute que la raison, voire irrationnelle, dès lors qu’on en manifeste les difficultés logiques internes que l’on appelle les mystères (trinité, résurrection, immaculée conception, etc.). Le Dieu de Descartes est pour Pascal le Dieu des philosophes et donc un Dieu de raison et à ce titre toujours discutable, non un Dieu d’amour qui puisse sauver les hommes de la mort par amour, non le Dieu de la foi, mais un « Deus ex-machina » pour fonder la vérité de la connaissance objective comme vérité absolue, ce qu’elle ne peut pas être dès lors qu’elle ne peut être qu’expérimentale, c’est-à-dire relative à l’expérience, comme l’avait établi Pascal à propos du vide et de l’équilibre des pressions et Galilée à propos de la chute des corps.
Mais si l’existence de Dieu relève de la révélation et non de la raison , elle est aussi attaquable par la raison en tant que possible illusion, et devient un objet de dispute, comme n’importe quel objet de dispute, sans avoir l’expérience comme critère de validité et de détermination de son objet, selon ce que dira Hume. La croyance en Dieu est donc précisément désacralisée ; elle tombe instantanément de son piédestal religieux dogmatique et cultuel. La prétendue preuve rationnelle de l’existence de Dieu démystifie et désacralise la religion et introduit le ver philosophique du doute dans le fruit de la vérité révélée absolue. Le conflit entre foi et raison ressurgit aussitôt : il faut que la raison abdique de son pouvoir de démonstrativité ou de preuve ontologique pour que la vérité de la foi, comme croyance absolue de la vérité absolue de l’existence de Dieu, puisse s’affirmer, y compris contre elle, comme l’avait compris Pascal. Si Kant lui-même prétendait sauver la foi sur le plan pratique par le recours à la croyance en Dieu comme postulat (et non pas vérité de savoir) nécessaire selon lui pour rendre possible la morale absolue de l’impératif catégorique qui consiste à faire son devoir absolument ou sans condition par devoir, il ne pouvait prétendre à la vérité de cette croyance et donc à la possibilité indiscutable, pour des hommes sensibles et désirants, de la pratique d’une morale du sacrifice de soi (de son bonheur) au devoir aussi exigeante.
Ce qui semble en effet avoir échappé à Benoît XVI (ce que je ne pense pas, mais il évite le problème pour la mauvaise raison que l’on sait, à savoir « rétablir le thomisme, pourtant défait par la modernité, qui fait de la raison la servante de la foi), c’est ce mouvement vers la modernité auquel nous introduit le débat entre Descartes d’un côté et Pascal et Kant de l’autre ; débat qui devrait lui interdire d’affirmer que foi et raison seraient rationnellement complémentaires et non en position de conflit latent ou ouvert sur le terrain de la connaissance et au-delà de l’éthique. Sa tentative de sauver la soumission de la raison à la foi et de rationalisation réciproque de la foi est vouée à l’échec : telle est la leçon de la modernité. Cette leçon ne doit pas seulement se cantonner à la connaissance, mais aussi à la morale et à l’éthique dès lors que la prétendue connaissance religieuse de la vraie morale est tout aussi rationnellement discutable que celle de la vraie connaissance. L’éthique, pas plus que la politique, ne peuvent se réclamer d’une vérité divine transcendante pour s’imposer, sans conflit rationnel possible, à la société.
Face
à ce combat douteux de Benoît XVI contre la liberté de la raison
vis-à-vis de la foi dans tous les domaines et y compris contre elle, il
est bon de revenir à l’histoire de la philosophie dont pourtant il se
réclame pour rétablir la laïcité dans son droit à faire de la raison
critique, sur le plan social et plus encore politique, le seul juge de
la valeur de nos savoirs et de nos croyances éthiques.
De l’illusion religieuse
Commentaires et précisions:
Doute, foi et vérité
Est douteux ce qui ne peut
être démontré ou prouvé comme vrai et qui pourtant est présenté comme
tel. Ce n’est donc pas uniquement sur le contenu d’une proposition (ex.
"Dieu existe en dehors de ma pensée ou de mon imagination) que porte le
doute que sur le fait que l’on affirme comme vrai ce contenu sans
pouvoir en apporter la preuve pouvant avoir valeur pour le non-croyant
et c’est cet écart entre le prétendue vérité du contenu et
l’impuissance à l’établir comme telle qui constitue l’illusion
métaphysique.
Celle-ci n’est donc pas une simple erreur, mais une proposition non
démontrable prise comme une vérité indiscutable et fondamentale. ce que
fait le pape lorsqu’il affirme que l’existence de Dieu est plus qu’une
simple croyance subjective indémontrée mais qu’elle est l’objet d’une
révélation (foi) qui en fait une vérité indémontrable objective, comme
si l’intensité de la foi suffisait sur le plan rationnel à établir la
vérité de son contenu, ce qui est proprement absurde.
De deux choses l’une en effet:
 soit la vérité de la proposition qui affirme que l’existence objective
de Dieu est rationnellement démontrable, alors une réconciliation entre
la foi dans cette existence et la raison est non seulement possible
mais impérative.
soit la vérité de la proposition qui affirme que l’existence objective
de Dieu est rationnellement démontrable, alors une réconciliation entre
la foi dans cette existence et la raison est non seulement possible
mais impérative.
 soit elle ne l’est pas, alors il est fallacieux et vain de prétendre
que la raison peut renforcer la foi, sauf à faire d’elle une simple
auxiliaire (servante) de son contenu dogmatique dès lors qu’elle se
refuserait à l’interroger quant à sa validité, mais ce serait refuser
la rôle critique de la raison . ce qui est proprement irrationnel.
soit elle ne l’est pas, alors il est fallacieux et vain de prétendre
que la raison peut renforcer la foi, sauf à faire d’elle une simple
auxiliaire (servante) de son contenu dogmatique dès lors qu’elle se
refuserait à l’interroger quant à sa validité, mais ce serait refuser
la rôle critique de la raison . ce qui est proprement irrationnel.
Dira-t-on que la raison doit se limiter à lutter contre les
débordements plus ou moins fanatiques et violents de la foi, sans en
contester le contenu ?
Mais alors ce serait la raison qui devrait se faire juge de la foi et
de ses modes d’expression et elle ne pourrait être simplement à son
service, dès lors que l’on ne peut distinguer la foi en une vérité
absolue sacrée et incontestable des pratiques qu’elle génère puisque
ces pratiques se réclament de cette dernière. C’est la croyance dans
l’absoluïté de la vérité universelle divine qui est source de fanatisme
plus ou moins violent.
C’est
dire que la raison ne connaît aucune limite à son pouvoir critique, y
compris de la foi, de son contenu et de ses modes d’expression, sauf à
renoncer à ce pouvoir face à l’autorité prétendue, car indémontrable de
la révélation, laquelle suppose toujours l’existence réelle de Dieu
hors de la pensée du croyant, à savoir sa vérité universelle.
______________________________________________
Du statut de la preuve ontologique chez Descartes
Descartes a donné, pour sortir du doute
méthodologique (donc de soi comme sujet du doute radical), de la preuve
d’Anselme la forme d’une preuve quasi (onto)logique et une portée comme
fondement de la possibilité de la connaissance rationnellement vraie.
Ce qui n’était pas le propos d’Anselme. Chez Anselme la foi est
première et dernière, chez Descartes le sujet est premier et sa foi ne
peut seule le conduire à la vérité scientifique sans que l’existence
objective de Dieu soit établie en raison.
C’est pourquoi
c’est la preuve (onto)logique de Descartes qui a été le point de départ
du débat philosophique avec Pascal et Kant etc...Tout dépend si l’on
prend au sérieux le doute cartésien comme effectivement radical ou si
l’on n’en fait qu’une représentation rhétorique habile qui ne prouve
rien d’autre que le contenu d’une foi préalable incontestable pour
tenter de convaincre l’incroyant comme le suggère lui-même Descartes
dans les "principes de la philosophie". Mais il y a plus: Descartes
cherche à établir la vérité de la science comme indépendante de la
théologie officielle (et cela contre les théologiens qui ont condamné
Galilée) et cela l’oblige à prouver que Dieu existe en tant que
condition de possibilité de la connaissance scientifco-mathématique et
expérimentale (avec des réserves quant à cette dernière) qui, tout à la
fois ,dépend de Dieu, mais nous délivre de cette dépendance vis-à-vis
de la théologie, dans le but de faire progresser le savoir ! (Ouf)
Précision
1) j’avoue ne pas comprendre que l’on puisse douter tout en ayant la
foi sans que ce doute rationnel ne mette la foi en doute ou en jeu,
sauf à refuser a priori et du point de vue de la raison
arbitrairement (et non pas du point de vue du désir ou comme le dit
Pascal du coeur) de mettre en doute l’existence de dieu pour préserver
l’essentiel de sa foi.
2) ce refus se fonde sur une révélation mystique dont la raison n’a
aucune raison rationnellement suffisante de s’interdire de faire la
critique.
3) Or cette révélation ne peut se présenter comme
une vérité universelle (ou catholique), elle ne peut donc valoir comme
vérité que contre le pouvoir critique de la raison.
C’est bien la critique que j’adresse à Benoit XVI : prétendre au nom de
la réconciliation désirée par lui en tant chef de l’église catholique
entre la foi et la raison interdire à la raison de refuser de croire à
l’existence de Dieu comme en une vérité universelle.
Ce qui est au coeur de la position du pape et de Nicolas Sarkozy est de
déclarer mauvais, tant du point de vue de la raison éclairée par la
foi, que de la foi régulée par la raison, l’athéisme ; ce qui veut dire
que la foi n’est pas contestable et que toute contestation par la
raison de la foi (existence de dieu) comme vérité universelle (et non
comme simple croyance particulière) est nécessairement mauvaise.
Cela ne fait pas de sa position une vérité raisonnable mais une simple
croyance aussi discutable que celle de l’existence de Dieu ou que celle
de la trinité ou de l’immaculée conception ou surtout que celle de l’infaillibilité pontificale. Infaillibilité qui, n’a de sens que pour celui qui y croit.
Le capitalisme sauvage est mort, vive le capitalisme régulé !( ?)De tous côtés la rumeur médiatique enfle : le capitalisme financier se serait suicidé par excès boulimique de ses dirigeants. Partout et d’abord en en son cœur états-unien, la politique est appelée à la rescousse pour rétablir le capitalisme sur des bases économiques industrielles saines qu’il n’aurait jamais dû abandonner, au service d’un taux de croissance et de développement durable raisonnable en richesses réelles de quelques %.Un tel retournement idéologique laisse sans voix ceux-là mêmes qui avaient annoncé la crise, sinon pour dire qu’ils l’avaient bien dit et qu’il conviendrait maintenant de réguler le capitalisme pour sauver sa dynamique fondamentale en le socialisant. Mais ils sont en cela accompagnés par ceux-là mêmes qui quelques temps plus tôt disaient que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Plus de conflit entre libéraux hyper et libéraux sociaux. Le libéralisme n’est libéral que par une régulation politique qui rétablirait le jeu normal des acteurs qui suppose la confiance dans la valeur et le crédit que l’on s’accorde les uns aux autres grâce à des institutions politiques capables d’assurer les équilibres économiques et sociaux et à la vertu de dirigeants financiers soucieux de mettre leur compétence supposée au service du bien public en renonçant à faire de leur pouvoir un lieu d’enrichissement privé personnel et collectif illimité. Face à une crise potentiellement mortelle, cette unanimité plus ou moins honteuse (voir l’abstention du PS) pour sauver le système, se comprend de par l’absence de tout autre alternative à court terme : il faut sauver de toute urgence le système de crédit et restaurer la confiance sur laquelle repose les fondamentaux de toute économie de production et d’échange. Il faut voler au secours des institutions financières par la seule garantie qui vaille : celle des Etats dont on sait qu’ils ne peuvent être en faillite grâce au pouvoir de lever l’impôt. Il faut d’abord mettre la finance sous perfusion pour seulement ensuite envisager un traitement de fond de sa boulimie délirante. Soigner un malade déjà mort serait une absurdité manifeste. Mais cette boulimie du profit pour le profit disent les anti-capitalistes patentés n’est-elle pas l’état normal de toute économie capitaliste et l’impérialisme du capitalisme financier que l’on rend responsable de la crise n’est-il pas inscrit dans la logique même de l’économie capitaliste mondialisée ? Certainement, mais la forme de cette mondialisation et l’autonomie exorbitante de la sphère financière qui en est résultée a précisément instauré une dictature économico-politique d’autant plus despotique qu’elle est anonyme et sans lieu de pouvoir centralisé, dictature baptisée par une anti-phrase ultralibérale, au mépris de toute l’Histoire, très conflictuelle sur ce point, de la pensée libérale. Le libéralisme ultra est précisément suicidaire et liberticide telle est la première conclusion que l’on doit tirer de la crise. Or, il y a en a une seconde : cet ultralibéralisme despotique ne peut l’avoir temporairement emporté que parce qu’il a secrété une idéologie anti-politique et que cette idéologie a conquis le pouvoir politique lui-même par la voie formelle de la démocratie en faisant du capitalisme hyper-libéral une extension fantasmatique de la démocratie individualiste... C’est là que réside précisément le nœud de la manipulation politique du despotisme pseudo-libéral, à savoir avoir su masquer, à coup de fausses promesses libertaires ou libertariennes et en stimulant l’hystérie consommatrice narcissique et compétitive, toute la contradiction irréductible entre la démocratie politique qui vise la solidarité et la réduction des inégalités réelles en vue de la concorde civile et la logique du profit privé en tant que seul but possible de l’économie et de l’idéologie capitaliste. (Travailler et/ou investir plus pour gagner plus comme seul principe de la politique économique et sociale.) Ce qui est en cause dans cette unanimité anti-capitaliste financier que notre gouvernement voudrait voir avaliser par le PS au nom de l’unité nationale, c’est bien la délégitimation de cette idéologie politique dite ultralibérale. Le capitalisme n’est pas démocratiquement légitime, sauf au prix d’un mensonge qui est aujourd’hui défait et sans effet politique. Reste au PS et à tous ceux qui se réclament de la démocratie de proposer une alternative politique qui restitue la légitimité sociale à la démocratie. Or, c’est bien là que la bât blesse : l’ultralibéralisme délégitimé ne suffit pas à restaurer la confiance dans la démocratie parlementaire. Celle-ci subit nécessairement le contrecoup de sa défaite face à l’idéologie ultralibérale. Sauf à soumettre le capitalisme à des normes sociales plus justes, tout en sachant que ces normes, le capitalisme n’aura qu’un but : les détourner, la légitimité de la démocratie subit le même sort que celle du capitalisme dérégulé. Ce que les citoyens savent d’expérience, c’est que la confiance relative dans l’économie, y compris capitaliste, suppose d’abord la confiance dans la démocratie égalitaire ; or, celle-ci ne peut s’imposer que dans un conflit politique et social permanent contre la logique du capital livré à lui-même. Le
capitalisme pacifié est un mythe anti-démocratique. L’économie étatique
administrée et antilibérale ayant conduit et conduisant nécessairement
au totalitarisme politique et social, la régulation démocratique
internationale du capitalisme sera un combat social et politique
perpétuel ou ne sera pas ; il ne laisse aucune place à l’unanimisme
national que la droite, toute honte bue au regard du bouclier fiscal et
de la quasi-suppression des droits de succession, prétend mener au nom
d’un libéralisme régulé afin de préserver la logique et de restaurer la
légitimité compromise du profit privé comme seule fin de la vie sociale. Le 16/10/08 Capitalisme et désir |
PS : Elections, coups fourrés et pièges à cons !
|
Les élections au PS ont échoué pour les deux camps ; Il n’y a pas match nul, mais nullité du match. Le résultat en est que le parti est, en l’état, ingouvernable, comme le reconnaît François Hollande lui-même qui n’est pourtant pas étranger à ce fiasco. Le PS est ingouvernable, non seulement parce que les 42 voix supplémentaires de Martine Aubry sur plus de 130000 ne sont pas, sur fond d’alliances disparates d’ambitions contradictoires, suffisantes pour gouverner et que le Tout Sauf Ségolène (TSS) ne fait pas une politique, mais parce que ces élections font d’un très grand nombre de fédérations des opposants en puissance à la direction de Martine Aubry et des ses (faux) amis. Le tout sauf Ségolène fait de la prétendue victoire de Martine Aubry, après les majorités relatives successives en faveur de la première aux deux tours qui ont précédé ce fiasco, une victoire sans lendemain et je ne vois pas comment sa légalité juridique apparente ne peut pas ne pas entrer en contradiction avec sa légitimité politique réelle . La légalité juridique de ces élections et leur échec est à mettre en perspective avec leurs conditions formelles. Un congrès dans lequel les opposants à Ségolène Royal ont refusé toute discussion et ouverture autour de la motion majoritaire (et ce contrairement à la règle traditionnelle) ne pouvait que préparer au pire (comme l’avait aussi annoncé François Hollande) ; mais aussi , on le dit moins, un système contradictoire d’élection dans lequel le scrutin concernant l’instance de délibération ou de décision du parti se fait à la proportionnelle alors que celui de la direction se fait au scrutin majoritaire est à incriminer. De plus, dans aucune démocratie, les deux tours ne se font à un jour d’intervalle, interdisant toute réelle discussion entre les candidats retenus en ceux qui ont été éliminés. De même la règle qui exige que tous les votants soient physiquement présents sur les lieux du vote (définis par les sections et fédérations) contribue à favoriser l’éventuel contrôle physique des adhérents par les responsables des sections (dirigeants du parti) et des fédérations (motions) pour renforcer leur pouvoir et leurs marges de manœuvre. Enfin n’oublions jamais que les élections sont aussi un moyen pour des élus ou candidats de conquérir ou de conserver des clientèles elles-même dépendantes directement ou indirectement dans leur carrières et revenus de leurs dirigeants élus . Ainsi, dans le cas
présent, Il est plus que probable, comme le dit Manuel Valls,
que ces élections aient été manipulées.
Il est permis d’avancer trois indices qui en rendent les résultats
suspects. L’éclatement du
parti nous ferait abandonner une partie qui pour n’être
pas gagnée aujourd’hui, n’est pas perdue demain ou
après-demain et surtout nous ferait abandonner les
militants de certains départements aux mains des manipulateurs
de tous poils. Et cela au plus grand profit de la droite. Il
consacrerait en gros la division Nord-Sud que je signalais tout à
l’heure et surtout il nous couperait des moyens matériels et
politiques considérables qui restent ceux du parti. Seules de nouvelles élections, même imparfaites, corrigées de ces manquements les plus criants, pourraient donner à qui serait élu(e) la légitimité pour rénover le parti dans le sens d’une plus grande démocratie ; mais il est clair, selon moi, que ce changement ne peut venir de tous ceux qui, derrière Martine Aubry, ont tout fait pour conserver leur rente de situation et les formes et méthodes de fonctionnement rédhibitoires de « leur » parti, alors que celui-ci appartient non pas à ses dirigeants, ni même à ses militants, mais aux français qui en attendent une alternative politique démocratique et de gauche renouvelée. Le 24/11/08 |
Election fictive au PS et rassemblement
Pierre Moscovici, soutien de B. Delanoë avant le congrès vient de déclarer sur son blog :"Nous n’avions hier le choix qu’entre des inconvénients. L’inversion du résultat n’était pas justifiable. Un nouveau vote aurait encore dégradé le climat, déjà irrespirable, dans lequel nous vivons. La menace judiciaire était, est toujours insupportable, invivable. (...)
Il fallait donc prendre acte du résultat, politique, de la commission de récolement, qui a conventionnellement donné 102 voix d’avance à Martine Aubry. Le vote du 21 novembre restera pour toujours entaché d’un soupçon, mais le conseil national devait prendre ses responsabilités."
Cette affirmation est confirmée de tous les côtés dans le parti.
C’est donc quasi-officiel, les 60 voix supplémentaires accordées à Martine Aubry par le conseil national (parlement du PS) dans lequel les amis de Ségolène Royal ne sont pas majoritaires (30%) sont l’effet d’une décision politique pour sortir au plus vite de l’impasse désastreuse (vis-à-vis des militants et des électeurs) d’élections contestées et dont le caractère occulte est tout à fait contestable en droit (des élections municipales ou législatives aussi contestées et serrées auraient été retoquées par le conseil d’état) : Pas de publication des chiffres par fédérations, pas de décompte détaillé, pas de redressement ou de récolement précis : cette fameuse commission de récolement n’était qu’un leurre ou faux-semblant : il fallait trancher pour éviter le pire,l’explosion du PS, la scission ou les démissions (Rocard) dont certains auraient menacé le parti si Ségolène était déclarée élue. Il fallait à tout prix, au risque de la voir ébruitée, cette comédie de recompte pour interdire à Ségolène Royal de se présenter en position trop favorable à la candidature à la présidentielle, voire pour résister à son intention de convoquer des primaires ouvertes pour en décider en faisant voter les sympathisants.
Mais ce faisant, il est n’est pas étonnant que les amis de Ségolène Royal aient été profondément choqués du procédé et aient menacé de recourir à la justice ordinaire, comme ils en ont le droit dans le cadre d’associations reconnues d’utilité publique recevant de l’argent public et/ou vivant de cotisations de ces membres (ce qui est le cas du PS) . Il n’est pas étonnant, dans ces conditions non plus, que ces amis aient donné l’impression d’hésiter sur la marche à suivre : fallait-il prendre le risque de tuer le parti pour faire respecter leur droit à des élections transparentes et démocratiques ?. Nous savons le résultat de cette hésitation : sous la pression d’élus de terrain (les « barons) qui soutiennent Ségolène Royal, ses amis ont pris le décision de reconnaître le résultat fictif publié par le conseil national du parti à condition d’être associés à sa direction et d’engager des réformes en vue de la démocratisation et de l’ouverture du parti. La candidature de Ségolène est mise au frigo par ses amis tout en étant clairement déclarée par celle-ci (avec leur accord).
Ce compromis est habile : Ségolène peut déclarer , à l’écoute des indiscrétions volontaires de certains membres du conseil national qui ne sont pas de ses amis déclarés, qu’elle a été au plus près d’être élue et même, comme elle le dit avec ironie, un peu plus, et se mettre en position d’exiger une large marge de manœuvre (je serai plus libre dit-elle) pour préparer sa candidature dans et hors du parti en pratiquant la stratégie qui lui convient le plus ; un pied dedans (Direction du PS), un pied dehors (Désir d’Avenir) . Martine Aubry a tout intérêt d’accepter une telle paradoxale alliance afin de diriger le parti dans le sens de la réforme qu’elle a promis et cela contre ses soutiens antérieurs dont les désaccords politiques sont tels qu’ils seront plus nuisibles qu’utiles à son autorité dans le parti. Ses soutiens, nous le savons, sont incapables de constituer une unité politique positive. Leur puissance coalisée ne peut être que de nuisance.
Ainsi la fameuse synthèse impossible avant et pendant le congrès devient maintenant probable à la faveur d’une fiction politique déclarée comme telle et d’un compromis dynamique laissant à Ségolène Royal toute latitude pour se concentrer sur l’essentiel : la réforme du parti et l’élection présidentielle (et les deux sont liées) pour laquelle la question de l’alliance avec le centre se posera nécessairement comme elle s’est posée à Lilles pour Martine Aubry. Celle-ci est tout sauf irrationnelle en politique et sait jouer des rapports des forces comme elle l’a brillamment montré lors du congrès de Reims. Nous en avons un indice clair dans son appel à Ségolène Royal (qu’elle a publiquement embrassée) dès son « élection conventionnelle » à des discussions en vue d’élaborer un texte commun et d’intégrer des amis de Ségolène à la direction du parti (Bureau national) ; ces deux discussions et celles qui vont suivre ont pour objet , non l’élection présidentielle, mais l’élaboration d’une plate-forme commune et, aux dires des deux parties, se sont déroulées dans un climat favorable ; celle de samedi a permis en effet de lister les points de convergence entre la motion présentée pas le ségonéliste Collomb et celle par Martine Aubry, lors du congrès de Reims. Un rapprochement sinon un compromis semble se dessiner sur la question de la réforme du parti en ce qui concerne les adhésions à bas coût en vue de promouvoir un parti qui serait tout à la fois de militants et de masse en vue d’une plus grande ouverture du PS vers les couches les plus défavorisées et sur l’ensemble de la société.
Cette alliance apparemment paradoxale entre les deux concurrentes du congrès de Reims peut échouer ; le pouvoir de nuisance des partenaires/ adversaires de Ségolène peuvent pourrir la situation afin que rien ne bouge dans le parti en vue de donner quelque chance pour la candidature en 2012 à des concurrents de Ségolène Royal et/ou de préserver leur pouvoirs locaux au prix de l’élection présidentielle (autre paradoxe). De fait certains alliés, comme le constate Vincent Peillon, sont en train de faire des difficultés à Martine Aubry en exigeant les uns (Hamon,Emmanuelli) une direction résolument de gauche (entendons par là condamnant toute alliance, avec des centristes, même réputés républicains et démocrates) et d’autres (Cambadélis et strauss-Khaniens ) refusant par principe toute admission de ségolénistes à la direction du parti . Les delanoïstes (H. Désir), quant à eux, attendent pour se prononcer la plate-forme commune. Encore faudrait-il donc que ces soutiens critiques de Martine soient d’accord entre eux -ce qui ne paraît pas du tout évident à l’heure qu’il est- pour peser efficacement sur les pourparlers en cours entre les deux dames et bloquer au conseil national du PS la plate-forme commune et la nouvelle direction associant les amis de Ségolène Royal promis par Martine Aubry. Le pire c’est à dire l’éclatement du parti qu’elles ne veulent ni l’une, ni l’autre n’est donc par certain : l’heure, de part et d’autre, est au rassemblement négocié.
Certains peuvent s’étonner
naïvement de cet apparent revirement, mais il faut comprendre que toute
alliance est un combat et toujours le résultat d’un rapport des forces.
Ces deux dames font de la politique et non pas seulement de la
psychologie. On comprend alors qu’une telle alliance dynamique entre
Martine et Ségolène à la direction du PS vaille bien une élection
manipulée et affirmée comme telle par les deux parties.
Cynique ? Soit mais pas trompeur ; : une fiction avouée comme telle ne
peut être la source d’une illusion : Martine n’ a été élue que par
convention comme le dit Moscovici. Reste au PS de devenir en lui-même
le parti démocratique qu’il prétend être pour démocratiser la France
avec tous ceux qui partagent cette exigence, comme l’ont fait nombre
d’élus socialistes des grandes villes dont Martine Aubry.
Ler 02/12/08
Au PS la démocratie se mord la queue...
Martine Aubry a fait son choix : celui de se mettre pieds et poings liés à l’entière disposition de ceux qui l’ont faite reine par défaut et qui n’attendent qu’une chose : la dégommer et se dégommer entre eux dès que la question des présidentielles se posera, ce qui ne saurait tarder. Espèrent-ils la voir chuter aux européennes, aux régionales, avant, après ?Peu importe, après l’avoir nommée chef d’une troupe incohérente (pour ou contre Lisbonne ; pour au contre le libre marché etc..) par cooptation (maquillée en élections), ils croient avoir atteint leur but : éliminer tout risque de candidature de Ségolène Royal à la présidentielle de 2012 dont il savent d’expérience, ce qui explique leurs basses manœuvres, qu’elle est tout à fait capable, une fois de plus, de convaincre la majorité de militants du PS et qu’il suffit qu’elle intervienne auprès de l’électorat populaire pour que sa cote remonte instantanément. N’ont-ils pas fait largement appel à elle pour les législatives, les régionales, les cantonales, les municipales afin de l’emporter sur la droite ?
Le texte de Martine Aubry est d’une indigence programmatique remarquable et masque mal sous des formules vagues et traditionnelles une volonté (le mot est impropre), une absence volontaire de volonté de renouveler le parti. Ce n’est pas son appel magique ou rituel d’être à gauche par le seul refus de toute alliance avec le MODEM qui peut donner le change (si ce n’est à Benoit Hamon qui se voit promu son porte parole, voire son porte-flingue). Ce refus de principe, en fait, est d’une hypocrisie consommée : n’est-elle pas elle-même alliée au MODEM dans sa ville de Lille et cela n’a-t-il pas été une condition de son succès aux municipales ; mieux, cette alliance n’est-elle pas satisfaisante au regard de la politique de centre-gauche qu’elle conduit ? Le refus de toute alliance avec le MODEM par un de ses soutiens tardif, Bertrand Délanoë, n’a-t-il pas permis, entre autres conditions, l’élection de Tibéri à la mairie du Vème arrondissement de Paris. Ce même Tibéri n’a-t-il pas approuvé la dénonciation à la police par ses services d’une mère d’origine étrangère venant faire inscrire son enfant à l’école ? Ce refus de toute alliance avec le MODEM qui se réclame des libertés fondamentales contre la politique de la droite et de plus en plus offensif contre le capitalisme sauvage, dès lors que ce parti approuve la défense et l’extension des droits sociaux, ne conduit-il pas à faire gagner la droite la plus corrompue, sous prétexte de préserver une image de gauche, par ailleurs compromise aux yeux des dogmatiques pseudo-marxistes du parti par la déclaration du maire de Paris en faveur non seulement du libéralisme politique (ce que tous « officiellement » au PS acceptent), mais aussi économique (à condition que la liberté économique du marché soit régulée), mais ce que ses tout nouveaux alliés du moment, B Hamon et H. Emmannuelli, refusent.
Ce qui choque le plus dans sa manière de régir le parti, au contraire de sa prétention à le démocratiser (et cela commence fort mal en effet !), comme le rappelle avec raison V. Peillon, c’est que Martine Aubry ait refusé de négocier ce texte avec les amis de Ségolène Royal en exigeant d’eux, alors qu’ils représentent au moins la moitié du parti au dernier tour des élections en son sein, qu’ils s’y soumettent sans condition ; Elle a aussi refusé toute discussion sur la répartition des postes en vue d’un rassemblement que ceux-ci réclamaient depuis sa prétendue élections en ayant pourtant accepté un résultat qu’ils savaient et que tout le monde sait truqué ou conventionnel (dixit, Moscovici). Les amis de Ségolène Royal ont tout tenté pour faire que ce rassemblement puisse avoir lieu avant, pendant et après le congrès de Reims jusqu’à avaler la couleuvre d’élections bidonnées ; mais, il est vrai, sans masquer ce dernier point essentiel. Martine Aubry, du reste, consciente (et pour cause) qu’il y a, à ce sujet, un problème démocratique de fond, promet de changer le système électoral en vigueur au sein du PS. Mais peut-on lui faire confiance alors qu’elle s’était empressée de proclamer son élection avant même que tous les résultats aient été comptabilisés et qu’on ne peut accepter certains manquements avérés dans sa propre fédération ? Qu’il y ait eu des manquements ou malversations ailleurs, c’est très probable, mais alors devant un résultat si serré, pour un (e) démocrate, un revote, au moins dans les lieux où ces manquements étaient signalés s’imposait comme l’avait demandé Robert Badinter, que l’on ne peut soupçonner de partialité pro-Ségolène dans la parti.
Martine Aubry n’est donc pas aussi politiquement responsable que je l’avais trop rapidement espéré dans mon dernier article : par sa fin de non-recevoir aux amis de Ségolène Royal, elle met non seulement l’unité du parti en péril en faisant du mépris des militants qui se retrouvent dans l’idée de rénovation profonde une ligne de gouvernement du PS, mais surtout toute stratégie démocratique de gauche, laquelle au gouvernement ne peut être que de centre-gauche, comme l’expérience historique l’a toujours montré depuis le front populaire. Le PS, grâce à Martine Aubry se trouve donc plongé au cœur de cette contradiction bien connue de la vieille SFIO de Guy Mollet : celle d’un discours rituel de gauche devant les militants et d’une politique réaliste de centre-gauche, voire, au regard de ce discours, carrément de droite, au gouvernement....
Mais cette
stratégie à très courte vue, (le Tout contre Ségolène Royal) a un
revers : en interdisant aux amis de Ségolène Royal toute responsabilité
à la direction du parti, elle leur laisse le champ libre pour continuer
à l’intérieur et à l’extérieur à faire valoir leur différence. Et pour
peu, ce qui très probable, que le front apparemment uni contre
l’ancienne et prochaine candidate à la candidature se disloque, Ségolène
Royal a de grandes chances de l’emporter au prochain congrès du parti
en 2011, en vue des élections de 2012...Elle a montré qu’elle sait y
faire, comme on dit, et qu’elle n’est une gourde en politique que pour
ceux qui sont aveuglés par la haine qu’ils lui portent, laquelle, comme
chacun le sait, n’est que le revers d’un amour refoulé et/ou d’une
jalousie impuissante.
le 08/12/08
Benoit XVI est-il chrétien ?
« Je dirais qu’on ne peut pas résoudre le problème du Sida avec des slogans publicitaires. S’il n’y a pas l’âme, si les Africains ne s’aident pas, on ne peut pas résoudre le problème du Sida avec la distribution des préservatifs, au contraire elle aggrave le problème.La solution est double : d’abord, une humanisation de la sexualité, un renouveau spirituel, humain, intérieur, qui permet ainsi de se comporter différemment avec les autres. »
Par
ces propos, le Pape Benoit XVI oppose l’abstinence en dehors du mariage
et la fidélité, comme exclusivité sexuelle, à l’usage du préservatif,
provocation au vice, qu’il condamne absolument au non du dogme chrétien
de la sainteté.
Ce faisant, ce Pape est-il humainement chrétien ?
Personne n’a jamais prétendu que le
préservatif était la solution contre le Sida, mais le seul moyen
disponible, lorsqu’il est bien utilisé, de se et de protéger son ou sa
partenaire contre le risque de l’infection, lorsque l’on fait l’amour,
ce qui est un fait incontestable. En cela la publicité pour promouvoir
l’usage du préservatif n’est en rien publicitaire ou commerciale : elle
est une exigence de santé publique. Opposer l’abstinence à cet usage en
fait une affaire de morale subjective et non pas de prévention médicale
objective.
L’abstinence en dehors du mariage et la fidélité dans le couple, en effet, sont affaires de croyances personnelles et ne peuvent en aucun cas être invoquées pour disqualifier une campagne de santé publique qui concerne tous les hommes, croyants ou non, face à cette maladie. Le pape , ni aucun chef d’aucune religion -et donc d’une morale- particulière, n’ont de titre politique à prétendre régir la morale sexuelle et amoureuse de tous les hommes au risque de provoquer des millions de morts, dès lors que cette morale est pour le moins contraire aux comportements sexuels réels. À vouloir faire les humains des anges, on risque fort de les inciter à des comportements irresponsables, comme le savait Pascal.
Par contre, l’usage du préservatif est, au regard de la réalité des pratiques sexuelles, que le pape peut bien verbalement condamner au nom de sa morale, mais qu’il ne peut réellement interdire, la seule attitude responsable et respectueuse des partenaires. Dans cette affaire le pape a tenu des propos irresponsables aux conséquences virtuellement mortelles pour des millions de croyants moins fidèles, au sens qu’il attribue à ce terme, que ce qu’il exige de leur part, sans aucun garantie qu’ils se soumettent à son exigence.
Mais il y a plus sur le plan des valeurs : Utiliser la crainte du Sida, comme le fait le Pape, comme succédané du péché sexuel et de la peur de l’enfer pour imposer une morale de la peur au nom de la fidélité amoureuse , est une pratique archaïque de pouvoir qui contredit l’authentique fidélité en tant qu’engagement positif, si tant est que celle-ci se réduise à l’exclusivité sexuelle, ce qui est pour le moins discutable. Faire peur, par l’invocation de l’enfer ou de la maladie, pour soumettre le désir érotique à une morale déterminée discutable est liberticide. Or il n’ y a de fidélité et d’amour réels que librement consentis.
De ce point du vue, si la liberté et la responsabilité sont des valeurs chrétiennes comme on le prétend aujourd’hui, la question que je pose, en tant que non-chrétien, est de savoir si le pape, par ses propos est aussi chrétien, au sens moderne de ce terme, que beaucoup le croient. En faisant d’un interdit idéologique dogmatique, à savoir, le refus d’une sexualité, libérée du dogme de l’abstinence, et positivement responsable, le Pape condamne par avance toute compassion vis-à-vis des victimes du Sida, transformés par ses propos en pécheurs victimes par là où ils ont péchés.
Le Sida comme punition divine pour dissuader les hommes du désir érotique, condamnable en dehors du mariage et de l’exclusivité sexuelle est une antienne catholique depuis Paul ; en quel sens ce discours qui oppose le dogme à l’amour est-il encore chrétien ? C’est d’abord aux chrétiens de répondre, mais j’ai le droit, en tant que philosophe, de me féliciter que beaucoup, y compris des prêtres, aient pris clairement position au nom de leur christianisme, pour condamner les propos de leur dirigeant suprême, et, ce faisant, fassent passer la compassion et l’efficacité responsable avant une éthique de conviction irresponsable. Cette évolution est une excellente nouvelle pour nous tous, croyants ou non.
Le 20/03/09
Principe de précaution et technophobie
Le principe de précaution en France s’impose depuis février 2005 comme un principe constitutionnel et il n’est pas de sujet d’inquiétude, des OGM aux antennes des réseaux des téléphones mobiles, qui ne soit l’objet d’une controverse qui ne fasse usage de ce principe pour obtenir soit un moratoire, soit une limite, soit une interdiction de certaines technologies jugées menaçantes pour l’environnement et/ou la santé publique.
Or toute incertitude sur un possible dommage dû à une nouvelle technologie est susceptible de nourrir le refus subjectif de toute technologie nouvelle ou technophobie au prétexte qu’elle ferait courir un risque non encore avéré à l’environnement . Ainsi, en étendant le sens du principe de précaution à l’extrême, toute nouvelle technologique serait par définition inquiétante et donc justifierait qu’on limite, voire que l’on renonce à son usage plus ou moins indéfiniment au regard de risques potentiels, non encore envisagés ou reconnus, qu’elle pourrait faire courir à la population et à nos conditions dites « naturelles » de vie. De fait, le principe de précaution deviendrait un obstacle constitutionnalisé à l’évolution technique ou technologique en général. Il ne serait plus qu’une justification du conservatisme des technologiques et des modes de vie passées, c’est à dire passéistes.
Or que dit ce principe, peut-il permettre de faire de l’inquiétude subjective, non validée objectivement, un motif public suffisant d’interdiction ou de limitation d’une nouvelle technique, voire d’une nouvelle technologie ? Les pouvoirs publics doivent-ils se soumettre à l’expression de cette inquiétude au risque de nourrir la technophobie subjective (ou peur imaginaire de la technique), voire obscurantiste (anti-scientifique), d’une partie de la population ?
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5).
Une première lecture du texte semble permettre d’écarter ce risque de technophobie paralysante et passéiste dès lors qu’il suspend toute décision publique définitive éventuelle, qu’il faut distinguer d’un moratoire temporaire, d’une évaluation scientifique et donc technique des risques objectifs en vue de parer la réalisation d’un dommage avéré. L’inquiétude purement subjective ne peut être qu’un motif temporaire de poursuivre les études sur d’éventuels dommages avérés, mais en aucun cas une raison suffisante pour renoncer à tout progrès scientifique et technologique. Ce qui veut dire que le principe de précaution ne peut être, au terme d’une étude objective de la réalité d’un dommage, qu’un principe de prévention et non pas une réponse positive à une simple inquiétude subjective sans fondement scientifique déterminable. En ce sens le principe de précaution n’est qu’un principe de maîtrise technique et scientifique du risque objectif grave et irréversible donc compromettant la santé publique sans correctif ultérieur possible.
Mais, précisément, l’incertitude dont parle le texte n’est-elle pas le fait même de l’évolution des sciences et des techniques ? Celles-ci peuvent-elles la réduire au point de la faire cesser ?
Si ce n’est pas le cas, seul un temps indéfiniment long pourrait permette d’écarter tout dommage éventuel et donc d’y parer. Cette insuffisance de la maîtrise scientifique dans la prévention des risques de l’évolution technologique serait alors constitutive des sciences et serait suffisante pour justifier la menace et la méfiance subjectives dans la mesure ou celles-ci seraient la conséquence subjective d’un risque potentiel inscrit objectivement dans la pratique scientifique et technique elle-même. Toute nouvelle technologie serait par nature risquée dans la mesure où elle serait incapable de mesurer à long terme les risques réels encourus. Le principe de précaution devrait donc devenir un principe de renoncement à toute évolution technologique, des comportements et des modes de vie qu’elle génère.
Il est fallacieux de citer à ce sujet l’usage de l’amiante dans le mesure où le risque pour la santé publique était scientifiquement connu depuis le fin de du XIXème siècle et que les pouvoirs publics ont refusé pour des raisons économiques et politiques d’en tenir compte. En ce sens le principe de précaution comme principe de prévention (prévenir un risque avéré et reconnu), doit s’imposer à la puissance publique et n’est du reste pas l’objet du texte constitutionnel cité. C’est plutôt l’exemple dit de la vache folle qui pourrait nous servir de modèle. Il n’était, en effet, pas possible de prévoir le mode de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob de la vache à l’homme en l’état des connaissance de l’époque. Aucun soupçon du risque n’était scientifiquement fondé et c’est la réalité du dommage qui a entrainé la recherche et la découverte de son enchainement causal et qui a révolutionné au passage l’idée antérieure trop limitée d’infection. Cet exemple serait-il emblématique et justifierait-il une inquiétude subjective générale à l’égard de l’évolution technologique et la confusion entre risque objectifs et risques subjectifs que le texte constitutionnel prétendait écarter ?
Sauf à prétendre renoncer à tout progrès technique et donc à l’évolution de l’espèce humaine elle-même il nous faut refuser cette prétendue valeur exemplaire générale de l’exemple de la vache folle. Sauf à verser dans un obscurantisme passéiste et mythique, le problème est donc politique avant que d’être technique :il ne s’agit pas de promouvoir le risque zéro, impossible sauf à nier la condition d’existence et de survie avérée de l’espèce humaine, ni le refus de tout dommage potentiel, car c’est aussi par le dommage avéré que nous pouvons progresser dans la connaissance du monde et de nous-même -et ceci est la seule leçon rationnelle à tirer de la maladie dite de la vache folle-, mais il convient de mettre les sciences et les techniques au service des hommes et non d’intérêts économiques privés prédateurs de nos conditions de vie.
La question essentielle est donc de savoir quelles procédures démocratiques, lesquelles doivent inclure l’expertise scientifique indépendante de ces intérêts privés, faut-il mettre en place pour décider du développement contrôlé de telle ou telle technologie innovante.
le 03/06/09
Du (bon) sens de l’abstention en démocratie
La question première qui se pose à la plupart des commentateurs des résultats des élections au parlement européen est celle des motifs du taux élevé, voire massif, d’abstention (60% en France). Je voudrais ici remettre en question une vision unilatéralement négative et trop répandue de ce prétendu échec de la citoyenneté européenne
Il est vain, me semble-t-il, de chercher dans cette abstention massive un sens unique et encore moins une affirmation de défiance, voire d’hostilité, vis-à-vis de l’Europe. L’abstention n’est pas une attitude politique, elle n’est d’abord que le révélateur d’une difficulté à mesurer, surtout chez les 18-35 ans qui se seraient abstenus à 70-80%, l’enjeu d’une scrutin proportionnel qui ne définit aucune victoire nette d’une majorité sur une minorité, sans finalité de pouvoir clairement établie et sans que le nouveau rôle du parlement européen ait été anticipé dans le cadre de la future éventuelle, voire probable, application du traité de Lisbonne, dès lors que celle-ci n’a pas pu encore être politiquement expérimentée.
S’ajoute probablement à ce motif d’abstention l’idée que la victoire du non au référendum en 2005 en France, n’a pas été suivi d’effets positifs sur la poursuite de la construction européenne en l’absence de position cohérente des partisans du refus de l’Europe politique supra-souveraine de gauche ou de droite. L’euroscepticisme ou la critique radicale de l’Europe telle qu’elle fonctionne n’a pas fait la preuve de sa capacité à présenter une alternative politique ; c’est le moins que l’on puisse dire, d’où le succès indiscutable actuel de NS qui, dans sa campagne présidentielle de 2007, avait explicitement sorti le futur traité de Lisbonne (baptisé mini-traité à l’époque) du débat politique franco-français en refusant d’en faire l’objet d’un référendum, dès lors que celui-ci avait montré ses limites sur un enjeu précisément européen. Le non de 2005, sans alternative cohérente (plus ou moins d’Europe, non d’extrême droite et non de gauche) , sans un oui à autre chose de crédible donc, ne voulait rien dire. Ceci peut expliquer en partie que beaucoup d’électeurs se soient dit que cette question d’une union et/ou d’un traité internationaux ainsi que leurs règles de fonctionnement, relèvent d’une diplomatie délicate dont les électeurs ne peuvent maitriser le processus et les enjeux en termes et selon les critères nationaux plus simples du choix entre les partis de droite ou de gauche. Seuls semblent s’être mobilisés, dans ces élections de 2009, les électeurs qui se disent conscients des enjeux européens et des conséquences démocratiques du traité de Lisbonne quant au nouveaux pouvoirs attribués au parlement européen par le futur traité de Lisbonne . Il est donc moins étonnant qu’il ne paraît qu’une majorité d’électeurs se soit abstenue, c’est plutôt le fait que plus de 40%, dans des conditions aussi défavorables, aient voté qui doit faire sens positif. Ainsi ce sont ceux qui ont fait une campagne européenne sur l’Europe (UMP, Verts) qui ont mobilisé et gagné contre ceux qui ont cru confondre les élections nationales et européennes (PS, MODEM, voire paradoxalement le front de Gauche) qui ont indiscutablement gagné ces élections..
En ce sens, les abstentionnistes, par delà cette abstention massive particulière, nous rappellent une vérité de la démocratie réelle : il vaut mieux pour celle-ci que des citoyens qui se sentent mal informés ou ne se sentent pas suffisamment convaincus dans un sens ou dans l’autre à propos d’enjeux dont ils ne pensent pas maîtriser les données complexes pour choisir par eux-même laissent à ceux qui le croient l’être sont le soin de choisir à leur place. De ce point de vue l’abstention peut être une attitude démocratique plus responsable qu’on ne le prétend trop souvent . Elle doit être reconnue pour ce qu’elle est chez nous : le droit démocratique fondamental de ne pas voter lorsque l’on ne sait pas encore (surtout pour les plus jeunes) pour qui et pour quoi voter ou lorsqu’on ne sait pas quels résultats collectifs peuvent découler ou être fait de leur choix individuel.
Penser que tous les citoyens doivent, toujours et sur tous les sujets, être capables de décider par eux-même d’une décision cohérente engageant tous les autres est une illusion dangereuse, dans la mesure où elle risque de conduire à mépriser l’ensemble de nos concitoyens qui ne votent pas ; ce qui, on en conviendra, reviendrait à mépriser la démocratie réelle au nom d’une démocratie idéale réellement impossible, comme l’avait déjà démontré Condorcet au XVIIIème siècle, démonstration complétée et radicalisée pas Arrow au XXème.
Le 09/06/09
L’éclairante sortie de V. Peillon : de la félonie en politique
Tous savent ou devraient savoir que le courant du PS « Espoir à gauche » est issu de la motion E qui soutenait la candidature de Ségolène Royal, lors du lamentable congrès de Reims , lamentable du fait des opposants à celle-ci, qui avait pourtant obtenue la majorité relative auprès des militants du PS.
Tous savent ou devraient savoir que ce courant regroupent dans sa majorité des militants qui se reconnaissent dans l’action et la personne de Ségolène Royal.
Tous savent ou devraient savoir que V. Peillon avait été mandaté par Ségolène Royal pour animer le courant en question afin de réformer en profondeur ce parti dans le sens de l’ouverture vers plus de démocratie participative et au rassemblement de tous les démocrates pour faire échec à Nicolas Sarkozy en 2012
Or qu’a-t-on vu lors de la réunion organisée au nom de ce courant ? Que son animateur auto-proclamé, sans avoir consulté qui-que ce soit, en tout cas aucun adhérent de base de ce courant, avait décidé d’interdire à Ségolène Royal -qu’il soutenait pourtant lors de la formation de ce courant- de participer à une réunion organisée par ce courant, sous le fallacieux prétexte qu’elle serait présidentiable, tout en faisant de Manuel Valls, qui lui, au contraire de Ségolène Royal, s’est déjà déclaré candidat à la candidature, un acteur majeur de cette rencontre. Cette réunion portait sur l’école et l’enseignement, ce qui est en effet une source fondamentale de notre vision de la république, thème sur lequel Ségolène Royal, par ses fonctions passées comme ministre dans ce secteur, est particulièrement compétente . Sa présence était donc particulièrement nécessaire au débat.
Faut-il rappeler que Ségolène Royal est tout à fait chez elle dans ce courant qu’elle a initié et donc qu’elle n’a pas plus que tous les autres militants de ce courant à y être invitée. Chaque adhérent en effet à été invité à s’inviter pour participer à cette réunion. Ce qu’elle a fait en avertissant F.Rebsamen co-organisateur et maire de Dijon, la ville qui avait offert l’hospitalité de sa ville pour sa tenue, de sa présence à cette réunion, lequel lui avait assuré qu’elle y serait bienvenue, ce qui vaut approbation de cette auto-invitation. Faut-il penser que pour V. Peillon, sans consulter les autres dirigeants de ce courant, il aurait tout seul le droit de décider de la présence ou non de tel ou tel adhérent ou militant à une réunion du courant qui est le leur, après avoir reproché, avec quelques autres, à Ségolène Royal de n’être pas venue au rassemblement précédent de Marseille ?
Faut-il rappeler qu’aucune des orientations en vue du rassemblement et de la transformation du parti défendues par les militants de ce courant n’est différente de la position développée par Ségolène Royal lors du congrès de Reims, voire lors de sa campagne aux élections présidentielles. Position qu’elle continue à soutenir à la place et avec le talent qui lui sont reconnus par ses amis dont V. Peillon a été il y a peu, largement majoritaires dans le courant « Espoir à gauche » ? V. Peillon peut-il dire sur quel point sa propre position politique l’opposerait à celle de Ségolène Royal ?
La réponse est non, sa sortie est donc outre son aspect
anti-démocratique, voire autocratique, en opposition avec la notion de
démocratie élargie ou participative qu’il défendait encore il y a peu,
est donc une attaque purement personnelle.
Il faut alors se poser une question : Quels sont les buts personnels aujourd’hui de V. Peillon ?
S’agit-il de récupérer le « ségolénisme » sans Ségolène en disqualifiant celle-ci, selon ses propres termes, pour conforter la candidature d’un autre qui pourrait être celle de Dominique Strauss-Khan , de Manuel Walls, de Martine Aubry, voire de lui-même ; sa promesse en effet de ne pas être lui-même candidat n’engage, au regard de son parcours récent auprès de Ségolène Royal, que ceux qui croient encore en sa parole.
S’agit-il d’envisager de prendre personnellement la tête du parti
socialiste, en service commandé par l’actuelle direction, pour faire
d’une (?) candidature à la présidentielle -qui ne serait pas Ségolène
Royal- la seule candidature possible ? Ce pourquoi il aurait, par un
détour dont la dialectique ne casse pas les briques, sinon celles de la
démocratie (et on vu ce que cela pouvait donner lors du congrès de
Reims), rejoint le camp de ceux qui n’ont comme seul souci politique
que de faire barrage à la candidature de Ségolène Royal aux
présidentielles de 2012.
Comme quoi la philosophie que V. Peillon honore ne garantit pas nécessairement contre la perfidie en politique dont Platon faisait, entre autres, un moyen nécessaire pour qui voulait être à la fois roi et philosophe.
Les militants et adhérents d’ « Espoir à gauche » dont je suis -et au delà, les électeurs de gauche- sauront, n’en doutons pas, apprécier ce comportement particulièrement cynique comme il le mérite, le faire savoir à son auteur, et s’en souvenir...
Vaccin contre la grippe A : comment choisir ?
Soyons, à propos du vaccin contre la grippe A, cartésien et usons de l’ordre rationnel des questions pour faire du doute nécessaire, un moyen permettant de prendre une décision rationnellement fondée.
Les premières questions qu’il faut se
poser, dès lors que chacun doit prendre cette décision librement,
concernent l’efficacité et la dangerosité du vaccin vis-à-vis de
la maladie elle-même.
1° question : La grippe est-elle une maladie que chacun a intérêt à éviter, grâce au vaccin, pour lui-même ?

Deux réponses sont possibles :
Non, car pour la plupart elle ne met pas en péril notre vie, elle n’est qu’une gripette pas plus dangereuse qu’un rhume de cerveau. Dans ces conditions le vaccin peut apparaître comme plus dangereux que la maladie dès lors qu’on en connait mal les effets secondaires. De plus la grippe elle-même est une vaccin plus efficace pour l’avenir que le vaccin qui prétend nous en protéger.
Oui, car la grippe est toujours un risque dont on ne peut mesurer l’importance à l’avance en ce qui nous concerne. Elle est une maladie qui nous affecte toujours plus ou moins douloureusement et nous empêche de vivre selon nos désirs et de remplir nos obligation sociales et familiales que nous avons un intérêt personnel à satisfaire. Ce n’est pas le danger de mort qui est principalement en cause, mais le risque de souffrance ; les morts, eux, ne souffrent pas (plus). Le vaccin est démontré jusqu’à présent efficace pour l’immense majorité des humains qui se sont fait déjà vaccinés ailleurs qu’en France. Ses modalités de fabrication n’ont rien de nouveau et sont de même nature que celles d’autres vaccins démontrés comme efficaces tel que celui de la grippe dite saisonnière. Les fameux adjuvants ont tous déjà été utilisés dans d’autres vaccins et ont été suffisamment testés : ils améliorent leur efficacité tout en élargissant leur cible, tout en limitant la quantité d’antigène viral employée. En aucun cas la vaccin ne peut produire la grippe : le pseudo-virus employé est incapable de se reproduire dans l’organisme, mais il provoque la production d’anticorps efficaces contre la virus réel et, au moins à court terme, contre la plupart des variants de ce virus dès lors que l’antigène qu’il contient concerne la partie la plus stable du virus. . Les effets secondaires du vaccin, comme de tout vaccin sont de deux ordres : allergiques chez une petite minorité de personnes , effet que l’on sait, dans la quasi-totalité des cas, combattre avec succès et ceux de la grippe elle-même tel que le syndrome de Guillain-Barré, mais dans une mesure infiniment moindre. Aucune infection secondaire de la grippe (pneumonie etc), contrairement à elle, ne peut être induite pas le vaccin.
Le vaccin est donc la meilleure prévention qui soit contre la maladie avec moins d’effets secondaires que les dits anti-viraux (ex:Tamiflu) et/ou que les antibiotiques qu’ils faudrait utiliser en cas de complication bactérienne.
2° question : la grippe est-elle une maladie que chacun a intérêt, grâce au vaccin, à éviter pour les autres ?
Deux réponse sont possibles :
Non : car les autres ne nous concernent pas : chacun est seul face à la question de la maladie et de la mort et doit le rester ; c’est à chacun de décider de se faire vacciner ou non ; nous soumettre à des obligations éthiques de ce type vis-à-vis des autres, c’est récuser fondamentalement notre liberté personnelle face à la maladie. Il vaut toujours mieux un société libérale qu’une société prétendument morale qui ne ferait plus de chacun le seul responsable de sa vie. Prendre des précaution pour ne pas infecter les autres oui, se soumettre à une obligation collective de soin ou de prévention, non.
Il va de soi que si on ne croit pas à l’efficacité du vaccin , voire, si on est convaincu qu’il est plus dangereux encore que la grippe (réponse à la première question), non seulement on n’a pas intérêt à se vacciner pour les autres mais on a l’obligation de les convaincre de refuser le vaccin. On a le devoir éthique de dénoncer une quasi-obligation qui peut être criminelle.
Oui :, car nous devons être solidaires des autres, en particulier vis-à-vis des plus fragiles face à la maladie et au risque de la mort qui, si elle n’affecte pas les morts, affecte les vivants qui souffrent et ceux qui les aiment et/ou qui les perdent. Nous ne voulons, ni ne pouvons vivre, en effet, sans eux et encore moins contre eux, sauf à être traités comme indignes de toute confiance, voire indigne de toute responsabilité sociale et parentale, seule condition universelle de toute relation sociale pacifique et d’entraide possible. Se faire vacciner, si on est convaincu que le risque en vaut la chandelle, est donc une obligation éthique de respect minimal que l’on se doit les uns aux autres. L’obligation vaccinale est pour le moins donc une obligation éthique personnelle mais peut aussi être décidée pour des motifs de santé publique par les pouvoirs publics afin d’éviter une épidémie dommageable pour le bon fonctionnement de la cité. Ceci n’est en aucun cas une atteinte aux libertés mais la condition pour que tous puissent les exercer au mieux de leurs intérêts réciproques bien compris en réduisant l’inégalité du risque face à la maladie ainsi que le risque d’inégalité sociale qu’il entraine. Seule la médecine préventive généralisée, vaccinale avant tout, permet de mettre en œuvre une médecine favorable à tous ou, tout au moins, au nombre le plus grand possible d’humains.
3° Question : L’intérêt particulier de profit des groupes pharmaceutiques est-il en cause dans cette campagne en faveur de la vaccination contre la grippe A ?
Une seule réponse est possible oui, mais, à partir de là, deux interprétations sont possibles
La première fait de cet intérêt privé le seul motif réel de la campagne à l’encontre l’intérêt général. Les grandes compagnie pharmaceutiques liées aux gouvernants et à la presse officielle (lobbyisme) ont tout fait pour convaincre, à tort, voire à coups de mensonge, de la dangerosité de la grippe A et de l’efficacité de leur vaccin pour renflouer leur caisse et les dividendes de leurs actionnaires, menacés par la crise financière. Cette grippe tombe stratégiquement à pic pour sauver un secteur économique en crise. Si les banques ont pu faire appel aux états pour les sortir de la faillite, les groupes pharmaceutiques ont suivi l’exemple et ont inventé le mythe de la grippe A pour obliger les états à financer, à leur seul profit, une campagne généralisée de vaccination, inutile, sinon ou voire dangereuse, pour la plupart des citoyens. Il suffit pour s’en convaincre de constater que les experts soi-disant indépendants du secteur public sont les mêmes que les experts-conseils du secteur privé, lequel les rétribue plus largement que l’état pour les services de recherches et commerciaux qu’ils lui rendent, voire parfois, sinon souvent, contre promesse d’embauche ultérieure sonnante et trébuchante en forme de « pantouflage ».
La seconde voit dans l’intérêt privé des groupes pharmaceutique, dès lors que le risque de la pandémie est avéré et que le vaccin est efficace, une nécessaire convergence avec l’intérêt général . « Qu’importe alors la couleur du chat pourvu qu’il attrape la souris » (Teng shiao Ping). L’état ne peut financer seul la recherche et la production du vaccin, il doit donc s’appuyer sur les intérêt et la puissance du secteur privé pour les mettre au service de tous ; il faut pour cela mettre ce vaccin à la disposition gratuite de tous. C’est ce qu’il a fait de par sa mission de service public, il ne pouvait pas du reste faire autrement , sauf à démissionner ou à être démissionné pour n’avoir pas réagi contre un danger pour la santé biologique et économique de la population (l’un ne peut aller sans l’autre), c’est-à-dire de la société toute entière.
On voit donc que le choix entre les deux interprétations quant à la troisième question dépend en dernier recours de la réponse qu’on donne aux deux premières questions. Inverser l’ordre logique (cartésien) des questions c’est donc entretenir la confusion qui ne peut que contribuer à prolonger l’hésitation quant au choix à faire.
C’est à chacun, de faire son choix ; moi-même, je me suis fait vacciné, ainsi que mon épouse, sans effets secondaires pour le moment (après 16 jours) parce que nous avons répondu oui aux deux premières questions et donc en faveur de la convergence dans cette affaire entre l’intérêt privé des groupes pharmaceutiques avec notre intérêt personnel et l’intérêt général (mutuel ou réciproque). Et cela d’autant plus que ces groupes ont besoin dans notre système économique (avant que celui-ci soit remplacé par une autre, lequel et par qui) d’argent pour faire leurs recherches et qu’il vaut mieux en terme d’économie réelle au service de tous que les puissances publiques mettent notre argent à leur service et sous son contrôle que de financer les profits bancaires purement spéculatifs.
J’espère ainsi avoir contribué, par ce questionnaire ordonné, à faire en sorte que chacun sache mieux pourquoi et comment il peut se décider rationnellement dans un sens ou dans l’autre.
Un référendum interdisant les minarets est-il pensable en France ?
La démocratie française, qu’on l’approuve ou non, n’est pas directe et ne l’a jamais été et ne le sera pas, sauf un changement total quasi révolutionnaire de sa constitution.
Démonstration en forme de rappel historique.
Dans la constitution de la Vème République, avant sa réforme récente, toute question de référendum relevait du président de la république après consultation de conseil d’état.
Les projets de loi susceptibles d’être soumis à référendum ne pouvaient porter que sur l’organisation des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord de Communauté ou l’autorisation de ratification d’un traité qui "sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions". La communauté « coloniale » a été abolie en 1961, La révision du 4 août 1995 a remplacé les accords de Communauté par les "réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent". Il appartient soit au gouvernement, soit aux deux assemblées par une proposition conjointe, de demander au Président de la République l’organisation d’un référendum qui, en tout état de cause, ne peut porter que sur un projet de loi préalablement déposé par le Premier ministre et soumis à la délibération des assemblées, le parlement n’en a donc pas l’initiative.
Dès lors qu’il est saisi par le gouvernement ou les deux assemblées d’une demande de référendum, le Président de la République est seul maître de sa décision : il exerce son pouvoir, par décret non contresigné, ce qui souligne que ce pouvoir relève de sa seule compétence. Sa marge de liberté diffère cependant selon le contexte politique. En cas de majorité parlementaire et présidentielle convergente, c’est en fait le président de la république qui propose la question soumise à référendum, dans le cas contraire( cohabitation), il ne peut qu’y opposer son droit de véto.
Depuis 1995, si le président est à l’origine d’une proposition de référendum, il doit faire devant chaque assemblée une déclaration qui sera suivie d’un débat sans vote, mais il reste possible à l’Assemblée Nationale de mettre en cause de voter une motion de censure pour rendre impossible, par le gouvernement censuré, d’organiser le scrutin .
Le décret du Président de la République décidant le référendum est un "acte de gouvernement".
- le projet de loi soumis au référendum est, comme tous les projets de loi, soumis pour avis au Conseil d’Etat.
- Le Conseil Constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Mais il ne se reconnaît pas compétent pour juger de la conformité d’une loi référendaire à la Constitution, dès lors qu’une telle loi constitue l’expression directe de la souveraineté nationale.
- Les décrets organisant le référendum peuvent faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans les conditions habituelles.
Le référendum d’initiative « populaire » a été introduit le 23 Juillet 2008 dans le cadre d’une loi de révision de la constitution prise à l’initiative du président de la république et du gouvernement et votée par le congrès, afin de rapprocher les citoyens de leur représentants,. Il n’est donc pas question de démocratie directe (qu’il ne faut pas confondre avec la démocratie participative) à la mode Suisse. Cette procédure nouvelle doit être suivie d’une loi organique pour en préciser les modalités d’application, loi que l’on attend toujours ; nul doute que le mauvais (voir plus loin en quoi) exemple de la Suisse va faire qu’elle ne sera pas plus ouverte qu’elle ne l’est aujourd’hui ; les partisans de la démocratie indirecte vont s’empresser de tirer argument de ce référendum pour limiter ou encadrer encore davantage le recours à une telle procédure.
Que dit, en effet, le texte voté en l’état ?
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La régularité de l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi et qui ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République soumet la proposition au référendum. »
Soulignons que l’organisation d’un référendum d’initiative populaire prévu dans la réforme constitutionnelle en cours, requiert des conditions très difficiles à réunir. Il faut en effet obtenir le soutien de 20% des membres du Parlement ( presque 200 parlementaires) ainsi que la signature de 10% des électeurs inscrits, soit environ 4,5 millions de Français. Ce qui est considérable
C’est donc au parlement après avis du Conseil Constitutionnel de décider de la question posée en dernier recours. il ne s’ agit donc, dans cette procédure, que d’améliorer et de renforcer le fonctionnement de la démocratie indirecte, c’est à dire la représentativité et le pouvoir des députés et sénateurs et non d’un embryon de démocratie directe. Ce qui est tout à fait conforme à l’esprit du régime français depuis toujours.
Il faut ajouter que l’article premier du préambule de la constitution, même réformée, interdit explicitement toute question qui ferait une distinction entre les minarets et les clochers d’église par exemple selon le principe de l’égalité de traitement entre toutes les religions dans un état laïque et de droit.
Que dit cet article que nombre de commentateurs défenseurs du référendum Suisse cherchent à faire oublier ?
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
L’égalité devant le loi est affirmée dans sa conséquence : l’égal respect de toute les croyances sans distinction de majorité ou de minorité. Ainsi ce n’est pas à un majorité de décider dans quelles conditions architecturales, si ce n’est les mêmes pour tous, telle ou telle religion doit construire ses lieux de culte. Ce principe n’est donc pas soumis au vote majoritaire que revendique certains, car il au fondement de l’égalité des droits qui en démocratie ne se négocie pas, sauf à se transformer en tyrannie majoritaire. Nous savons qu’il peut, en effet, exister des votes majoritaires qui refusent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes (par exemple en Suisse ou en France précisément, dans le passé) et/ou qui réintroduisent l’esclavage, et/ou qui excluent de la nationalité certaines personnes en raison de leur origine et/ou de leur religion , et/ou qui interdisent des partis d’opposition, pourtant respectueux des procédures démocratiques etc.. Chacun sait que ces votes mettent par terre les fondements institutionnels de la démocratie dont ceux-ci sont la condition de possibilité .
La conséquence est de ce déni de droit est qu’une minorité à qui on contesterait les droits de citoyenneté et d’expression accordés aux autres serait justifiée, au nom la démocratie, de combattre cette injustice par tous les moyens ! Rappelons que ce droit et même ce devoir de révolte contre la tyrannie, même majoritaire, a été inscrit à l’origine dans la déclaration des droits de l’homme française, mais a disparu ensuite, non parce que ce devoir et ce droit n’existeraient pas, mais parce que l’objet même de cette déclaration était de rendre la révolte impossible dans un état de droit, c’est à dire d’égalité des droits fondamentaux, dont fait intégralement partie celui de pratiquer la religion de son choix dans un cadre qui ne relève de l’état et des pouvoirs publics que si cette pratique et ce cadre portent atteinte aux droits fondamentaux . Du point de vue de la constitution française et très probablement, nous le verrons bientôt, du droit européen auquel la Suisse a souscrit, la question posée aux suisses est inconstitutionnelle, dès lors qu’elle bafoue, dans son principe même, l’égalité des droits des différentes religions, constitutive de toute démocratie laïque et pluraliste.
Certains partisans du vote suisse n’ hésitent pas à affirmer que la question posée ne portait pas en réalité sur l’interdiction des minarets mais sur celle de l’intégrisme musulman dont les minarets seraient le symbole. Or cet argument est doublement fallacieux :
-
Sur la plan théorique, les mosquées portant des minarets existant en Suisse et en France ne sont en rien des repères intégristes, mais au contraire des symboles d’intégration ( au point que celui de Paris a été construit par la France et que les autres sont toujours négociés entre les communes et les associations musulmanes légales )
-
Sur le plan pratique, faire des minarets des symboles intégristes renforce nécessairement le sentiment d’injustice et de discrimination chez tous les musulmans qui s’en sentiraient victimes au profit des intégristes et de leur stratégie de victimisation..
Il est clair qu’il faut alors combattre, non les mosquées, avec ou sans minaret, mais l’usage anti-républicain que certains imams en font et refuser qu’une mosquée soit construite par des financements étrangers ou internes qui rendraient douteux l’enseignement qui y serait dispensé. Cela implique une surveillance des discours tenus à l’intérieur des mosquées, comme de tout autre bâtiment religieux. Cette surveillance est indispensable à la défense des valeurs de la république et fait intégralement partie de la mission d’un état laïque . L’interdiction d’utiliser la religion pour contester la république, ses valeurs et l’égalité de ses droits, est seule susceptible de faire échec à l’islamisme et à tout autre fondamentalisme religieux.
C’est la seule leçon -et en cela son exemple peut et doit nous servir- à tirer de ce référendum suisse fondamentalement anti-démocratique dans son principe même.
Du paradoxe de l’attitude climato-sceptique
Certains que l’on dénomme climato-sceptiques et qui se réclament du droit de douter comme une condition pour produire la vérité scientifique toujours relative, prétendent tirer du doute la certitude qu’il convient de ne rien faire pour limiter la production de CO2 dans l’atmosphère et refuse radicalement la programme du sommet de Copenhague, au nom de leur doute. Ce qui est un paradoxe logique et pratique pour le moins étonnant.
Démonstration :
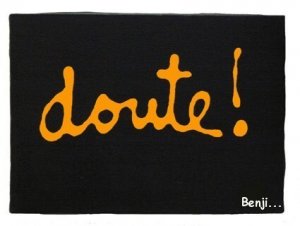
- Admettons avec eux qu’il y ait des doutes sur l’origine humaine du réchauffement climatique.
- Admettons que ces doutes puissent être plus tard justifiés ; ce que nous ne pouvons encore savoir avec certitude aujourd’hui.
Cela ne veut pas dire qu’il n’ y ait pas des indications tellement sérieuses du fait mesuré du réchauffement climatique que même les quasi totalité des sceptiques est obligée de l’admettre. Toute la question est donc de savoir si la production humaine de CO2 doit être totalement écartée comme condition parmi d’autres, de ce fait.
Or même Claude Allègre est contraint de répondre par la négative à cette question, au nom du doute scientifique et au regard de la controverse entre spécialistes en cours.
Dans ces conditio-ns rien ne peut et ne doit pratiquement nous empêcher, au nom du principe de précaution, de prendre au sérieux une thèse encore douteuse, comme toute thèse scientifique, mais relativement consensuelle parmi les experts dont la plupart d’entre nous ne sommes pas, afin de préserver nos conditions de vie actuelles et réduire les risques signalée par la majorité des experts, en limitant la production humaine de CO2 dans l’atmosphère.
Le doute, en effet, doit générer la prudence, à savoir la limite dans l’affirmation de la toute puissance du désir, toujours aveugle, et doit obliger à refuser l’imprudence de l’excès, car tout l’excès est potentiellement catastrophique. La limitation du développement aveugle au profit du développement durable et conscient des risques possibles sinon certains, ne peut être nuisible, car elle sera nécessairement bénéfique aux humains et aux espèces non-humaines dont nous avons besoin pour bien vivre. Le "rien de trop" est toujours une bonne chose, ce que savaient déjà les anciens qui en avaient fait une règle fondamentale de sagesse.
Que ceux donc qui prétendent douter, fasse aussi du doute un règle de sagesse. Les adversaires de Copenhague devraient faire un meilleur usage de leur doute en ne le convertissant en contre-certitude, toute aussi fallacieuse, sinon plus, que celle qu’il refuse.
Les soi-disant sceptiques, au nom de leur scepticisme, devraient savoir que, sur le plan pratique et non seulement théorique, ils pourraient être démentis plus tard, ce qui est un argument suffisant à ne pas prendre le risque de l’être, car il serait alors trop tard !
Face à la réforme sarkozienne des retraites, la solidarité des générations s’impose
Certains journalistes d’opinion et hommes politiques de l’actuelle majorité semblent s’étonner que les jeunes « pourraient » et puissent déjà rejoindre le mouvement de protestation contre la réforme des retraites imposée par le gouvernement.
Ils prétendent que les séniors actuels et prochains, seuls, auraient intérêt à préserver les âges légaux actuels du départ à la retraite( 60 et 65ans), les plus jeunes, non encore stabilisés sur le marché de l’emploi, seraient selon eux les premières victimes de ce maintien : ils devront payer plus en tant qu’actifs moins nombreux pour entretenir les retraités inactifs de plus en plus nombreux. L’un d’entre-eux, Éric le Boucher, va même jusqu’à penser que les plus jeunes devraient contre-manifester contre les les opposants, à la réforme des plus âgés . Cet étonnement de leur part mérite que l’on s’étonne à notre tour de leur étonnement feint ou réel.
C’est en effet mal connaître ou ne pas vouloir connaître la situation des jeunes aujourd’hui que de ne pas comprendre que la précarité est le seul avenir qu’il est réaliste pour eux d’envisager et que de ce fait ils ne peuvent compter ni sur une retraite par répartition suffisante ni, encore moins, sur une retraite par capitalisation. Le seul espoir qu’il leur reste, en vue de leur retraite, est donc une réforme qui , d’une part, prenne en compte ces aléas des parcours professionnel auxquels ils seront soumis et qui d’autre part élargisse le financement des retraites à l’ensemble des revenus du travail, du capital , voire, des actuels retraités eux-même. Sans être hostiles à un allongement de la durée des cotisations, ils souhaitent que, à bon droit, cet allongement soit fonction de la pénibilité, car ils savent que leurs parents et grand-parents engagés dans des professions usantes et épuisantes, physiquement et intellectuellement, voire moralement, sont hors d’état de travailler dans ces métiers après 60 ou 65 ans. Ils savent aussi que les entreprises sont le plus souvent empressées de se débarrasser des employés qu’elles jugent, parfois,à juste titre, moins performants et moins rentables à partir d’un certain âge : 55 voire 5O ans) .Ils sont donc conscients que l’augmentation de l’âge légal de la retraite ne fera que faire supporter les coûts de cet allongement au régime de la sécurité sociale et/ou du chômage qu’ils devront aussi financer, alors que le chômage est aussi le danger permanent qui les menace...Derrière ’apparente contradiction d’intérêt entre moins et plus âgés se cache, dans l’expérience familiale des premiers, une solidarité plus profonde entre les générations : celle qui se noue face au chômage de masse et à la précarité que rien ne peut, dans l’évolution de leur situation, pouvoir réduire ou compenser.
Plus profondément encore, cette solidarité des plus jeunes avec les plus âgés leur est indispensable . Leur situation précaire exige que les plus âgés déjà à la retraite, leurs parents et grands parents, contribuent à leur entretien, voire à leur investissement (ex : accès à un logement indépendant) en tout cas les soutiennent et c’est ce que ceux-ci font très largement : comment les plus jeunes pourraient-ils (contre) manifester en faveur d’une réforme qui rendrait ce soutien plus difficile ou plus lointain ? La famille, dans un contexte très défavorable, à moyen , voire à long terme, est alors le seul lieu où une solidarité concrète et immédiate peut efficacement se manifester. Nous ne sommes plus en mai 68 : les perspectives des jeunes ne sont plus liées à l’euphorie d’un monde nouveau qui leur était promis, en terme de progrès des libertés personnelles contre des traditions familiales répressives, dès lors qu’ils ont aujourd’hui et d’abord dans leur famille, même et surtout sur le plan sexuel et amoureux, la quasi totalité des libertés qu’ils réclamaient à l’époque et que leur parents, après 68, leur ont généralement reconnues . Le combat d’aujourd’hui n’est plus le même : il est devenu celui que toutes les générations parmi les salariés doivent livrer contre un système qui tend à les priver tous, au même titre, de sécurité sociale, laquelle est la condition d’une égale liberté authentique dans la cité, ainsi que des moyens réels de l’exercer.
Cette analyse, que chacun peut faire dans son entourage immédiat, nous oblige à voir dans une idéologie qui prétendrait opposer les jeunes et les plus âgés face à la réforme sarkosienne de la retraite, au mieux, une vision dépassée du conflit des générations, au pire un mensonge pervers pour diviser et affaiblir l’opposition contre ce qui apparaît, à juste titre, aux yeux des plus et moins jeunes, comme un recul social majeur, entérinant , sans même résoudre le problème du financement, le chômage et la précarité comme seule perspective de la jeunesse.
Les jeunes manifestent moins pour leur future retraire à laquelle ils ne ne pensent et ne croient guère que pour celle de leurs parents car ils savent dès maintenant qu’ils auront besoin d’eux en cas de coup dur.
Si l’on ne comprend pas cette réaction des jeunes, comme tout à fait rationnelle dans leur situation réelle, c’est que l’on ne comprend pas ce que génère nécessairement la précarité : l’attitude qui consiste à privilégier le présent et le futur immédiat face à un futur lointain dépourvu d’un avenir dans lequel leur serait assuré la sécurité et le progrès qu’ils estiment mériter grâce à leur travail ; il font donc plus confiance en leurs parents encore préservés de la précarité par le système de retraite par répartition.
Ils ont raison dès lors leur situation ne leur laisse pas d’autre alternative : chaque jour ils font l’expérience que le capitalisme mondialisé dérégulé et les gouvernements à sa solde et à celle des plus riches sont dépourvus du sens de la justice !
"Le capitalisme mondialisé est une réalité à prendre en considération, un fait que personne ne peut nier, que cela plaise ou pas. Par conséquent la France ne peut à elle seule décider que cette mondialisation n’existe pas et s’asseoir dessus."
1) je parle de capitalisme financier dérégulé, lequel domine largement l’économie réelle ; cela signifie que l’urgence ne soit pas à le réguler dans l’intérêt même d’un capitalisme civilisé et "socialisé". Ce qui veut dire un capitalisme qui ne sacrifie pas le court-terme au long terme, la société et les individus au profit immédiat.
2) Dans un tel capitalisme du très court terme et qui met tous les salariés et les jeunes en état d’insécurité totale (chômage, précarité) , le long terme ne peut être ni une perspective crédible ou raisonnable, ni une stratégie viable, pour les plus et les moins jeunes ; c’est pourquoi les plus jeunes se battent aussi pour le maintien des solidarité familiales et donc pour la sécurité sociale et les retraites qui en font partie de leurs parents (y compris dans les familles recomposées), seule encore crédible dans une société dans laquelle les inégalités et donc les injustices et le mépris des moins favorisés s"affirment cyniquement.
3) je constate que vous ne connaissez pas les propositions de Thomas Piketty pour réformer les régimes de retraites, ni même celle du PS. http://www.alternatives-economiques.fr/thomas-piketty----pour-un-droit-a-la-retraite-plus-lisible-et-plus-equitable-_fr_art_846_49165.html
Réponse à R. Debray: Contre-éloge des frontières
Dans
son petit traité: "Eloge des frontières" (éditions NRF, Gallimard)
Régis Debray s'évertue à montrer que, du domaine de la biologie à celui
de la politique, l'existence de frontières pérennes, est la condition de
possibilité de la survie d'un organisme biologique ou socio-politique.
Ce faisant il n'hésite pas à revaloriser ce qui fait aujourd'hui
question: Les frontières politique intangibles et étanches. Mais, on
peut et on doit se demander, à la lumière de l'expérience européenne
dont notre auteur ne parle que par quelques allusions négatives, si
avec leur cortège de contrôle et de filtrage des étrangers, voire le
protectionnisme économique et social qu'elles génèrent elles sont à
défendre, c'est à dire dans le cas de l'Europe, à réhabiliter ,
voire à reconstituer, ou si l'on doit dans le contexte d'une
mondialisation des problèmes, les redéfinir, dans la mesure où on les
estime indispensable à la constitution d'un solidarité politique
faisant peuple face aux autres populations, voire les abolir si l'on
estime qu'elles sont un obstacle majeur à une régulation politique des
rapports entre états et des sociétés en interne? Des frontières
nationales revitalisées ou le chaos politique et social, tel semble
être le choix auquel nous condamne l'auteur. Un tel choix qui va à
contre-courant de toute notre histoire européenne depuis la libération
mérite-t-il que l'on abandonne le projet d'intégration européenne et
donc que l'on récuse radicalement cette histoire, comme on pourrait le
penser à la lecture de ce trop court et surtout trop vague texte quant
au conséquences qu'il faudrait en tirer pour notre avenir en tant que
citoyens français et européens?
Au risque d'oublier l'histoire
des frontières politiques et territoriales et leur relativité, Régis
Debray n'hésite pas à les identifier à des limites naturelles, voire
naturalistes, de même nature, plus ou moins définitive ou intangible,
en tout cas, que la membrane cellulaire et la peau du corps, en tant
qu'elles seraient constitutives d'un ordre pacifique stable entre les
peuples : chacun de ceux-ci serait, selon notre auteur, grâce à des
frontières, reconnues et garanties, fier de lui-même, auto-identifié
collectivement, valorisé à ses propre yeux et donc sans rancune ou
haine vis-à-vis des autres. Il pourrait alors entretenir des relations
d'échange respectueuses sinon amicales avec les autres populations et
pays étrangers. Les frontières politiques et territoriales seraient la
condition première de la paix entre les états-nations et/ou peuples et
la condition nécessaire, voire suffisante (mais R.Debray ne distingue
pas entre les deux termes) des échanges pacifiques et mutuellement
fructueux entre eux.
Mais la question de savoir comment et par
qui ces frontières peuvent être garanties n'est curieusement jamais
posées par l'auteur, alors qu'il s'agit de la seule question à se poser
pour ne pas faire de ces frontières un enjeu permanent de guerre, comme
l'histoire de l'Europe et de la France nous le montre et comme le
savait déjà Hobbes, lequel affirmait, qu'en absence d'un état
mondial, la guerre entre les états était nécessairement l'état naturel
des relations internationales. Kant dans son traité de paix perpétuelle
avait répondu à cette question en proposant la construction d'une
société des nations et d'un droit international. Nous savons en effet
par l'histoire, que les sociétés humaines sont d'abord des sociétés
nées de la guerre entre les tribus, les nations et les états. Ainsi la
question des frontières politiques, de leur évolution et consistance,
ne peut être réduite, aujourd’hui encore moins qu’hier, à celle qui
s’affirme à tel ou tel moment de la configuration des états-nation
mythiquement conçue comme définitive et constitutive de peuples unifiés
dans la poursuite, pourtant le plus souvent si peu pacifique, de
leurs intérêt propres. Or, aujourd'hui, nous sommes , sauf à préparer
la catastrophe générale, contraints à abandonner ce genre de mythologie
politique de la nation absolument souveraine, à l’heure où, de
l’économie à l’écologie en passant par la sécurité, tous les
états sont confrontés à la nécessité de s’organiser à l’échelon mondial
s’ils veulent assurer leur pérennité, au moins temporairement, ce qui
implique nécessairement la mise en place de structures super-étatiques
communes et d'un droit international contraignants, des délégations de
souveraineté à des instances supra-étatiques, voire des regroupement où
des fusions entre états, de fait sinon de droit, qui impliquent une
porosité grandissante des frontières existantes.
Cette
évolution à laquelle nous assistons en Europe, comme, aujourd’hui,
l’espace Schengen nous en donne l’exemple, peut aboutir à terme à la
suppression totale ou partielle des frontières territoriales
nationales, en tant que frontières politiques et/ou à l'abolition
progressive de leur étanchéité, étanchéité qui suppose leur
surveillance militarisée par une armée et une police des frontières ou
douane armées, contre d'éventuels ennemis, extérieurs parce
qu'étrangers. Il est significatif que R.Debray ne se donne même pas le
peine d'examiner la situation de l'UE sauf pour dire que celle-ci ne
s'est pas donnée de frontières géographiques a priori et donc qu'elle
serait, de ce fait et à lire entre les lignes, par avance condamnée à
on ne sait quel destin tragique, comme si les différents états qui la
composent n'étaient pas, déjà, reconnus par l'EU dans leurs
frontières géographiques en tant que condition de leur adhésion
aux traités européens et comme si les états qui demandent à s'y joindre
en étaient dépourvus. Il oublie seulement que ce sont les valeurs
et les frontières symboliques et politiques des principes du droit
européen et la volonté des états et des populations de s' intégrer à
l'UE qui constituent une authentique limite politique à
l'extension de cette dernière et non pas une quelconque frontière
naturelle qui n'est jamais telle que par l'effet d'une construction
politique difficile et toujours en chantier. La seule différence avec
les temps antérieurs c'est que cette construction en extension de
l'Europe et son unification juridique et économique, voire
progressivement et difficilement politique, se fait pour la
première fois non par la force mais par la volonté des états grands et
petits plus ou moins égaux en droit.
Qu'il existe des inégalités
sociales et économiques dans l'UE, sources de conflits entre les
partenaires de l'UE, est incontestable. Mais ces inégalités ne sont pas
par nature contradictoires avec une intégration européenne renforcée
dans la mesure où seule une politique européenne plus favorable à la
réduction des ces inégalités est indispensable pour les combattre, dans
un cadre démocratique européen qu'il faut renforcer. Les conflits
intra-européen et/ou intra-étatiques générés, entre autres
motifs, par ces inégalités, y compris en Belgique ou en Espagne,
ne sont pas seulement produits par le disparition ou
d'affaiblissement des frontières territoriales nationales
traditionnelles, mais relèvent plutôt dans la cadre d'un marché unique
non-protectionniste et d'une monnaie unique, d'une absence de politique
commune sociale et fiscale . Ces conflits ne peuvent être
traitées que par un débat européen et des décisions politiques
communes, donc dans le cadre d'une intégration politique européenne
renforcée. Or c'est le maintien de la politique territoriale en matière
sociale et fiscale qui est responsable de la difficulté de faire
avancer cette réduction des inégalités à l'échelon de l'UE
Il
est vrai qu'il existe en Europe, d’autres frontières que sociales , des
frontières culturelles et politiques (ex: droit, langues, religieuses
etc..) mais la pérennité des différences qui les constituent est
elle-même rendue fluide et mouvante par l’effet de la mise en
cause ou de la disparition des frontières économiques, par
les politiques économiques et financières européennes communes
(ex: marché commun et l'Euro) et par la définition d'un droit européen
qui s'impose à tous les pays membres et qui s'intègre à leur
constitution respective. Or ces différences, bien que
relativisées par la construction de l'UE, peuvent, comme le dit
l'auteur, provoquer des réactions plus ou moins violentes du fait du
maintien des inégalités économiques et sociales entre les différents
pays et au sein de chacun. L'UE est très souvent rendue responsable de
ce qui vient mettre un terme, ou mettre en cause, les
spécificités nationales. Mais on oublie -et les différents
gouvernements européens s'emploient hypocritement à faire oublier cette
responsabilité qui leur incombe- que la totalité du droit européen est
de la responsabilité du conseil des ministres et donc des états
membres.
Or c'est précisément le devoir de chaque pays
européen et de l'UE, dans un cadre confédéral européen et dans le
respect de ces différences culturelles, de réduire les conflits
nationalistes que tendent à reproduire et à cristalliser les frontières
nationales traditionnelles, en luttant à l'échelon de l'UE, contre ces
inégalités sociales qui les exacerbent, devoir que ces mêmes
gouvernements on du mal à remplir dès lors qu'ils préfèrent souvent
jouer de la fibre nationaliste contre l'UE pour séduire leur
population. et échapper ainsi à leur responsabilité politique au sein
de l'Europe. Cette réduction des inégalités, en effet, dont ils
prétendent à tort que l'Europe et non eux-mêmes la refuse, exige une
décision de leur part favorable à une fiscalité redistributrice et un
budget communs, dès lors que cette réduction ne peut plus être purement
nationale, compte tenu de l'interdépendance économique des pays
européens dans le cadre des rapports de production et des échanges
matériels et intellectuels intégrés. Mais il est aussi du devoir de
chaque état de l'UE de favoriser les échanges culturels et sportifs
entre européens, en particulier des jeunes scolaires et étudiants et de
lutter, dans le cadre éducatif dont ils ont la responsabilité,
contre le nationalisme xénophobe spontané que provoque l'identification
valorisée et valorisante à son milieu national et culturel. La
fraternité ou la solidarité avec les autres en tant qu'ils sont
différents de soi n'est jamais spontanée. Un simple accent, sans même
parler d'un dialecte, dans l'usage d'une même langue, ou une
différence de niveau de langue sont spontanément perçus négativement
par les enfants qui ont tôt fait de s'en moquer pour se sentir
collectivement gratifiés par ceux à qui on appartient, contre les
autres constitués en adversaires, sinon haïs du moins méprisables ou
peu digne de respect. Cela vaut pour toutes les différences et les plus
petites ne sont pas pour autant les moindres, au contraire: l'identité
passe toujours par la plus petite distinction, car la grosse différence
menace moins directement que la petite, en tant qu'elle est plus
éloignée de soi ,et rend les identités moins comparables. Il faut
admettre que pour des motifs de politique interne des états, les
efforts de l'UE pour lutter contre cette hostilité premières vis-à-vis
des différences entre les populations, ne sont pas suffisamment relayés
par les gouvernements dits nationaux dans le cadre du fonctionnement et
du rapprochement de leur système éducatif. Ainsi cet exemple de
la construction européenne, bien qu'ambivalent dans ses effets, peut et
doit nous apparaître comme un exemple, en forme de leçon, de ce qu'il
faut faire et ne pas faire chez soi, pour le monde et la solidarité
humaniste transculturelle, dès lors que la globalisation de la
production et des échanges économique concerne irréversiblement , en
bien comme en mal, toutes les populations de la planète. On ne peut
dire: "chacun chez soi, bien protégé dans des frontières identitaires
étanches, et les vaches seront bien gardées" sans prendre et
faire prendre le risque d' un affrontement généralisé de fait même de
cette globalisation des échanges inégaux, alors perçue sous la forme
d'une menace permanente de domination provenant d'un monde globalement
étranger et partant hostile. De même, la lutte contre les risques
écologiques majeurs ne peut être entreprise à l'échelle limitée des
états nations, sans faire que ce risque apparaisse comme le fait des
autres, qui prétendraient nous imposer des restrictions, voire des
sacrifices qu'ils ne se reconnaissent pas. Cette lutte est
par nature mondiale ou n'est qu'un masque hypocrite pour soumettre
davantage encore les pays pauvres aux pays riches. Elle exige
donc un traitement mondial, difficile mais incontournable, si elle veut
être efficace et, dans ce but, paraître et être plus juste.
Le
fait que les frontières étanches et "protectionnistes" aient pu être
ressenties précisément comme des protections contre l'hostilité des
étrangers, au risque, faut-il le rappeler, de la guerre perpétuelle
et/ou de sa préparation pour les maintenir, voire pour les élargir par
le conquête et la domination des états forts sur états faibles, ne peut
plus aujourd’hui, dans un monde non pas unique ou homogène, mais, comme
disait Kant, cosmopolitique, être nécessairement un facteur de paix
séparée dorénavant impossible, mais un facteur de conflits
nationalistes d’une violence qui , du fait des armes de destruction
massive modernes et de la menace écologique , est porteuse de la
destruction de l’humanité, voire du vivant en général. Si, comme le
pense R.Debray, les frontières seraient susceptibles par leur
fermeture même de susciter le désir de s'ouvrir aux autres, par la
reconnaissance respectueuses de leurs différences, encore faudrait-il
que ces autres ne soient pas considérés comme des ennemis potentiels
parce que différents et concurrents. Or une telle ouverture d'esprit
présuppose la libre circulation et la connaissance, ne serait-ce que de
la langue, des autres. De plus pour échanger et se nourrir soi-même de
ces différences il faut aimer et rechercher la provocation pour
soi-même, en tant que bonne pour soi-même, que génère cette remise en
question de soi par la découverte des autres, en tant qu'"étranges
étrangers". Il est douteux que la valorisation des frontières
existantes soit la meilleur moyen, sinon pour un intellectuel stimulé
positivement par la confrontation culturelle, d'échanger avec
l'étrangeté des étranger, car la réaction spontanée pour ceux qui ne
sont pas des intellectuels, à savoir la grande majorité, serait plutôt,
par la valorisation de soi-même que suscite la frontière, comme
marqueur d'identification collective positive, à déprécier, voire à
mépriser les autres pour préserver, dans une situation dominée en
interne, un semblant d'estime de soi. La rencontre positive suppose la
capacité et l'effort de traduire les comportements "étranges" des
autres dans sa propre culture, afin de reconnaître la valeur
universelle portée par ces comportement par delà les tropisme et
le codage de nos habitudes mentales traditionnelles spontanées.
C'est ce mépris, voire cette haine spontanée de l'étranger en vue
d'une guerre éventuelle contre l'ennemi extérieur, voire contre ceux
qui sont désignés comme ses complices à l'intérieur , de l'autre en
tant que différent de soi et pas là dangereux pour soi-même, que les
gouvernements ont toujours exploités pour provoquer une union sacrée
vindicative afin de réduire les effets de la division sociale à
l'intérieur et de renforcer a domination sur les populations qu'ils
dirigent ou oppriment.
Le nationalisme mythologique
politique et/ou ethnique exclusif, en un monde globalisé où toutes les
populations vivent en une interdépendance de plus en plus
étroite, voire en des espaces juridique uniques plus ou
moins fédéralistes et multi-nationaux eux-mêmes en évolution, est
incompatible avec l’objectif de la paix dans le monde, si tant qu’il
ait pu le paraitre illusoirement dans le passé. De ce fait une
réhabilitation passéiste, voire réactif ou réactionnaire des
frontières, sauf à changer le sens de ce terme (entendu comme limite à
l’exercice de la souveraineté politique des états et l'exercice de
cette souveraineté, sans limite ni partage, sur leurs populations) peut
devenir, selon mon analyse et au corps défendant de l'auteur, une
incitation, voire une invitation, à la dérive nationaliste
anti-étrangers. Les frontières ne sont donc pas en elles-mêmes des
conditions positives d'échange, mais c'est l'usage plus ou moins
auto-critique et réflexif que l'on est capable d'en faire, ce qui
implique être éduqué en un sens non-nationaliste, consistant à faire
des frontières des incitations à les franchir, voire à les assouplir,
sinon à les refuser. En ce sens les ponts représentés sur les billets
de l'Euro sont les vrais symboles d'une UE qui cherche à se renforcer
politiquement et économiquement dans l'esprit des citoyens européens.
Il est significatif que R.Debray, en oubliant leur verso ainsi que
celui des pièces, préfère s'en moquer, plutôt que de s'en prendre à ce
qu'incarnaient, dans le passé des relations franco-allemandes, les
lignes Siegfried et (im)Maginot.
Ni les flux financiers, ni les
déséquilibres dans les échanges économiques et commerciaux dans
leurs effets sociaux, , ni les flux humains et les phénomènes
d'immigration massive, dus aux inégalités croissantes entre riches et
pauvres, ni l'effet de Serre , ni les nuages de Tchernobyl, ni
les flux d'informations qu'impulse Internet, ne sont contrôlables ou
filtrables ou régulables dans le cadre de frontières étatiques et
géographiques. De ces faits incontournables, de ces menaces globales
(que R.Debray ne cite même pas dans son texte!), il faut alors tirer la
seule conséquence logique possible: aucun des plus importants problèmes
d'aujourd'hui et de demain, lesquels engagent et déterminent tous
les autres (nationaux ou non) , aucun avenir humain possible ne
relèvent plus de la vision nationale, et géographiquement bornée de la
politique. Les états se doivent de préparer l'après état-nation
souverain et ils le font déjà, avec les difficultés que l'on
sait, dans tous les domaines, y compris sur la question de la sécurité
nucléaire, militaire et civile. Toute position de philosophie politique
qui prétendrait, aux yeux des citoyens, revaloriser ou réhabiliter
l'idée de frontière comme étant la protection ultime contre la guerre
et la menace écologique ne peut conduire qu'à des aveuglements et des
impasses catastrophiques, voire à l'extinction de l'humanité, que
générera nécessairement, dans les conditions d'aujourd'hui que sont les
armes de destruction massive et des dangers écologiques mortels,
les égoïsmes nationaux, toujours facteurs de nationalisme violent. Le
fait, souligné par l'auteur, de la multiplication actuelle des
frontières et des états, ne suffit pas à comprendre et/ou à
justifier cette multiplicité. Encore faut-il en dégager les
significations plus ou moins contradictoires. Deux sont, à mon sens,
importantes: L'une procède de l'affaiblissement des états-nations face
à la mondialisation, affaiblissement qui provoque la montée des
particularismes locaux, voire ethniques, contre toutes les formes de
centralisation étatiques, dites républicaines, du pouvoir politique,
l'autre est une tentation de revendiquer, de la part de populations se
sentant, à tort ou à raison, dominées dans la cadre des états nations
actuels, la participation directe au concert mondial des "nations", à
l'ONU et ailleurs. Ces deux tendances sont donc parties prenantes du
processus de la globalisation mondiale des questions politiques.
C'est
pourquoi, en un monde globalisé, la politique internationale
doit, pour éviter la guerre mondiale d'extermination ou sa forme de
moindre intensité qu'est le terrorisme, ainsi que le désastre
écologique annoncé, prendre le pas sur la politique nationale, sauf à
rendre toute politique pacifique préservatrice de la vie des
populations, voire de la vie en général, impossible. Il faudra donc
vivre avec le fait que, dans la multiplicité des frontières politiques
et culturelles actuelles, chaque individu ne pourra plus être sommé
d’appartenir à tel ou tel ensemble national ou politique unique dans le
cadre d’une solidarité exclusive particulière, mais il faut se dire,
dès maintenant, afin d’éduquer les futurs citoyens en conséquence,
qu’il reviendra à chacun de se dire citoyen du monde engagé dans telle
ou telle configuration politique temporaire, libre à lui de la
transformer démocratiquement , voire d’en changer, s’il le désire. Et
cela, sans considérations de richesse ou de situation sociale. La
liberté de circuler et de s’installer ne se partage pas entre riches et
pauvres sauf à en faire un droit des riches contre les pauvres. Cette
libre circulation et installation est déjà le cas, difficilement, on le
voit à propos du problèmes des Roms, dans l’UE et cela le sera ailleurs
progressivement. On ne peut nier, plus généralement, quant
à la question, fondatrice en démocratie, des droits de l'homme,
que le droit dans et de l'UE soit un progrès par rapport au droit
national en France. Il suffit pour s'en convaincre de penser à la
condition des prisonniers chez nous, voire du fonctionnement de notre
système judiciaire, pour s'en convaincre: la mise en demeure que fait
l'UE à notre gouvernement pour qu'il mette le droit national en
conformité avec les principes humanistes dont se réclame notre
république en est une preuve suffisamment éloquente.
Faudrait-il
pour autant abolir ou effacer dès maintenant toutes les frontières
juridiques territoriales, comme certains universalistes ou
"droitsdelhommistes" pourraient être conduits à l'espérer, au nom d'une
citoyenneté pacifiée parce que mondiale et sans rivages ni visage?
Certainement
pas, il faut garder comme facteur de paix les frontières juridiques
existantes, en tant qu'elles sont internationalement reconnues (et ce
point de politique internationale est décisif: c'est au droit
international de décider des frontières nationales et/ou de les
valider), et faire des frontières politiques des lieux de
passage plus ou moins ouverts (bonnes frontières) , voire de les abolir
plus ou moins, selon des décisions communes négociées et négociables
sur un plan inter-étatique ou mieux, onusien, afin d'en
faire des instruments permanents de dialogue et de possibilités
d'échange et de circulation à la disposition de tout un chacun, pour
qu'il puisse en faire (et cela est aussi affaire d'éducation) des
sources d'enrichissement personnel et collectif, seul apte à faire
progresser un universalisme pacifique dans le diversité de ses formes
d'expression culturelles et linguistiques.
Être citoyen du monde
en ce sens consiste à prendre conscience que tous les problèmes locaux
procèdent des problèmes globaux et que chacun appartient à l'humanité
avant que d'être un citoyen de tel ou tel état géographiquement
(dé)limité.
Il convient alors de
remettre en cause l'idée de souveraineté absolue des états-nation
vis-à-vis des autres et de leurs comportements en interne et faire du
droit international et des droits de l'homme la base fondatrice de
leurs droits nationaux. L'attitude de R.Debray qui consiste à
réhabiliter globalement et sans nuances les frontières politiques
me parait, dans ce (trop) court essai (dont il faut dire qu'il s'agit
de la retranscription d'une conférence polémique, avouée comme telle,
devant un public japonais), regarder l'avenir avec les lunettes du
passé jusqu'à le compromettre radicalement.
Le 13/12/2010
Réponses à qiuelques objections
Le problème que je pose est de savoir si les frontières de la France sont et/ou peuvent être une protection réelle contre la mondialisation dite néo-libérale de l’économie et contre les menaces écologiques.
Ma réponse est simple ; seule l’Europe peut encore être un partenaire de poids dans la régulation de l"économie mondiale et dans la lutte contre le désastre écologique qui s’annonce.
Encore faut-il qu’une majorité citoyenne se dégage en ce sens en Europe. L’Europe politique est à construire contre ceux qui aujourd’hui forment la majorité du conseil des ministres européen, mais ce sont les citoyens "nationaux" qui ont élu indirectement ce conseil des ministres. Le retour au nationalisme politique et des frontières qui va avec n’est pas la solution aux pbs que pose la mondialisation néo-libérale (en fait anti-libérale, car instaurant la dictature du capital), car tous les pbs de la France sont mondialement déterminés
Il n' y a aucune contradiction logique dans ma position : si les pbs de la France sont mondialement déterminés, la France à elle- seule ne peut rien contre eux, son poids économique et écologique est irréversiblement insuffisant (question de logique d’échelle). Par contre l’Europe politiquement plus intégrée pourrait agir pour plus de justice mondiale et lutter pour réduire la menace écologique dont aucun nationaliste ou "frontièriste", du reste, ne dit rien (et pour cause : cela suffit à soi seul à ruiner leur prétendue protection frontalière et protectionniste !).Economie et écologie sont indissociables : A écologie mondiale, politique économique mondiale....
_____________________________________________________________________________________________________________________
La thèse souverainiste serait convaincante si :
1) les populations dans le monde étaient économiquement et donc politiquement indépendantes
2) Les nations étaient définitivement définies, sans conflits ethniques internes possibles
3) Les frontières étaient toutes acceptées et par tous sur la plan international.
4) La question écologique, par nature internationale, n’existait pas
5) La terrorisme international n’existait pas
6) Les armes de destructions massives et le danger d’extermination de l’humanité n’existaient pas
Autant dire que ce n’est pas demain la veille, et encore moins aujourd’hui que hier, que votre utopie de frontières, par elles-mêmes, pacifiées et pacifiantes dans la cadre d’une souveraineté nationa(iste) absolue sera pacifique.
En attendant, je le signale à la fin de mon article, il vaut mieux, pour préserver la paix internationale faire l’éloge de la coopération transfrontière, voire de l’intégration pacifique et juste dans un cadre qui les fasse progressivement disparaître (ex : l’Europe) que de vouloir réhabiliter des frontières en voie pacifique de disparition, tout en insistant sur le fait qu’il faut maintenir la reconnaissance internationale des frontières historiques existante en cas de conflit ou de menace pour la paix.
Question subsidiaire : Quelle frontière au Moyen-Orient faut-il défendre pour rétablir la paix et qui peut le faire ?
Les frontières définies par l’ONU...qui établit la condition d’une cohabitation nécessaire entre juifs et musulmans ou arabes en Israël même et dans la région.
__________________________________________________________________________________________________________________
1) je ne propose pas d’abolir les états existant internationalement , ni même les frontières reconnues internationalement , mais de ne pas faire de ceux-ci des facteurs en soi de paix et ou de respect des droits de l’homme donc je refuse, contrairement à R. Debray, de les réhabiliter en tant que tels, comme valeurs, et je revendique le droit de les soumettre au droit international et aux droits de l’homme (inclus dans la charte de l’ONU, je le rappelle), ce qui implique un certain droit d’ingérence international).
2) je milite pour une réduction volontaire des frontières, dans un cadre démocratique général et juste, partout où cela est possible et est ratifié par les états, particulièrement en Europe ! Dans ce cadre en effet les responsabilités des états doivent être redéfinies, comme entre les différents états aux USA par exemple.
S’il y a encore des différences, culturelles et politiques entre la France et l’Allemagne (et je vis dans les deux pays), il n’y a pas plus de frontières entre elles qu’entre les différents états des USA. Je préfère cette situation à celle de la première moitié du XXème siècle.
La paix passe par la concorde et celle-ci par la suprématie du droit international sur le droit national et par l’ouverture des frontières, voire quand cela est possible comme dans l’UE, leur abolition de fait pour renforcer la coopération pacifique seule apte à établir la concorde.
Intérêt général et référendums.
Objection: "D’autre part, il n’en est pas moins vrai qu’il est un certain nombre de points qui peuvent constituer un socle commun d’union entre les citoyens, socle que l’on peut facilement établir sur base des besoins essentiels de tout un chacun (par soucis de place, je n’établirai pas ici cette liste de besoins fondamentaux)."
Réponse: Citez moi un seul point qui fasse l’accord entre le la vision de l’intérêt général du FN (la préférence de ma soeur à ma cousine, de ma cousine à ma voisine, de ma race ou de mon ethnie à celle des autres, de ma nation à celle des étrangers etc...). et celle, humaniste, fondée sur les droits de l’homme
C’est justement cela qui me semble contestable : aucun point ne peut faire l’objet a priori d’un accord politique quelconque qui ferait que nous puissions être assurés qu’il s’agit de l’intérêt général indépendamment de ceux qui les soutiennent au regard de leur intérêt particulier. L’exemple des référendums suisses que vous citez est pâtant : le seul intérêt prétendument général (du reste inapplicable au regard de la constitution Suisse actuelle) est l’interdiction des minarets (et non pas des clochers) et l’expulsion automatique des délinquants étrangers non-européens (double peine) . L’intérêt général "généré" par la suffrage populaire peut-être xénophobe ou sexiste (comme cela était la cas dans certains cantons suisses alémaniques, où en France avant 45) , à savoir mette en cause les droits de la défense et à un jugement proportionné dans l’égalité des sanctions et des droits des résidents étrangers (ou des femmes) ; mise en cause qui est incompatible avec les droits de l’homme qui sont au fondement de l’idée d’’intérêt général, laquelle affirme que la loi doit être la même pour tous les hommes (et les femmes).
Quelle chance aurait un référendum -dont les étrangers résidents sont exclus- en vue d’autoriser les étrangers résidents à voter dans leur pays de résidence et à faire que leurs droits humains, donc aussi celui de citoyenneté là où ils vivent, soient intégralement respectés ?
La réponse est : extrêmement faible. L’intérêt général, sans les droits de l’homme qui en sont le fondement, n’est que l’intérêt d’une majorité de circonstance auto-identifiée comme ayant tous les droits contre une minorité. Il n’est que l’expression d’une dictature majoritaire.
Merci de m’avoir tendu la perche de la Suisse et de ses référendums récents dont le résultats se sont faits aux dépens des résidents étrangers ou des musulmans...même nationaux.(Clocher contre minarets). Mais précisément la Suisse ne peut appliquer aucune des décisions référendaires que vous citez, sans modifier sa constitution et les traités qui la lient à l’UE, d’une part et sans faire que la majorité alémanique s’impose à la majorité francophone, d’autre part ! Où se trouve l’Intérêt général Suisse dans cette affaire : certainement pas dans le suffrage majoritaire populaire pour ne pas dire populiste et une nouvelle majorité, où le parlement suisse, qui seul en Suisse, peut décider si une décision référendaire est constitutionnelle ou non, rétabliront une autre vision, plus conforme aux droits humains, de l’intérêt général Et ainsi de suite !
Quant à vous, si vous vous sentez des points communs avec le FN et ses électeurs en ce qui concerne la notion d’intérêt général, dites nous lesquels...Cela rendra le débat plus concret et plus décisif encore...
Vie et mort du patriarcat
La question des femmes et de leur statut dans les sociétés traditionnelles ne peut se comprendre que dans le cadre de la question de la famille comme mode de reproduction sociale obligatoire laquelle implique ou exige le certitude quant la filiation et quant à la circulation des femmes entre les clans familiaux pour lier ces clans en cette forme obligatoire de solidarité inter-clanique que constitue la tribu. C’est cette tradition qui est aujourd’hui mise en cause par la modernité, la question est donc de avoir si cette mise en cause est justifiée et donc politiquement nécessaire pour accéder à une société plus démocratique et libérale, si donc le féminisme est un facteur ou non de progrès.
La famille patriarcale, dans toutes les sociétés pré-modernes, est la base de la constitution du lien social sur un fond tribal de solidarité automatique qui met en jeu la circulation des biens matériels et culturels entre les générations, elle même indissociable de celle des femmes entre clans familiaux. C'est pourquoi, dans les sociétés traditionnelles, les liens de parenté sont au fondement de l'ordre social et la famille est la condition de la sociabilité, c'est-à-dire de la socialisation ou de l'intégration éducative des enfants au sein de l'ordre social.
C'est pourquoi la famille patriarcale qui consacre le pouvoir exclusif des hommes sur les femmes dans la société est nécessaire pour assurer cette filiation indispensable sur les plans économique et social dans la mesure où la paternité, au contraire de la maternité, est toujours problématique.Si les femmes sont libres sexuellement, la paternité devient plus problématique, c'est pourquoi les maris, actuels ou futurs, doivent assurer leur pouvoir exclusif sur leurs épouses : aucun homme ne peut avoir cette assurance, sans un contrôle étroit sur sa femme et le confinement de celle-ci dans l'espace domestique où ce contrôle peut être facilement assuré par pères, frères ou maris. Dans les cas extrêmes c'est l'excision ou l'infibulation et, dans une moindre mesure, la virginité des femmes avant mariage et la condamnation exclusive de l'adultère des femmes (lapidation ou prostitution honteuse réputée infertile ou asociale du fait de l'exclusion des bâtards de toute lignée clanique), qui peut enfin garantir la certitude de la paternité.
Mais ce pouvoir patriarcal se justifie aussi par les faits, d'une part, que seules les femmes peuvent biologiquement tomber enceintes et nourrir leurs enfants en bas âge et que d'autre part, ne pouvant être au four et au moulin, elles doivent, pour assurer cette fonction reproductrice, laisser les hommes maîtres du pouvoir économique, social, politique et militaire qui conditionne la vie domestique et la survie de l'ordre social face aux autres sociétés ou groupes étrangers. N'oublions pas que la conquête virile commence par le fait que le conquérant doit (voire se donne le droit de) soumettre par le viol ou le mariage forcé les femmes du groupe social conquis pour casser, interrompre ou détourner les liens de filiation de ce dernier à son profit, mais aussi pour convaincre le vaincu et se convaincre lui-même de sa puissance supérieure, naturelle et divine, à savoir sexuelle et raciale.
Cette domination des femmes par les hommes, en effet, se donne toujours des fondements religieux imaginaires (et toutes les religions, comme machines d'un pouvoir idéologique constitutif de l'ordre politico-social sont toutes plus ou moins sexistes et misogynes), dès lors que, pour toutes les religions, sexes naturels ou biologiques et genres ou statuts sociaux confondus sont inséparables d'une ordre divin sacré (intouchable) qui fonde, dans l'éternité de la tradition ancestrale mythique, l'ordre social, son autorité sur les esprits (légitimité) et sa pérennité. L'être naturel et l'être divin, comme l'homme dieu et le dieu homme, ne font qu'un pour toutes les religions qui s'efforcent de confondre nature et puissance surnaturelle afin de cristalliser ou pétrifier les liens sociétaux et d' interdire la possibilité :
de l'ouverture de l'espace politique à une contestation permanente des relations de pouvoir entre les sexes, transformés, par la religion sur-naturalisée, c'est-à-dire une religion où la nature est divinisée, en genres sociaux statutaires figés, car rendus incontestables dans l'imaginaire sexuel devenu, par la définition immobiles et inégalitaire des genres sociaux. (ce pourquoi il ne faut pas confondre le sexe biologique ou l'inclination sexuelle personnelle avec un genre social statutaire)
de la mise en cause conséquente des rapports de filiation et de circulation des femmes entre clans qui conditionnent la reproduction des alliances tribales ou inter-claniques stables.
Or nul doute que le patriarcat est, dans nos démocraties, partout en crise, car il est délégitimé dans ses fondements religieux et naturalistes. Les genres ne définissent plus en droit, sinon en fait, les statuts quant aux rôles économiques, sociaux et politiques, voire militaires, des hommes et des femmes. Au nom des droits universels ou égaux des hommes et des femmes, l'égale liberté de chacun, quel que soit son sexe et/ou sa sexualité est affirmée comme une exigence fondamentale de la démocratie politique. La laïcité, à savoir la séparation en droit, sinon en fait, de l'état et de l'ordre politique et social par rapport à la religion, ainsi que la part grandissante des femmes dans le vie économique, mais aussi et surtout le pouvoir technique absolu que les femmes ont conquis, grâce à la contraception et à l'avortement légal, sur leur reproduction, ont rendu nécessaire et irréversible la contestation du patriarcat qui n'a plus les conditions en droit et en fait de s'exercer sans résistance et sanctions légales.
Mais si le patriarcat est politiquement mort, son cadavre, au travers de traditions de moins en moins capables d'assurer une autorité religieuse sacrée consensuelle (sans religion le sens du sacré se perd inexorablement), bouge encore. Et cela en particulier sous la forme d'un machisme pulsionnel agressif, voire physiquement (1femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon) ou psychologiquement extrêmement violent et de la discrimination à l'accès aux fonctions de pouvoir économique et politique. Le candidature à la présidence de la République de Ségolène Royal chez qui le féminisme anti-machiste est clairement affirmé, a brutalement ressuscité les réactions d'horreur et les insultes les plus traditionnelles dans l'espace politique français, encore idéologiquement conditionné par la loi salique, y compris chez nombre de dirigeants de gauche, vis-à-vis des femmes qui exercent la pouvoir ou y prétendent. Rappelons qu'il a fallu attendre la fin de le deuxième guerre mondiale, plus de 150 ans après la révolution française, pour que les femmes conquièrent le droit de vote, contre la droite et la gauche majoritairement unies, sous la troisième république, dans leur refus de voir les femmes participer à la vie citoyenne.
Ainsi, si la cadavre du patriarcat bouge encore, il convient alors, pour l'achever, d'être féministe en ce qui concerne les relations de pouvoir, pour assurer, dans les faits, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, jusqu'au moment où de théorique et d'idéale, cette égalité légale deviendra pratique, c'est-à-dire traditionnelle, sans pour autant être religieuse, sur le seul fondement intégré par chacun quels que soient son sexe biologique et/ou sa sexualité vécue, des droits universels de l'homme, libérés des droits divins et de la différenciation traditionnelle et religieuse , hiérarchique et statutaire, des genres..
L'avenir de la démocratie, chez nous, comme en Tunisie et partout dans le monde, se joue d'abord sur cette question de la place des femmes dans la cité et de leur égalité réelle avec les hommes.
Le paradoxe de la laïcité comme fondement de l’état
La question de la laïcité est, en Europe, controversée. La définition que l’on donne de ce terme, quand définition il y a (ce qui n’est pas le cas en Allemagne), peut varier énormément d’un état à l’autre : certains états réclament même qu’il soit inscrit dans la constitution européenne ou ce qui en tient lieu, le traité de Lisbonne, l’origine judéo-chrétienne de l’Europe comme fondement de son unité culturelle. Il faut constater que le principe de laïcité à la française comme stricte séparation de(s) l’église(s) et de l’état et de la religion et de la politique ne va de soi pour la plupart de nos partenaires européens. Cette séparation semble se heurter à un paradoxe que l’on peut formuler de la manière suivante : comment interdire à un état de se référer, quant à ses principe fondamentaux, à des valeurs, qui plus est considérées comme sacrées, qui font consensus dans la société ? La démocratie n’a-t-elle pas vocation à exprimer les choix éthique et moraux de la majorité des citoyens pour définir ce qui est juste ou injuste ?
Tout état ne peut durablement exercer le pouvoir sur les sujets ou citoyens que s'il dispose du monopole de la force légitime (et non pas seulement légale). C'est le droit qui confère cette légitimité, comme légalité instituée, encore faut-il que celle-ci soit perçue comme juste, c'est à dire au service de l'intérêt général et de la concorde civile. Pascal affirme que, ne pouvant faire que le droit seul soit fort, les états se sont efforcés de faire que la force soit perçue comme juste dans l'usage qu'il en font. Contrairement à certaines interprétations réductrices, cette transformation du droit, chez Pascal, n' est pas seulement un mensonge cosmétique pour masquer une domination, tyrannique, mais est indispensable à la paix civile, le premier des biens commun. De plus, de ce point de vue réaliste, tout gouvernement qui en est le sommet décisionnel, en tant qu'autorité régulatrice centrale de la vie sociale, ne peut apparaître comme légitime ou juste aux yeux de ceux sur lesquels il exerce son pouvoir hiérarchique que s'il met en œuvre, dans sa politique concrète, des valeurs qui fassent l'accord du plus grand nombre. La force au service de la loi ou du droit, comme ensemble de règles favorables à l'intérêt général, est donc seule légitime au contraire d'une force tyrannique violente. Ainsi tout état repose sur un contrat social tacite (théologico-naturaliste monarchique) ou explicite (constitutionnel républicain, voire démocratique) qui en fonde la légitimité.
C'est pourquoi, comme le disait Max Weber, l'état tend à disposer du monopole de l'usage légitime de la violence pour faire régner la paix civile et satisfaire à l'exigence de justice en interne et, à l'extérieur, pour défendre la société contre ses ennemis hors frontières. Il est, en cela, absolument souverain sur son territoire. Sa violence, légitimée par le droit, est une force protectrice réputée non tyrannique et donc non-despotique, favorable à la paix, c'est à dire à la concorde civile, voire dans nos sociétés libérales, favorable aux droits universels de l'homme et du citoyen à l'intérieur, ainsi qu'à liberté de tous vis-à-vis d'un éventuelle domination étrangère.
Mais pour ce faire il est indispensable que l'état, dans la personne du monarque ou dans la constitution républicaine, incarne des valeurs communes indiscutées, sinon indiscutables. Or la manière historiquement la plus efficace d'obtenir un tel consensus a été et est encore traditionnellement la religion qui sacralise les valeurs éthiques et politiques et donc produit les conditions d'une légitimité sacrée ou sacralisée par le recours à la soumission à l'autorité divine qui ordonne absolument ce qui est bien et ce qui est mal, y compris en terme de hiérarchie sociale ici bas en vue du salut post-mortem. Obéir à l'état et accepter les inégalités de pouvoirs et de biens dans la société qu'il ordonne et préserve, c'est obéir à un pouvoir divin qui transcende la pluralité des intérêts et des valeurs opposées que génère spontanément la diversité sociale. Ainsi toute société doit, pour être ordonnée, disposer d'un état dont la légitimité repose sur des valeurs sacrées transcendant les égoïsmes personnels et collectifs particuliers. Seules les religions transcendantes ont traditionnellement jouer ce rôle de justification des pouvoirs établis. « Tout pouvoir humain vient de Dieu a affirmé Paul de Tarse ».Que ce soit celui des empereurs, des rois, des nobles, des hommes sur les femmes, des maîtres sur les esclaves etc... tout pouvoir est divin, car seul Dieu peut conférer à un homme un pouvoir supérieur stable et/ou héréditaire sur les autres. Sans cette validation divine, un pouvoir serait, en effet, immédiatement renversé par impuissance à s'imposer durablement.
Or cette unicité religieuse des sociétés traditionnelles se défait toujours, à terme, sous le coup des contradictions sociales que génèrent les conflits d'intérêt et de valeurs dans les sociétés complexes et hiérarchiquement divisées en évolution. Ces conflits se transforment alors en guerres de religions interminables, puisque chaque camp revendique pour lui même et contre les autres la justice divine, voire le sacré. Le guerre entre absolus ou interprétations divergentes de l'absolu divin (guerre des dieux comme disait Max Weber) ne connait nécessairement aucun compromis pacifique possible. Tout compromis suppose, en effet, l'acceptation que la justice est relative à des exigences contradictoires et donc non divines entre des intérêts et des valeurs opposées. Pour sortir des guerres de religions en tant que telles interminables et de la violence sacrée et donc sacrificielle de soi et des autres, il faut que l'état renonce à tout fondement religieux transcendant et qu'il s'affirme comme laïque ou séculier, c'est à dire non théocratique. La loi est celle que se donnent démocratiquement des citoyens idéologiquement divisés et non pas celle de Dieu ou d'une église et état autoritaires de type théocratique.
Mais l'on voit poindre le paradoxe de l'état laïque : celui-ci doit favoriser un consensus qui rend légitime les inégalités des pouvoirs sociétaux (ne serait que le sien), la régulation des conflits sociaux, une exigence de justice pour tous, sans avoir recours à un pouvoir unificateur supérieur ou extérieur à la division idéologique et sociale de la société. Il doit instituer une religion laïque minimale non transcendante autour de valeurs proprement humaines ou humanistes tout en étant sacralisées (indiscutables) que sont la liberté, l'égalité et la fraternité qui s'incarne dans les droits de l'homme et du citoyen. Une religion que d'aucuns (ex : R. Debray) après Rousseau appellent civile.
Cependant cette reconnaissance de ces valeurs unificatrices ne va pas de soi. En effet elles sont, sinon logiquement contradictoires, le plus souvent pratiquement opposés et donc leur interprétation et la hiérarchie a mettre en œuvre entre elles est l'enjeu de débats politiques que les procédures démocratiques ont pour fonction non pas de dépasser mais de pacifier sous la règle majoritaire qu'il faut admettre comme momentanément (entre deux élections) incontestable ! La justice et l'intérêt général sont ce qu'une majorité de citoyens a, à tel moment, admis comme tels, quitte à changer de position aux prochaines élections (alternance).
On voit alors en quoi la démocratie est fragile et en quoi la laïcité, dès lors que des courants religieux qui se réclament de valeurs divines continuent à orienter les comportements politiques des citoyens, peut être contestée ou combattue, comme étant athée, voire anti-religieuse et donc conduire à refuser la loi de la majorité ou bien, à la faveur d'une majorité de circonstance, à imposer à tous les valeurs de leur croyances particulières et rétablir un théocratisme politico-moral tyrannique majoritaire anti-pluraliste. C'est pourquoi les libertés ou droits de l'homme et la laïcité doivent être protégés contre tous ceux qui, majoritaires ou non, au nom de leur foi, les mettraient en cause. Et cela ne peut être fait qu'en soumettant la loi majoritaire au respect des valeurs laïques humanistes et non divines en faisant de la laïcité un principe fondateur de tout régime démocratique. Ce qui implique la mise en place d'une institution transcendante, politique et juridique, apte à décider en dernier ressort, que telle loi ou comportement politique, même majoritaire, est conforme ou non aux principes constitutionnels fondamentaux humanistes et laïques. Seules seront concernés par le principe majoritaire, l'interprétation concrète des valeurs de liberté, égalité et fraternité, toujours plus ou moins opposés dans une société divisée en classes, ainsi que la hiérarchie, dans tel ou tel contexte de conflit sociaux (lutte de classes), à mettre en œuvre entre elles.
Il est clair que si la laïcité doit consacrer la séparation de la religion et de la politique ,des églises et de l'état, il reste que 3 visions de cette séparation se partagent l'offre politique dans nos démocratie :
La vision la plus incohérente est celle que l'on observe dans toutes les démocraties qui subventionnent les cultes (par l'intermédiaire d'un impôt d'église) et qui font des religions et des églises des acteurs politiques officiels parties prenantes des décisions politiques et de leur exécution au plus haut niveau et à qui l'on confie un monopole ou une hégémonie de fait sinon de droit, sur toute une partie des activités sociales de l'état : éducatives, culturelles et sociales.
La vision inverse est apparemment la plus cohérente : elle refuse toute immixtion des religions dans la vie publique et politique en les cantonnant dans le sphère strictement privée. Elle a l'avantage de régler théoriquement ou abstraitement le problème, mais à l'immense défaut de refuser la libre expression des croyances religieuses, pourtant constitutive de la laïcité, dans l'espace public et sur le plan pratique elle est inapplicable : toute religion est collective et donc doit pouvoir convertir publiquement pour exercer sa mission propre.
Ma position est de séparer la religion de la politique en distinguant ce qui relève de la vie politique et de la vie publique .Elle implique
1) L'autorisation des manifestations religieuses (sauf trouble de l'ordre public) dans l'espace public,
2) mais l'interdiction du port de signes religieux pour tout fonctionnaire ou ayant une mission relevant de la vie civique e des partis politiques se référant à une position religieuse ou biblique (ex : Christine Boutin brandissant la bible lors d'une séance de l'Assemblée nationale)
3) l'exigence de l'emploi d'arguments non-religieux dans le débat citoyen. Ce qui veut dire que tout argument politique doit être toujours présenté comme rationnel, c'est à dire susceptible de recevoir l'assentiment raisonné de tous, croyants ou non, sur fond des valeurs de la république.
4) Enfin l'interdiction du délit de blasphème et bien sûr le refus de toute référence à la religion et à Dieu dans la constitution.
La laïcité, comme compromis politique démocratique nécessaire à la concorde civile, dans une société idéologiquement pluraliste, est donc, tout à la fois, tolérance publique de l'expression des idées religieuses et anti-religieuses, et séparation du pouvoir proprement politique (temporel) et du pouvoir idéologique ou spirituel d'influence que les diverses croyances religieuses tentent d'instaurer sur l'ensemble de la société civile. Ce compromis ne va pas de soi. Il est clair donc que la référence à des racines historiques religieuses dont la fonction serait de nous enraciner à une position religieuse particulière, bien que très floues dans ses conséquences concrètes, ouvrirait la possibilité d'imposer, à qui ne croit pas ou qui se réfère à des croyances provenant d'autres origines religieuses, des comportements éthiques et des normes juridiques qui relèvent de croyances particulières rendues en droit incontestables. C'est pourquoi les pays les plus laïques sont ceux, dont la France, qui ont admis l'athéisme comme une idée aussi légitime que les différentes croyances religieuses et qui refusent en conséquence de lier la décision politique à des considérations religieuses.
Rien ne peut justifier, sur le plan du droit démocratique européen, que tous les européens devraient se sentir judeo-chrétiens lorsqu'ils participent à la vie politique, sauf à refuser le principe de la liberté de conscience et donc les droits de l'homme, seuls authentiques fondements de la vie démocratique. La démocratie en effet n'est pas une tyrannie majoritaire dans laquelle une majorité théocratique pourrait interdire la pluralisme idéologique et religieux. Les droits de l'homme ne doivent en rien être soumis à un quelconque droit divin, fût-il judeo-chrétien dont nul, hors telle ou telle église particulière, ne peut, du reste, fournir de définition unifiée et indiscutable
Le capitalisme peut-il être moral ?
Le capitalisme est le système de production et d'échanges de biens marchands dans lequel celui qui dispose d'un capital de départ vise à maximiser son profit propre (privé) en faisant usage du travail ou des services de salariés qui vendent ou louent leur force de travail au profit de qui les emploie et les paie, à savoir de qui dispose par son propre fonds ou par emprunt d'un capital financier pour ce faire.
Le profit privé, plus value ou bénéfice ou intérêt du capital investi, est donc le seul but du capitaliste, comme la maximalisation de son salaire celui du salarié, (ce qui implique un conflit ouvert ou latent entre profit et salaire ). Ainsi le capitalisme transforme le capital investi est une relation sociale d'exploitation entre la capital et la travail en vue du profit du capitaliste. De ce fait, le capitalisme instaure le règne de l'égoïsme dans les relations économiques et des rapports sociaux de production et d'échange qui en découlent procèdent. En cela le capitalisme n'est pas et n'a pas à être moral au sens d'altruiste. Mais la notion de morale est ambiguë : On peut distinguer 2 sens dans l’usage que l’on fait de ce terme
1) Soit le terme de "morale fait référence à une vision de la relation aux autres purement altruiste, selon des valeurs qui visent à instaurer des rapports généreux et désintéressés (et donc gratuits) entre les hommes et qui exigent le sacrifice consenti (obligation) de tout ou partie de l’intérêt personnel au profit des autres et de la communauté, voire de l’humanité toute entière. C’est la morale "religieuse" de l’altruisme ou amour universel, qui fonde la charité et la compassion. Ou bien elle fait référence à la tentative rationnelle de Kant pour qui la morale concerne le sphère de l'action par devoir et non pas celle de l'intérêt et/ou du désir qui ne peut qu'être "conforme"à la morale, à savoir respecter les droits et la dignité d'autrui, sans être morale en elle-même. Le capitalisme ne peut être moral selon la vision rationnelle de Kant, mais n'est pas forcément immoral. Le capitalisme dans le meilleur des cas ne peut être qu'a-moral c'est-à-dire conforme aux règles intéressées de la réciprocité universelle contractuelle.
Si, pour Kant, le capitalisme est compatible avec la moralité à la condition que chaque partenaire de la transaction et du contrat commercial ou de travail respecte sa parole propre et les droits d'autrui, il n'en est pas de même du point de vue d'une morale chrétienne qui fait de l'amour universel (absolu chez Dieu) et de la charité les fondements de la morale. Ces deux valeurs fondamentales ne s'incarnent que dans le don gratuit, sans revendication, même cachée, d'un retour ou d'une réciprocité matérielle ou affective. L'attitude morale consiste à renoncer à tout espèce d'égoïsme ou d'intérêt personnel jusqu'au sacrifice de soi dans l'amour de Dieu et des autres dont le Christ, fils de Dieu et Dieu incarné, est l'icône et le modèle absolu. En cela le capitalisme, voire le commerce marchand, est, pour un chrétien authentique, à l'exemple même de la passion (sacrifice) et du message du Christ, doublement immoral :
- Son but est le profit égoïste financier dans la compétition, voire l'exploitation et donc la négation de l'amour désintéressé envers autrui. La charité dans le contexte du capitalisme n'est jamais que l'alibi et le masque trompeur de l'égoïsme qui cherche à se légitimer aux yeux de ses victimes. L'hypocrisie et le détournement du Christ sont donc plus immoral encore en cela que l'injustice et le refus d'amour de l'autre qu'incarne le capitalisme dans les faits prétend se justifier au nom même de la liberté personnelle par le recours au don hypocritement désintéressé du riche au profit des pauvres dans le but de masquer l'injustice de la domination du riche sur la pauvre en le transformant en assisté dépendant de ce prétendu don.
- Son moyen est la compétition pour le profit privé, c'est-à-dire la concurrence libre et non-faussée. Ce moyen unique génère et exacerbe l"égoïsme individuel aux dépens des autres en faisant du don une mystification morale ou un alibi pour le commerce. Mais plus encore en faisant des désirs somptuaires (voire la pub) et de la consommation auto-valorisante la source du seul sens possible de la vie ici-bas, il dissout tout espèce d'altruisme sincère sauf à en faire une occasion de se faire valoir aux yeux des autres pour en profiter. Donner pour recevoir telle est la règle du commerce et le don en apparence gratuit appelle nécessairement un contre don en faisant à autrui obligation de rembourser la dette matérielle et morale ainsi consentie. Le don apparemment charitable est perverti ou converti en dette perpétuelle, en assistance liberticide de l'autre, par la culpabilité permanente qu'il entretient chez l'autre qui ne peut la rembourser, e,n obligation, voire en allégeance vis-à-vis du bienfaiteur.
En cela le capitalisme est profondément immoral, car il est, par principe, incompatible avec les valeurs chrétiennes. Se dire chrétien et pratiquer le capitalisme, c'est dévoyer le christianisme en son essence idéale. Pire encore, c'est tenter de justifier le capitalisme au nom de la liberté personnelle. Ce qui est proprement diabolique, car cela revient est assurer la triomphe de la liberté égoïste de chacun contre la liberté des autres dans le refus de toute solidarité et de la fraternité humaine aimante.
Si le capitalisme est anti-chrétien dans son but et ses moyens, un chrétien authentique ne peut être qu'anti-capitaliste. C'est pour cela que le christianisme authentique ne peut considérer comme moral que le communisme universel intégral, c'est bien ce que l'on voit dans les actes des apôtres concernant les premières communautés chrétiennes dans lesquelles tout appartenait à tous et où la redistribution était de l'ordre du partage et du don de la communauté à chacun . Marx reprendra cette utopie communiste en refusant le propriété privée des moyens de production et d'échange et plus largement en prévoyant l'abolition dans la société réconciliée, égalitaire, sans riches ni pauvres des relations monétaires et commerciales. Il ne convient pas d'abolir la religion chrétienne a-t-il dit, mais de la réaliser pratiquement en ce monde par la révolution communiste, c'est-à-dire par l'abolition de la propriété privée des moyens de productions et d'échange pour en faire la propriété de tous ceux qui créent et consomment les richesses produites dans l'égalité de fait et non seulement de droit selon le principe, à chacun selon ses besoins ! Le capitalisme est par nature immoral car il est fondé sur la recherche du profit sans limite, c'est-à-dire l'avidité, voire la cupidité des plus riches et l'exploitation de l'homme pauvre , transformé en simple moyen de production, par l'homme riche. Il est aussi immoral en cela que, par la publicité omniprésente dans l'espace social, il tend à faire de tous des consommateurs frénétiques pour lesquels les désirs matériels égocentriques, narcissiques, l'emportent sur l'amour et le partage. Il aggrave nécessairement les inégalités qui lui sont nécessaires pour vivre, du fait que la hausse du taux de profit, voire son maintien, dans la mesure où il tend à baisser, implique la hausse du taux d'exploitation afin de l'emporter dans la concurrence (ex : réduction des salaires moyens dans la monde et délocalisation).
Mais il est clair que la morale chrétienne (ou communiste ou même kantienne) est utopique car trop ambitieuse pour être humaine, elles ne vaut que pour des saints religieux ou purement rationnels ou des moines vivants hors du monde ou coupés de la société réelle et/ou pour des hommes qui n'existent pas, dès lors qu'ils seraient dépourvus de désirs propres et surtout de tout narcissisme ! Sans parler du salut post-mortem, rien ne dit que les plus saints ou déclarés tels renoncent à tout intérêt personnel ne serait-ce que le sentiment auto- valorisant (dignité et estime de soi) de faire le bien autour d'eux en servant Dieu.
De plus cette vision de l'amour universel et sacrificiel de soi ne fait pas d'autrui nécessairement une personne libérée de la dette à l'égard de l'acte d'amour et de générosité dont elle est l'objet ainsi que du sentiment de culpabilité qu'engendre l'inégalité dans le pouvoir de répondre, à son tour, à la mesure de cet amour infini : Elle crée les conditions d'une dépendance permanente aux autres et à Dieu liberticide dès lors que la liberté est aussi d'agir pour soi comme fin, à savoir pour ses propres fins. Elle sacrifie le liberté individuelle réaliste à une exigence utopique et impraticable de solidarité infinie. Elle fait de l'égoïsme le contraire de la liberté en faisant de l'altruisme une libération de soi alors que c'est dans le bon l'usage de cette passion qu'est l'amour de soi que peut s'inscrire une authentique et réaliste solidarité entre des personnes libres
2) Soit le terme de morale fait référence à des valeurs universelles en droit susceptible de promouvoir l’entraide et la coopération pacifique, donc la concorde civile. C’est la morale politique de la justice dans le respect la liberté et des intérêts individuels. Elle promeut des règles de comportement qui rendent possibles l’accord durable entre des partenaires en vue de la promotion de leurs intérêts mutuels. Il vise la confiance des partenaires les uns vis-à-vis les autres qui passe par le respect des contrats et des droits des parties contractantes, sans souci de l’universel humain, ni valeurs ou principes d’action transcendant le jeu des intérêts particuliers. C’est la morale économique des affaires et du droit y afférant (sans jeu de mot).
Il est clair que le capitalisme, du point de vue de ses finalités, n’a rien à faire de la notion de la morale purement altruiste ; sa visée c’est le profit de ceux qui investissent et le moyen, la satisfaction des clients et le contexte, la plus ou moins libre concurrence (le but étant pour chaque entreprise de détenir le monopole ou la position hégémonique ou au moins dominante sur le marché)
Si le capitalisme n’a pas à être moral au sens 1, doit-il et peut-il l'être au sens 2 ?
Certainement oui, sauf à perdre la confiance indispensable à son fonctionnement efficace (ex : l’importance de l’image de marque et de l’honnêteté commerçante et contractuelle), mais ce sens 2 relève de la responsabilité de la politique au sens démocratique du terme, car le capitalisme est spontanément anti-concurrentiel, voire mafieux, donc injuste, en vue de faire le maximum de profit. La démocratie est donc le moyen d’obliger le capitalisme à être moral au sens 2 (justice sociale), sauf à s’auto-détruire et à accepter la violence comme mode normal des relations entre les hommes .En l’absence de religion compensatrice politiquement dominante la violence civile est en effet la conséquence nécessaire de l’injustice sociale. Mais lorsque celle-ci , par défaut de la politique, devient insupportable, la violence sociale risque alors de prendre la forme de la violence religieuse : le pire de toute car marquée par le délire de l’absolu.
Donc si le capitalisme n’est pas spontanément moral au sens 2 et il est absurde de demander qu’il le devienne par lui-même, c’est à la puissance publique de le contraindre à l’être en vue de la paix civile. Le capitalisme démoralise spontanément la société au sens 2. En cela s'il est par nature au moins amoral au sens 1, mais il devient immoral au sens 2 si on le laisse faire (ou si on ne régule pas son fonctionnement en vue de réduire les inégalités). La capitalisme a besoin d'une morale libérale et soucieuse du droit contractuel, ce qui n’est pas négligeable en cela qu’elle fait du contrat et non de la violence physique ouverte la norme des relations humaines (Le commerce vaut mieux quel la razzia et le meurtre).
La morale publique et laïque (ou mieux la justice sociale) et les droits des hommes relèvent de l’autorité de la politique et non de l’économie (capitaliste fractionnée ou d’état, comme l’expérience historique l’a montré).
Laissons donc le sens 1 à la foi religieuse privée, il ne peut valoir comme valant pour tous dans une société pluraliste et libérale (donc démocratique), sauf à vouloir abattre elle-ci par une révolution qui instaurerait un état totalitaire qui prétendrait opérer une révolution morale de l’économie par la force, à savoir une révolution idéologique ou culturelle totalitaire, n'hésitant pas à utiliser la terreur physique ou religieuse.Contentons nous de viser à contraindre démocratiquement, par le droit du travail et les luttes sociales, le capitalisme à adopter des règles de fonctionnement qui l'oblige à prendre en compte la réduction des inégalités sociales de droit et de fait .
La question de savoir comment le faire dans un monde capitaliste irréversiblement sans frontières est l'enjeu du débat politique dans lequel l'internationalisme doit prendre le pas sur la nationalisme, encore plus aujourd'hui que du temps de Marx. Ce n'est pas gagné, comme le montre le succès relatif du Front national en France et de ses frères jumeaux en Europe.
Commentaire critique:
Voyons maintenant nos points de désaccord.
1. Je
ne suis pas sûr qu’il faille mettre à part les morales altruistes. En
réalité, aucune morale n’est purement altruiste. Tout homme cherche à
réaliser ses désirs. Ces derniers peuvent être égoïstes ou altruistes,
mais ce sont toujours les désirs d’une personne. Ainsi, en étant
altruiste, on réalise aussi son propre but. D’ailleurs, que
dit Kant ? Traite toute personne - que ce soit toi ou un
autre - comme une fin en soi, et pas comme un simple moyen. Pour
Kant, le respect doit aller à tout autre humain, y compris à soi-même.
Il
en va de même pour le christianisme. Si le commandement suprême est
"Aime ton prochain comme toi-même", alors il s’ensuit logiquement qu’on
ne peut bien aimer les autres si on ne s’aime pas soi-même. Enfin, la
morale communiste n’implique aucunement l’immolation des individus à la
communauté. Pour Marx, la société communiste sera une libre association
d’individus, non un kholkoze stalinien.
2. Puisque
les morales "altruistes" tiennent aussi compte de l’intérêt personnel,
il n’est pas sûr qu’elles soient aussi irréalisables que vous le dites.
Si le christianisme et le communisme ont échoué à créer une société
vraiment morale, c’est parce qu’une minorité a utilisé ces deux
doctrines à des fins idéologiques, pour asservir les masses en leur
faisant croire que leur devoir était de se sacrifier à une idole
(Dieu, l’Eglise, Staline, le Parti, etc.).
3. Je
relève une contradiction (au moins apparente) dans vos propos. Vous
dites que le capitalisme suppose une "concurrence libre et non faussée"
puis, un peu plus bas, vous concédez que la concurrence est en fait
plus ou moins libre, car chaque entreprise a pour but "de
détenir le monopole ou la position hégémonique ou au moins dominante
sur le marché".
4. Vous
appelez à un encadrement démocratique du capitalisme. L’intention est
louable, mais elle me paraît peu réaliste. Pourquoi les capitalistes
ont-ils consenti dans l’histoire à modérer leur avarice ? Pourquoi
y a-t-il eu d’importants progrès sociaux aux 19ème et 20ème
siècles ? Parce qu’il fallait couper l’herbe sous le pied des
révolutionnaires. Bismarck, les travaillistes anglais, la droite
gaulliste ont consenti à des compromis historiques parce qu’il fallait
sauver le système. Ainsi, les réformes sociales-démocrates ont-elles vu
le jour sous la pression de mouvements révolutionnaires. Depuis que ces
mouvements se sont affaibli, la sociale-démocratie est devenu
social-libéralisme, et les réformes sont devenues des régressions.
Réponse :
Excellent commentaire auquel je vais m’employer (tenter) de répondre point par point.
DSK, les primaires et la gauche
Les primaires organisées par le PS et décidées par l'ensemble des militants ne concernent pas que ces derniers, mais tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche. Or elles se présentent on ne peut plus mal : non seulement nos partenaires sont en fait, sinon en droit, mis sur la touche, mais on a tout fait au PS pour escamoter le débat au sein des militants et des sympathisants de parti en organisant la campagne des primaires en période estivales et de rentrée scolaire.
De plus, et cela est le plus grave, tout semble suspendu à une éventuelle candidature de DSK qui ne peut en tant que directeur du FMI se déclarer publiquement et avec qui notre secrétaire générale aurait, selon des propos officieux non démentis, passé un pacte secret de désistement, sans même que la question de la ligne politique de cette candidature ne soit posée. Dans de telles conditions de manœuvres en coulisses, d'enfumage politicien et donc de déni de la démocratie , il convient d'examiner avant toute choses quels sont les motifs de rejeter en l'état cette candidature : quatre arguments me semblent devoir et pouvoir être invoqués :
1) DSK est, pour l'heure, directeur du FMI, avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy, ne l'oublions pas . À ce titre, il me semble qu'il devrait rester à ce poste pour impulser, si cela est possible et face à la crise monétaire et financière mondiale qui concerne au premier plan la France et l'Europe, une politique mondiale plus sociale-démocrate et solidaire,.. En outre, il n'a pas achevé le changement démocratique qu'il a dit vouloir initier au FMI. Il est donc à mes yeux le mieux placé pour le poursuivre durant un mandat supplémentaire. De ce point de vue, il est irresponsable que le PS ne soit pas posé et ne se pose pas la question de savoir par qui DSK, dans ce but, pourrait être remplacé au FMI avant la fin de son mandat, s'il devenait candidat à la présidence de la république. Cela traduit à mon avis une incapacité des dirigeants du PS à comprendre et donc à tenir effectivement compte du fait que la politique nationale et la politique mondiale sont désormais indissociables.
2) Tout un chacun peut constater que la politique qu'il déploie au FMI est, sur l'essentiel, contraire aux propositions du PS pour la France. Elle reste ultra-libérale et anti-sociale : il suffit de prendre l'exemple des mesures que le FMI impose à la Grèce et au Portugal pour s'en convaincre et, concernant la France, de se souvenir de sa position sur les retraites.
3) Ainsi, s 'il adopte tout ou partie de l'esprit du programme du PS pour se faire élire en tant que candidat de gauche, il se mettra nécessairement en contradiction vis-à-vis de ses propos et ses actes à la direction du FMI et permettra à son adversaire de dénoncer son revirement politicien. Si, par contre, il n'adopte pas l'esprit du programme du PS et reste sur la ligne du FMI, il n' y aura pas de différences programmatiques réellement alternatives entre sa candidature et celle de son adversaire, clairement de droite. La différentiation indispensable pour se faire élire se fera par le recours aux ragots concernant la vie personnelle des candidats, ce qui décrédibilisera encore plus la politique et la démocratie auprès d'un nombre grandissant d' électeurs, lesquels, du même coup, seront plus tentés encore par l'abstention ou le vote FN..
4) Sa vision de l'Europe et de la politique est fondamentalement technocratique. Il s'est, en effet, prononcé lors d'une réunion devant les banquiers européens centraux pour un instance européenne ayant autorité sur les budgets des pays européens, autorité qui soit indépendante, au même titre que la BCE (banque centrale européenne), vis-à-vis de la politique des états partenaires de l'UE ainsi que du parlement européen. Or ce dont précisément souffre la politique européenne, c'est de déficit démocratique, une telle position ne peut que renforcer ce déficit et donc l'euroscepticisme et le nationalisme qui en sont les conséquences. Son échec en 2005 lors du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE) aurait dû lui servir de leçon et surtout nous servir de leçon. Je constate que ce n'est toujours pas le cas.
Si nombre de militants et de sympathisants, mais aussi d'élus du PS, sur la foi de sondages qui ne sont en rien des pronostics, soutiennent le candidature de DSK, c'est qu'ils semblent croire que les sondages sont et font la politique, alors que cela a été démenti par la plupart des élections présidentielles dans le passé, à commencer pas celle de Mitterrand en 1988. Ce faisant ces personnes renoncent à faire de la politique sur les enjeux essentiels, ce qui est un comble pour qui se réclament des valeurs de gauche. Je demande -et ferai tout pour cela- à tout électeur de gauche, quelle que soit son intention de vote au premier tour et qui a le droit de voter dans les primaires organisées par le PS, de participer à la désignation de celui qui leur semble le ou la meilleur(e) candidat(e), au deuxième tour, pour non pas seulement faire gagner le PS en tant que parti, mais le gauche toute entière, alliée avec les républicains démocrates de notre pays.. On l'aura compris, DSK est, selon mon analyse, très loin d'être la meilleur candidat pour faire gagner la gauche, dès lors qu'il s' obligera et nous obligera à faire le grand écart entre le programme du FMI et celui de la gauche, sauf à remettre radicalement en question son engagement au FMI, ce qui ferait de sa supposée compétence politique confondue avec celle de gestionnaire libéral de l'économie, un simple effet d'image, à géométrie aussi variable que contradictoire.
La démocratie peut-elle être anti-capitaliste ?
Suite à l'article : Le capitalisme peut-il être moral ?
Pour certains, disons de la gauche extrême ou révolutionnaire (du moins en paroles), la démocratie, du fait des inégalités en tous genre générées par la capitalisme comme système d'exploitation de la force de travail au profit des investisseurs, ne peut être compatible avec la démocratie et cela d'autant moins que dans un tel système celle-ci est instrumentalisée, voire détournée et donc trahie, au service de ceux qui ont les moyens capitalistiques et intellectuels et les instruments de propagande idéologiques, de manipuler les électeurs à leur profit, celui des possédants exploiteurs et leurs valets médiatiques. Pour d'autres, la démocratie suppose la liberté individuelle d'entreprendre, voire de s'enrichir par l'épargne, le travail et l'investissement. Elle suppose donc le refus de toutes interventions de l'état dans les relations d'échange économique autres que celles qui sont indispensable à un ordre libéral pacifié, sinon pacifique. La démocratie serait capitaliste ou ne serait qu'une dictature plus ou moins totalitaire par la fusion du pouvoir économique exorbitant conféré à l'état et une politique, même majoritaire, contraire au droit libéral. Examinons cette opposition pour nous demander si elle est indépassable, comme, des deux bords, on tente de nous en convaincre.
Le capitalisme contre la démocratie.
La démocratie par définition, est fondée sur l'idéal de l'égalité des citoyens (Tocqueville. Elle. se doit d'être sur le plan économique et social le correcteur des inégalités que génère le capitalisme, sauf à disparaître dans une crise politique profonde en apparaissant ouvertement comme au service du capital au mépris de la majorité des citoyens. Elle doit par la redistribution, les services publics de base gratuits (éducation, santé, transports publics, information)) donner, dans le domaine économique et social, à tous les citoyens les moyens de vivre l'égalité des chances et des droits fondamentaux, dont le droit au travail et à la dignité qui sont indissociables du respect des droits de chacun dont celui du droit du et au travail. Celui-ci inclut le droit des salariés à faire usage du droit de grève pour obtenir celui de négocier sur les salaires, les conditions de travail et les licenciements, éventuels, en position plus égalitaire avec ceux qui les emploient . Ainsi, dans les pays du Nord de l'Europe, au moins dans les grandes entreprises, le droit des employés et salariés participer à la direction de leur entreprise capitaliste (cogestion) est affirmé, ce qui met en cause la logique fondamentale de du capitalisme en particulier financier qui tend à devenir dominant dans le monde. La règle d'or du capitalisme financier mondialisé est en effet celle de "la socialisation des pertes et de la privatisation des profits". Dès lors que les grandes banques et autres institutions financières lorsqu'elles n'échappent pas à tout pouvoir de sanction dans les paradis fiscaux peuvent exiger des états et donc de l'impôt et des citoyens d'être sauvées de la faillite, sauf à mettre toute l'économie par terre, elles disposent sur les états et les populations d'un pouvoir presque sans limites. Un tel pouvoir est, par nature, anti-démocratique et, sous le couvert mensonger de la liberté d'entreprendre, prend en otage la démocratie pour la vider et la détourner de se son sens au service de d'une dictature de fait des marchés, comme on dit improprement, alors qu'il s'agit de celle de ceux qui détiennent les capitaux contre ceux qu'ils emploient. En cela la démocratie est anti-capitaliste ou n'est qu'une illusion trompeuse qui ne se pare de son nom que pour mieux l'annihiler.
La démocratie est capitaliste ou n'est pas :
Or toute l'expérience historique des ex-pays socialistes montrent que le refus de la propriété des biens de productions et d'échange et du marché comme régulateur, même très inégalitaire des relations entre l'offre et la demande, tend à être inefficace d'une part, et ,d'autre part et surtout, substitue à une injustice négociable par la démocratie une dictature de fait au profit, plus ou moins exclusif de ceux qui prétendent gérer au nom de l'état et de l'intérêt prétendu général dont ils s'attribuent le monopole de la représentation au nom du peuple supposé uni contre le capitalisme, sur l'ensemble des individus. Toute tentative de socialiser l'ensemble de l'économie et des relations de production et d'échange aboutit nécessairement à leur étatisation administrative et à la concentration du capital et du pouvoir de décision politique entre les mains du parti et de ceux qui administrent politiquement le capital soi-disant socialisé. Cette concentration a fait la preuve de son échec économique et politique et à travers elle, a substitué au capitalisme fractionné un capitalisme d'état encore plus liberticide et anti-démocratique, voire totalitaire et sanglant, que ce dernier, du fait même de cette concentration. Tout pouvoir corrompt et le pouvoir qui fusionne la politique et l'économie est sans limite et donc est encore plus corrupteur. Cela est vrai du capitalisme lorsque cette fusion opère par le jeu apparent de la démocratie formelle, mais encore plus lorsque la politique s'empare de l'économie sous la forme de la dictature d'un parti unique incontestable.
Vers un capitalisme limité par la démocratie.
Si
la démocratie n'a pas être anti-capitaliste, c'est à dire à prétendre
abolir le capitalisme et l'économie de marché, elle doit s'efforcer de
séparer le pouvoir politique et le pouvoir économique comme elle doit
traditionnellement séparer, ce qui est toujours compromis, les
autres pouvoirs en particulier judiciaire et politique .Cette
séparation est la condition d'une démocratie vivante et alternante et
la tension entre les deux sphères du capitalisme et de la politique
démocratique est au cœur de la possibilité des libertés et des droits
individuels et collectifs des salariés. Or cette séparation et ces
derniers droits sont aussi la condition nécessaire de la légitimité
politique du capitalisme et donc de sa pérennité à long terme, car
celui-ci a besoin de faire croire qu'il est au service de tous, au
moins en apparence et, si possible, plus ou moins en réalité (c'est à
la vie démocratique d'en décider concrètement). Un capitalisme
démocratisé, à savoir civilisé et régulé par la politique, qui
doit, pour ce faire, séparer les domaines de la politique et de
l'économie peut seul être libéral , pluraliste et démocratique. La
tension permanente entre le capitalisme et la démocratie est donc à la
fois indépassable et indispensable à la vie politique. Cette tension
est au coeur du débat entre la gauche et la droite sur fond de la lutte
entre le capital et le travail, laquelle détermine la possibilité même
de la vie démocratie, tant au
parlement que dans l'espace public.
De la responsabilité du discours dit populiste dans le massacre norvégie
Définition du populisme: Le populisme est l’idéologie qui prétend opposer la démocratie aux droits de l’homme, condition de la démocratie . En cela il est contradictoire dès lors qu’il tente d’opposer la démocratie électorale (ou majoritaire) à l’idéal fondateur de la démocratie que sont les droits de l’homme. Cette contradiction est celle même que je mets en évidence dans cet article. Toute vision du peuple ou de la majorité qui en fait une puissance absolue hors du respect des droits de l’homme est tyrannique. Une tyrannie majoritaire,n’est pas moins tyrannique : elle donne nécessairement jour au totalitarisme, de droite ou prétendument de gauche ? C’est la leçon historique du XXème siècle.
_______________________________________________________________
Ce que nous savons aujourd'hui sur l'auteur avoué du massacre norvégien nous permet de faire quelques réflexions sur ce passage à l'acte terroriste de la haine fantasmatique entretenue et instrumentalisée par un certain discours populiste xénophobe.
Loin de moi l'idée que le parti populaire norvégien xénophobe soit à l'origine directe de passage à l'acte extrême commis par l'auteur de cet acte : il faut faire la part entre une discours électoral démagogique et la réalité d'un tel massacre qui renvoie certainement à un déséquilibre psycho-affectif profond de son auteur, semble-t-il, unique dans ce cas, bien que cette haine purificatrice et sacrificielle puisse et est de fait partagée par d'autres. Il n' y a donc pas de responsabilité juridique collective de la droite xénophobe dans ce passage à l'acte. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'influence ambivalente , c'est à dire contradictoire, du discours xénophobe sur des personnalités déséquilibrées et/ou fanatiques.
D'un côté un tel discours de haine aveugle contre tous les musulmans au nom d'une identité ethique et/ou religieuse pure est dans le cadre formel de la démocratie en vue de la compétition électorale un moyen de capter et donc de détourner la violence raciste vers les conditions pacifiques de la compétition électorale. D'un autre côté il nourrit les fantasmes ethniques fanatiques et haineux d'un renversement de la démocratie pluraliste et tolérante universaliste au profit d'un régime plus ou moins formellement démocratique, mais communautariste, voire raciste. Ce qui est une contradiction absolue.
Cette contradiction affecte particulièrement le psychisme des individus fanatiques déséquilibrés qui succombent à ces fantasmes : il peuvent constater que les discours xénophobes sont sans effets suffisamment radicaux, au regard de leur fantasme de pureté ethnique, sur les décisions politiques des gouvernants, soit perçue que le populisme (la démocratie contre les droits de l'homme) ne parvient pas au pouvoir et reste minoritaire électoralement, soit qu'il participe avec d'autres forces de droite à un gouvernement qui se trouve incapable d'aller au bout de l'option xénophobe (dépoter voire éliminer les étrangers) dans un cadre démocratique, constitutionnel et/ou européen qui lui interdit une telle radicalisation dans la réalité.
Cet écart entre le fantasme et la réalité du discours et de la pratique de la xénophobie extrême devient insupportable au fanatique, car il menace directement la valeur qu'il donne à ces fantasmes qui lui collent à la peau, au point de s'y identifier, à savoir de faire sans distance possible du la valorisation absolue de ce fantasme de la pureté raciale et ethnique le fondement de la valeur qu'il s'attribue à ses yeux et à ceux des autres. Cette menace l'engage donc à briser le cadre de la démocratie formelle, toujours plus ou moins pacificateur et pluraliste (donc impur), par un acte de violence extrême, seul à même de se valoriser aux yeux de ceux auxquels il croit s'identifier, les nationalistes, et de faire de son acte hyper-violent assumé un acte héroïque, propre à servir d'exemple sacrificiel à tous ceux qui partagent sa xénophobie . Celle-ci, ne l'oublions pas, est une réaction compensatrice au sentiment de ne plus maitriser sa vie personnelle et collective en un monde ou sociétés complexes et ouverts. Elle est de ce fait la réaction passionnelle spontanée et séduisante d'une collectivité qui se vit comme tout à la fois impossible et impuissante. Impossible car impuissante.
C'est dire que les forces politiques qui s'emploient à faire un usage électoralement plus ou moins efficace des discours xénophobes ne savent pas, car elles ne veulent pas savoir, le risque extrême qu'elles prennent, tout en étant conscientes de leur incapacité à les mettre en pratique dans un cadre démocratique qu'elles refusent de renverser formellement. Leur responsabilité vis-à-vis de ce massacre est d'influence et n'est pas juridique, mais elle fait de leur irresponsabilité politique quant aux conséquences violentes de leurs mots d'ordre, une cause indirecte, mais indéniable, de leur responsabilité politique.
L’abandon des charges contre DSK : un déni de justice !
Dans le rapport du procureur Cyrus Vance se trouvent des éléments à charge, y compris objectifs, et à décharge (crédibilité de la présumée ) vis-à-vis du présumé innocent DSK, mais il conclut paradoxalement à la levée de toutes les charges contre ce dernier Or ce rapport, à mes yeux, et selon le droit français justifierait un procès loyal et contradictoire devant un jury en France...
Démonstration :
Les indices objectifs du rapport sont accablants pour DSK même si ce rapport minimise l'expertise médicale qui conclut, elle, à un viol et s'il fait l'impasse totale sur l'état de choc, dûment constaté, après le viol présumé qui, à lui seul, selon tous les spécialistes des états de choc, suffit à expliquer les variations de mémoire sur l'après événement, alors que sur le déroulement de l'agression présumée le témoignage de la plaignante n'a pas varié . Le rapport porte les preuves d'une relation sexuelle précipitée (6 minutes) qu'il renonce à qualifier de viol.
Ce renoncement est justifié par les prétendus mensonges de la plaignante concernant en particulier son comportement à la suite des faits.Tout l'abandon des charges demandé repose en effet dans ce rapport sur les prétendus mensonges de la plaignante sans rapport avec ce présumé viol et sur ses erreurs de mémoire à propos de son comportement à suite de ce dernier. Mais chacun sait que dans un état de choc une mémorisation très précise serait précisément le signe d'une absence de choc et donc de viol. Or transformer ces erreurs de mémoire en mensonge tel est le tour de passe passe rhétorique et hypocrite pour disqualifier la parole de la présumée victime et lui interdire un procès équitable.
La preuve de l’innocence de l'accusé présumé n'est pas apportée au terme d' un procès dans lequel chacun devrait et en particulier DSK aurait à donner sa version des faits. Celui-ci n'est donc pas blanchi comme le prétendent nombre de ses amis. Il bénéficie d'un non lieu pénal qui ouvre de fait la porte, aux USA, à un procès civil. Il est permis de se demander si ce n'est pas là la vraie raison de l'attitude du procureur : passer la main au civil pour ne pas :
- soit se rendre responsable d'un échec devant un jury lequel devrait être unanime pourdécider de la culpabilité de DSK, ce qui semble impossible aux dires du procureur.
- soit pour le motif plus politique et moins avouable encore de ne pas maintenir un tel personnage politique français en prison aux USA.
L'absence de procès en l'occurrence apparait donc comme un faux fuyant juridique et ne garantit en rien l'innocence de DSK qu'il ne faut pas confondre avec la simple présomption d'innocence qui ne concerne que le déroulement de la procédure.. La présomption d'innocence dont certains se targuent pour déclarer fallacieusement DSK définitivement innocenté est, il est bon de la rappeler, le fait de l'institution judiciaire tant que le procès n'est pas clos. Or il n'y aura préciséement pas de procès pénal. Ce qui veut dire que, hors tout jugement juridique sur les faits, chacun a le droit à son intime conviction et à l'exprimer
Le droit au procès est un droit de l'homme ; il incarne le droit d'avoir des droits et de les faire valoir dans le cadre d'une procédure équitable et contradictoire. Il a été refusé à la plaignante. La décision du procureur et du juge est donc un déni de l'idée justice.
3 questions "innocentes" pour terminer :
Qu'est ce qu'un rapport sexuel précipité non tarifié et non-violent que la victime estime non consenti ? On sait, en effet, que tout violeur présumé prétend toujours que sa victime était consentante.
Est-ce à l'accusé d'estimer le consentement de la plaignante et contre son avis ?
DSK et ses avocats n'ont ils pas menti en prétendant, au départ, qu'il n'y avait eu aucun rapport sexuel ?
Genre et sexualité : tout est en branle !
La droite dite populaire a tenté récemment une manœuvre politico- idéologique (pétition parlementaire qui, depuis, semble avoir fait long feu, y compris auprès du pouvoir sarkosiste,) afin de s'opposer à une avancée scientifique majeure que les ouvrages scolaires des sciences de la vie et de la terre ont relayée récemment, à savoir que la sexualité vécue n'est pas réductible au sexe biologique , ni même au genre sociétal et sémantique, mais qu'elle est relative à l'histoire complexe des personnes entre biologie, société et expérience personnelle, bref que chacun ne nait pas sexuellement homme ou femme du point de vue de sa sexualité vécue, mais qu'il (elle) le devient .
Il s'agit là d'un constat sur les faits et non d'une opinion ou croyance et encore moins d'une considération morale , sauf pour qui prétendrait réduire la réalité humaine à des caractéristiques de naissance dûment essentialisées en genres et rôles sociaux pré-définis -et donc figés à vie- par une vision morale traditionnelle collective de la sexualisation vécue des individus. Cette prise de position vise à soumettre ceux-ci à un ordre moral traditionaliste intangible, au mépris de leurs réel désirs et à l'encontre du droit libéral de la sexualité inscrit dans les droits humains fondamentaux qui affirme que toute relation sexuelle dans la vie privée, voire intime, entre des adultes consentants, est et doit être considérée comme autorisée sans discrimination hiérarchisée entre les formes de sexualité. Il convient pour sortir du brouillard idéologique de cette vision traditionaliste et pour la mettre en cause de se poser la question : qu'en est-il, réellement et conceptuellement pour qui cherche à connaître la réalité, de la relation entre sexe biologique genre social et sexualité vécue ?
Le genre est une construction sociale et culturelle qui rend compte ou pré-définit, dans les sociétés traditionnelles (et toutes le sont peu ou prou), les rôles plus ou moins figés, de la femme et de l’homme comme masculin et féminin.
Notre société dite libérale qui promeut l’égalité des droits fondamentaux entre les individus hommes ou femmes met en cause ce modèle symbolique et donc la notion de genre comme marqueur identitaire et social. Toute discrimination sexuelle dans l'accès aux métiers et fonctions politiques et sociales est abolie, au point que le différence entre les femmes mariées et les femme primo-célibataires est contestée, voire supprimée dans nombre de pays occidentaux, alors qu'elle n'a jamais existé pour les hommes. Qu'en est-il du sexe dans son rapport au genre ?
Le sexe est d’abord une caractéristique biologique et sa détermination relève de la génétique donc des sciences biologiques ; en ce sens on ne devient pas, pas plus que les animaux, chromosomiquement mâle ou femelle, on l'est dès la naissance, mais chez les humains, voire chez certains animaux dits supérieurs, cette caractéristique biologique ne détermine pas nécessairement une sexualité hétérosexuelle et ne fonde pas une normalité morale privilégiant celle-ci. Affirmer que la sexualité n’est pas seulement biologique et que sa construction est aussi sociale et psychologique est un fait scientifique démontré . Le sexualité vécue d'un individu est le résultat d'une expérience et/ou d'une histoire personnelle dont le sexe biologique ne définit qu'une norme comportementale statistique qui du reste varie selon les cultures, et non pas morale, dès lors qu'elle peut être contredite sans dommage pour les dits hétérosexuels. En cela un(e) dit(e) homosexuel (lelle) n’est pas biologiquement différent(e) d’un(e) dit(e) hétérosexuel(lelle) et donc n’a pas à être considéré(e) comme déficient (e) biologiquement et encore moins comme pervers(e) moralement, sauf dans le cadre d’une idéologie moralisante qui biologise la morale, en cela qu’elle prétend réduire à la seule sexualité biologique, les comportements sexuels, affirmation particulièrement absurde en ce concerne l'espèce humaine
Ainsi, Derrière la dénonciation de cet énoncé scientifique que la construction de la sexualité est un fait complexe, se manifeste un vision normative et moralisatrice, voire liberticide de la sexualité d’origine traditionnelle et religieuse qui, de fait, confond genre, sexe biologique et sexualité vécue. Cette vision idéologique refuse, par cette confusion, toute évolution qui autoriserait à considérer que toutes les formes de sexualité non-violentes sont, en droit et en fait, légitimes.
Elle est donc tout à la fois anti-scientifique et anti-libérale...
Mais derrière cette vision, pour le moins obscurantiste (à savoir qui refuse l'examen scientifique des faits au nom de la religion et/ou de la tradition), se manifeste le désir de refuser l'homosexualité comme une forme légitime de sexualité. Il convient donc de s'intéresser à ce que l'on appelle l'homosexualité, en répondant à trois questions .
1) Un homosexuel est-il biologiquement si différent d'un hétérosexuel ? :
Si la réponse est non , la sexualité vécue ne se réduit donc pas au sexe génétique, la thèse naturaliste qui prétendrait confondre sexe biologique et sexualité vécue est alors rationnellement (ou logiquement) fausse
2) La prétendue 'homosexualité est-elle une déviance contre nature et/ou une maladie ?
Là encore, la réponse est non, car la nature ne définit pas de normes morales ou juridique. Et si un homosexuel ne souffre pas et ne fait pas souffrir ses partenaires il n'est pas malade et n'a pas à être déclaré tel par la médecine et l'état.
3) Le dit homosexuel est-il moins hétérosexuel que le dit hétérosexuel ?
Dans
ce cas, la réponse est plus difficile, car en vérité personne, dans son
vécu, n'est homosexuel car chacun vit sa sexualité différemment et donc
tout couple est hétérosexuel, même les couples dits homosexuels et
parois ont tanbdance à r eproduire les rôles (en) gendrés par la
culture.
4) la prétendue homosexualité est-elle condamnée ou condamnable dans toutes les cultures ?
La
réponse est non : Pour qui a étudié les classiques et l'histoire
de l'antiquité le savent. Seules certaines religions, le plus souvent
monothéistes, condamnent la dite homosexualité au nom de leur théorie
des genres naturels et divins ; ce qui na rien à voir avec la
biologie scientifique mais tout avec leur idéologie religieuse .
C'est pourquoi nombre de religions traditionnelles refusent la liberté et l'égalité sexuelles et ce qu'elles appellent la « confusion des genres », en tant que marqueur pertinent d'une société authentiquement libérale et démocratique.
Parler de sexualité « naturelle » est donc erroné et mystificateur :
La nature a, en effet, bon dos : on y trouve toujours ce que l'on cherche à justifier, tout et son contraire. Or la Nature, contrairement à ce qu'affirme ceux qui en font une création divinement ordonnée, ne connait ni la morale, ni l'interdit.
La preuve ne est que si la sexualité vécue était seulement déterminée par la biologie et donc seulement naturelle , il n'y aurait pas besoin de règles de morale pour en assurer le contrôle social et le désir sexuel non reproductif, n'existerait tout simplement pas
En effet, la sexualité ne se résume pas à la reproduction, ni chez les bonobos, ni chez les humains etc..
Ainsi, La position théologico-naturaliste s'auto-détruit logiquement dès lors qu'elle prétend absurdement interdire ce que la nature, selon eux, ne permet pas ou est sensée rendre impossible...Si l'homosexualité était anti-naturelle il n' y aurait nul besoin de l'interdire par la religion et/ou la morale traditionnelle anti-libérale !
La position des promoteurs de la confusion entre le sexe, le genre et la sexualité vécue a donc une apparence scientifique mais elle est réellement scientiste et métaphysique. Elle vise, comme toujours, à refuser la liberté individuelle et la démocratie comme normes des relation humaines pour les soumettre à un ordre et à un pouvoir supérieur incontestable ou sacré.
L'oubli de la pensée de Marx est paradoxal : jamais sa vision des contradictions du capitalisme n' a été autant validée par l'actualité et portant très peu de commentateurs, même parmi les plus éclairants, n'y font plus référence, comme si le désastre des ex-pays prétendument socialistes et réellement totalitaires avait disqualifié une pensée dont ces régimes étaient pourtant la trahison mortelle.
La crise actuelle du capitalisme, en effet, met en cause, à l'évidence, le système capitaliste dans son fondement même, à savoir la recherche sans limite du profit par l'exploitation forcenée des forces productives et des ressources naturelles, la spoliation financière appelée par euphémisme spéculation. C'est préciséemnet cela qui était au cœur même des analyses de Marx dans le Capital. D'où les deux questions :
Quels sont les points de la critique que fait Marx fait du capitalisme qui nous permettent de comprendre la crise, y compris morale et politique, dans laquelle nous nous enfonçons. ? Et pourquoi cette critique ne suffit pas à penser une sortie révolutionnaire crédible à celle-ci, voire en quoi l'idée même d'une révolution post-capitaliste, sauf dérive totalitaire anti-libérale sur le plan économique et social et antidémocratique sur le plan politique, est-elle impensable ?
Rappelons schématiquement, les critiques que Marx fait du capitalisme développé pour en justifier l'actualité face à la crise actuelle. Marx considère :
qu'il est un système qui , sauf par l'innovation et par le monopole, voire par le monopole de l'innovation, mais qui ne sont plus aujourd'hui possibles aujourd'hui , tend à la réduction du taux de profit du fait de la concurrence aujourd'hui mondialisée.
que la baisse du taux de profit provoque, pour préserver les profits la hausse tendancielle du taux d'exploitation par la baisse des salaires moyens, par la délocalisation de la production et même de la recherche et développement en des régions du monde où le coût de la force de travail est plus bas, par la précarisation de l'emploi et le chômage de masse
que cette baisse du taux de profit (retour sur investissement) tend elle-même à faire passer la spéculation financière de l'économie casino mondialisée et le crédit comme une source de profit autonome prédatrice de l'économie productrice de réelles richesses
que le crédit, via le gonflement de la bulle financière généré par cette économie financière spéculative, tend à maintenir les profits à très court terme, mais s'avère catastrophique à long terme, dès lors que les salariés ne pourront plus rembourser les crédits et payer les intérêts afférents, ce qui remet en cause l'équilibre de l'offre et de la demande, du fait de l'augmentation du taux d'exploitation. Les marchandises produites ne trouvent plus assez de preneurs solvables sur le marché mondial, sauf à accroitre le coût de la force de travail et les salaires dans les pays dits émergeant, ce qui fera à nouveau baisser le taux d'exploitation et donc le taux de profit moyen. C'est la fameuse contradiction -centrale dans le pensée critique du capitalisme de Marx - entre le niveau de productivité des forces productives toujours plus coûteuses en investissements et les rapports sociaux de production. Cette contradiction entrainant un chômage endémique élevé, facteur croissant d'exclusion du marché de l'emploi et donc du marché tout court, génère une tendance à la surproduction dans l'économie réelle compensée à court terme par l'économie financière spéculative au prix d'une catastrophe systémique bancaire et financière, mais aussi économique dont les états eux-même seront les victimes, dès lors que les dettes privées individuelles et bancaires et les dettes publiques sont ou tendent à devenir, une seule et même dette généralisée.
En ce sens toutes ces analyses critiques que fait Marx du capitalisme sont confirmées et tous les commentateurs critiques du capitalisme et de la crise ne font rien d'autres que de reprendre à leur compte tels ou tels éléments de cette critique, sans le dire. Il semble bien que ce silence soit l'effet de l'effondrement des prophéties de Marx sur la fin nécessaire du capitalisme qui semble la suite de l'échec des régimes monstrueux, ou prétendument socialistes réels, qui se sont réclamés du dépassement du capitalisme pour justifier la destruction des droits et des libertés par la répression sans limite des oppositions à la dictature de la bureaucratie d'état.
Ce sont les pronostics révolutionnaires de Marx qui sont au fondement des limites de sa pensée. Quels sont-ils ? En quoi reposent-t-il sur des croyances illusoires, voire mythiques ?
Plusieurs croyances non réfléchies par Marx, sauf en quelques analyses historiques dont il ne tire aucunes conséquences générales ont nourri le marxisme politique en son temps et après lui, marxisme qui lui ont fait dire à la fin de sa vie, en un ultime sursaut de lucidité, que « tout ce qu'il savait c'est qu'il n'était pas marxiste »...
sa croyance en l'automaticité d'une révolution prolétarienne qui mettrait à bas les droits de l'homme et la démocratie qualifiés de bourgeois pour faire place à un socialisme transitoire, sous la forme de la dictature temporaire du prolétariat, et au communisme instaurant l'égalité sociale et les libertés individuelles intégrales, sans un état ou instance de pouvoir politique de domination de l'homme par l'homme,.Tout état pour Marx en effet ne peut être qu'une dictature d'une classe sur une autre. Le fin des classes entrainerait, selon lui, le fin de la lutte des classes et donc le dépérissement de l'état au profit d'une simple administration technique et rationnelle des biens et des services distribuant à chacun selon ses besoins.
son espoir en une révolution mondiale qui impliquerait une solidarité de classe de tous les exploités sur la planète faisant fi des différences nationales et religieuses, voire des intérêts divergents, le plus souvent vécus comme contradictoires, des différentes populations du monde et des différentes couches sociales et populations à l'intérieur qui ne peuvent pas être réduites et que l'histoire n'a pas réduite, au contraire de ce qu'il le pensait, en deux classes conscientes de soi aux intérêts et valeurs clairement antagonistes et inconciliables.
la croyance que la politique et l'économie serait toujours et partout convergentes dans le sens révolutionnaire souhaité par lui, alors que le nationalisme idéologique et/ou le communautarisme religieux et les unions sacrées entre les classes qu'ils génèrent font que cette convergence n'a rien d'automatique, mais qu'elle est généralement, pour le moins, spontanément impossible. Il a méconnu ainsi la puissance fusionnelle et identitaires des mythes idéologiques, aujourd'hui relayés pas le consumérisme exacerbé par l'idéologie dominante du bonheur « commercial » individualiste (les hypermarchés, dimanches compris débordent de clients pendant que les églises se vident), sur la conscience des exploités et des dominés le plus souvent endettés, qui va le plus souvent à l'encontre de la conscience de soi unificatrice de la libération révolutionnaire pour laquelle il militait. Et cela s'est fait, en effet, au prix du développement quasi-illimité du crédit donc de la dette qu'elle soit privée ou publique (c'est la même), d'où la crise financière dans la quelle nous sommes. L'oubli de l'idéologie et de la conscience désirante des hommes, comme facteurs d'illusions et comme forces motrices autonomes de l'histoire par rapport aux rapports de production et/ou de classes, est au centre de la dérive dite marxiste, lequel oubli, dénié, a fait un retour pathologique dans la propagande politique monolytique par le parti unique au pouvoir absolu, de forme quasi-religieuse la plus exacerbée, dans les pays totalitaires prétendument marxistes, où toute déviance, à défaut de pouvoir utiliser la menace de l'enfer et la promesse du paradis dans l'au-delà, était interdite et réprimée par le sang et le goulag,.
la croyance que le développement infini des forces productives induira un socialisme et une économie automatiquement respectueux des conditions écologiques nécessaires et durables à la vie pacifique dans le monde. La crise écologique, le réchauffement climatique et les catastrophes que les sciences de l'environnement nous annoncent nous rappellent que tout doit être fait pour que ce progrès soit contrôlé à l'échelon mondial, afin qu'ils ne conduisent pas tout simplement à la violence extrêmes entre populations pour l'accès aux ressources primaires que sont la terre, l'eau, la mer, l'énergie, l'air etc, sans parler des ressources secondes. Un telle destruction de l'environnement, une telle violence guerrière ou terroriste, à l'époque des armes de destructions massives disséminées, pourrait, au bout du compte, déboucher sur l'auto-destruction de notre espèce. Penser que socialisme et écologie sont indissociables est une erreur anthropologique fondamentale , c'est méconnaitre le désir de chacun comme concurrentiel au désir des autres, lequel en tant qu'amour comparatif et compétitif de soi, est au cœur des motivations humaines individuelles et collectives. Individualisme personnel ou collectif et liberté sont indissociables et rien ne peut rendre nécessaire la sagesse qu'exige le respect des équilibres écologiques et de l'homme par l'homme ; sinon la conscience politique et l'éducation citoyenne. L'individu n'est pas spontanément écologue. Il ne peut le devenir que s'il prend conscience dans le malheur et le désastre des limites du progrès et de ce que l'on appelle la croissance, dans la logique inégalitaire du profit privé. Si ce n'est pas une régulation du capitalisme qui rendra efficace le souci écologique, c'est la catastrophe écologique qui rendra universellement désirable, sauf suicide généralisé, cette régulation. La peur est et sera le seul régulateur en dernière instance de l'hybris suicidaire du désir spontanément infini.
Nous en sommes aujourd'hui à tenter de penser d'une manière critique une crise systémique du capitalisme globalisé avec les termes de Marx qui sont, dans leur généralité, économiquement confirmés, mais sans pouvoir présenter une alternative autre que celle de la démocratie formelle et des droits des hommes individuels et sociaux comme universels en droit et de la nécessaire contrainte écologique vis-à-vis du développement économique. Cette vision ne peut prétendre dépasser ou mettre fin au capitalisme et à l'économie de marché qui est spontanément tournée le satisfaction illimité des désirs qu'elle stimule et produit en permanence, sur la base du seul profit privé et de l'exploitation de l'homme par l'homme et dont la puissance, aujourd'hui sans visage (la loi des marchés financiers) est telle qu'elle semble échapper à toute régulation politique par les états et des instituions internationales plus ou moins démocratiques. Ce que l'on appelle la voie réformiste ou la régulation du capitalisme, devenu anonyme et donc irresponsable et donc destructeur des sociétés et de la confiance minimale économique et sociale sans laquelle il ne peut lui-même se maintenir est alors, à la fois, la plus problématique et la seule possible.
Restaurer la conscience politique et le combat démocratiques et la confiance dans la politique pour la vie et l'égalité à l'échelon mondial , au delà de toute forme de nationalisme, est donc la seule voie permise. Elle est pour le moins précaire et surtout elle représente un défi qui peut être facilement perdu pour faire face au désastre généralisé à l'heure des armes de destruction massives et de l'énergie atomique, à savoir la fin « l'humanité », terme à prendre dans les deux sens, biologique et éthique.
Le capitalisme, livré à lui-même, sans contre-feux politiques, est ce qu'il est : le triomphe de la cupidité c'est à dire de la libre expression du désir de s'affirmer face au monde et les autres et à leurs dépens. C'est à la politique non pas de le rendre moral mais moins immoral dans ses effets sur les sociétés et les individus. Le justice , la, paix civile et les biens publics relèvent de la politique démocratique et/ou de ce qu'il en reste et de rien d'autre.
C'est pourquoi il nous faut défendre et élargir les conquêtes des droits démocratiques et sociaux et qu'il nous faut combattre le prétendu néo-libéralisme qui n'est que le faux-nez de la dictature sans partage du capital financier sur et aux dépens de la production de biens et de services réels pour tous.
Une "Jeunesse du sacré" (bien dissipée), de Régis Debray (Gallimard)
Il y a chez R. Debray du Nietzsche dont on ne sait s'ils nient ou s'ils affirment le sacré comme une valeur sacrée, s'ils sont nihilistes ou refondateurs de nouvelles valeurs qui pourraient s'incarner dans un retour du sacré rendu à sa jeunesse perdue et/ou re-sacralisé en une nouvelle jeunesse.
Ce qui fait précisément le force du texte que publie R. Debray :
"Jeunesse du sacré" chez Gallimard, c'est cette ambivalence entre la
description, semble-t-il irréversible, de la déshérence du sacré dans
nos sociétés dites libérales et sa dissipation en des sacralisations
plus ou moins festives et symboliques dé-religiosisées et la position
qui est la sienne que la sacré est une nécessité sociétale et politique
toujours renaissante pour faire lien et communauté. Qu'on en juge :
Le sacré s'entend en un double sens, apparemment antinomique :
1) Ce qui est tabou donc intouchable, sauf à se rendre impur et méprisable.
Ce qu'il serait sacrilège de révérer (cf le sacrum).
2) Ce qui est considéré comme ayant une valeur indiscutable et doit
donc être révéré sans conditions à travers des rituels collectifs de
soumission et d'adoration, voire de communion, qui excluent ceux qui
commettent des sacrilèges et/ou le conteste, dès lors qu'ils ne font pas
partie des purs, des pieux, des adorateurs patentés (par exemple les
hommes, les prêtres à l'exclusion des femmes ou des mécréants)
Ces deux sens sont indissociables en cela qu'ils clôturent l'espace
pour se protéger soi et les proches de toute impureté ou souillure
externe, les autres, les étrangers nécessairement hostiles, en cela que
ceux-ci sont un danger permanent de perte d'identité pour la communauté
toute entière. Le sacré est le ciment idéel, mais incarné en un lieu et
des rituels ou cultes déterminés, de l'indéfectible unité de celle-ci.
Il se veut intemporel, c'est à dire éternel. Cette exclusion spatiale se
marque par des frontières en trois dimensions, le hauteur étant souvent
la marque hiérarchique de l'éminence du lieu, de la personne ou de
l'objet fétichisés sacralisés. Le sacré s'affirme comme le contraire de
l'utopie que serait, par exemple une référence désincarnée à des valeurs
universelles, qu'elles soient religieuses ou laïques. Le sacré est
alors le contraire de la raison critique raisonnante des modernes, de la
liberté de croire et de ne pas croire. En cela il est populaire, voire
populiste car il abolit les différences dans la communauté pour la faire
régner sans partage, ni contestation, donc sans conditions, sur les
individus, sur leurs comportements plus encore que sur leurs croyances .
Il est la face plus ou moins obscurantiste de la justification du vivre
ensemble et de sa perpétuation sous la forme de la tradition dont
l'autorité se fonde sur un passé mythique en permanence recomposé.
Dans son second sens, aujourd'hui affirmé dans et par l'oubli apparent
du premier, le sacré fait du sacrilège ou de la profanation un interdit
absolu. Il exige donc, pour instaurer son règne, le sacrifice des impurs
et de soi au service de son maintien indéfectible. Il est guerrier en
externe mais pacificateur en interne. Disons même que la guerre lui est
nécessaire pour s'établir comme ciment communautaire et faire cesser les
formes de la rivalité mimétique les plus violentes et les plus
destructrices de l'ordre social (R. Girard). Si le sacré n'est pas
forcément religieux toute religion est nécessairement sacrée dès lors
qu'elle a besoin de poser des interdits ou des obligations et cérémonies
rituelles collectives fusionnelles. Mais R.Debray -et c'est la thèse
centrale, me semble-t-il, de son ouvrage- ajoute que le fin de la
domination de la religion sur et dans la politique sous le principe de
la laïcité n'a pas fait disparaître le sacré mais l'a liquéfié ou
pulvérisé dans un foule de manifestations à changements rapides (ce qui
va à l'encontre de l'éternité du sacré) , qui vont des grands
rassemblements politiques et culturels (cf le sport, la musique), des
rituels de respect dû aux institutions, des obligations mémorielles de
toute nature plus aujourd'hui tournées, démocratie oblige, vers les
victimes de l'histoire que vers l'hommage aux vainqueurs et aux grands
hommes.
Cette prolifération, dans sa multiplicité conflictuelle à tendance
communautariste, met en cause l'unité de la chose publique, à savoir le
politique, dès lors que rien ne peut plus faire consensus pour assurer
la fusion de l'ensemble de la société, en l'absence de perspective de
guerre qui permettrait de refonder l'union sacrée de tous contre un
ennemi commun clairement identifié, dans le cadre européen en
particulier qui a exclu la possibilité traditionnelle de la guerre en
son sein. Or cette absence de perspective guerrière n'est pas seulement
donnée, mais voulue par les individus qui refusent de se soumettre
aveuglement au collectif, à la patrie, voire à la nation, pourtant
fonction première du sacré. Ils revendiquent le droit de choisir leur
sacré, voire à le bricoler au point de dissoudre sa sacralité dans la
profanation , sans même l'intention de la provoquer, comme c'est souvent
le cas dans l'art contemporain.
Mais cet élargissement vaporeux du sacré dans le libéralisme
démocratique, qu'il décrit avec une grande finesse et une débauche de
références iconographiques concrètes éclairantes, sa dissipation dans la
multiplicité de ses manifestations plus ou moins incompatibles entre
elles, ne va pas sans que se pose la question de savoir en quoi cette
notion loin d'être rajeunie n'est pas en voie de disparition publique,
pour n'être plus qu'une affaire privée, c'est à dire, à terme, en voie
de disparition en tant qu'obligation socialement incontestable. C'est là
que le très brillant et très stimulant ouvrage de R. Debray rencontre
la limite de son exigence de lucidité : si le sacré se dissipe et se
vaporise en comportements infra-politiques contradictoires, l'idée que
l'auteur poursuit, semble-t-il, de la perpétuation d'un sacré, pour ne
pas dire d'une religion, civil et républicain est largement une
illusion. L'auteur ne va pas jusque là, puisqu'il refuse de dissocier la
démocratie et la république c'est à dire de remettre en cause la
soumission de la première à la seconde. Un tel refus peut sembler, à
lire"Jeunesse du sacré", tout aussi respectable que vain. C'est en cela
que cet ouvrage est particulièrement éclairant, car il ouvre
l'intelligence à la possibilité de sa critique. C'est en cela que
R.Debray est un authentique intellectuel de notre temps.
La vraie fausse valeur du travail
Le travail doit d'abord être défini comme une activité productrice de bien et de services dont le but est de satisfaire les besoins et/ou désirs des autres qui ne sont ni des membres de la famille ni des proches, mais peuvent être des inconnus ou des institutions qui sont susceptibles d'acheter ou d'exiger le produit du travail.
En cela le travail se distingue des activités de loisir dont le but est de se satisfaire soi-même et des activités domestiques gratuites qui concernent la famille et les proches. Le travail est donc une activité soumise (ce que signifie par exemple le notion d'emploi qui veut dire « être ployé sous la volonté d'un autre ») plus ou moins pénible ou contraignante ce qui justifie que son produit soit rétribué par un dédommagement monétaire ou socialement récompensé sous une forme ou une autre
La forme la plus extrême du travail, en terme de contrainte, est le travail de l'esclave , lequel esclave ne doit sa survie qu'en tant qu'il est la propriété de son maître et lui est soumis sans conditions. La forme la plus douce est celle du travail dit indépendant qui est rétribué sous la forme d'un prix négocié ou négociable de son résultat avec un acheteur ou commanditaire. La forme intermédiaire est celle du travail salarié qui est une activité au service d'un autre contre une rémunération monétaire librement consentie sous la forme d'un contrat de travail qui en spécifie les modalités , les limites et soumises à des droits politiquement et juridiquement définies sous la forme du droit au travail.
En quoi peut-on dire que le travail aurait une « valeur » ? Il faut être clair sur ce point quitte à remettre en question un discours à la mode qui du reste est paradoxal dès lors qu'on assigne au travail un but extérieur à lui : gagner de l'argent. Dire que le travail a une valeur c'est dire qu'il a une utilité une finalité hors de lui-même qui peut être un gain économique et social. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de dire que le travail est une valeur, La valeur-travail signifie que le travail est en lui-même l'expression s'une valeur inhérente qui vaut pour elle-même. Or est une valeur ce qui vaut comme fin universelle de la vie pour soi et les autres. Sauf à considérer que l'argent soit une valeur morale ou éthique et le travail un simple moyen de la mettre en œuvre, il est clair que cette valeur n'a aucune valeur éthique car il ne vaut pas en soi comme fin dernière. De plus il n'est pas nécessairement une liberté dès lors qu'on le soumet à une nécessité vitale en tant que simple moyen. Tout au plus peut-on dire qu'il est un service visant à la coopération sociale générale au bénéfice de ceux qui sont en position de payer ce service, sinon au service de tous. Perdre sa vie pour la gagner ou se soumettre à d'autres pour se libérer tels semblent être les paradoxes du travail comme prétendue valeur.
Le travail est-il une valeur ?
D'une part le travail, comme activité de production et de service soumise à la contrainte sociale, est vécue comme une nécessité vitale pour la grande majorité des individus qui ne peuvent gagner leur vie, c'est à dire leurs moyens de vivre, qu'en travaillant pour d'autres que leurs proches, donc en s'y soumettant plus ou moins volontairement, d'autre part il est un motif de valorisation sociale au point que même dans les professions les plus pénibles, voire les plus dangereuses pour la santé et les plus dégradantes pour l'intégrité humaine des travailleurs transformées en machines inintelligentes à opérer dans un cadre subi, il est revendiqué comme une identité valorisante. Comment comprendre ce paradoxe qui fait d'une nécessité aliénante une valeur morale ?
La notion de valeur est complexe car subjective, ne vaut en effet que ce qui est socialement désirable par un groupe d'individus en fonction de valeurs éthiques plus ou moins contradictoires et donc toujours discutables, voire négociables en chacun et par chacun d'entre eux . Est valeur pour un individu ce qui est ressenti comme socialement valorisant par et pour chacun d'entre nous, en fonction des relations de reconnaissance et de valorisations réciproques, qu'il entretient avec les autres. Mais on peut définir plusieurs niveaux de valorisation possibles pour chacun d'entre nous lesquels fondent les jugements de valeurs que l'on peut porter ou dénier aux différentes activités professionnelles et/ou métiers.
1) Le premier niveau de valorisation est personnel, à savoir concerne les qualités morales particulières socialement valorisées, d'un individu considérées comme éthiquement supérieur aux autres au regard de ces qualités. Un individu peut apparaître comme plus intelligent, plus courageux, plus performant, plus volontaire, plus méritant aux service des autres que d'autres et donc se sentir honoré et valorisé dans ses activités et/ou son travail. Tout désir humain est en effet désir de reconnaissance de soi par la médiation des autres, au nom de valeurs partagées. L'amour ou l'estime de soi (fierté, honneur, dignité) sont les motivations les plus fortes de la psyché humaine, au point que l'humiliation vécue est la plus insupportable des expériences existentielles , au point de provoquer le désir paradoxalement valorisant de se détruire (suicide) et/ou de détruire les autres (violence passionnelle) , rendus responsables de cette dévalorisation. En cela tout travail peut être admis comme une valeur dès lors qu'il met les qualités propres d'un individu au service des autres. En effet tout travail suppose un courage personnel et un effort de coopération volontaire au bien-être général (société, entreprise), donc une maitrise plus ou moins sacrificielle de soi par laquelle il renonce ou diffère ses désirs spontanés propres (auto-discipline) pour le bien mutuel ou commun. La rémunération du travail ne serait dans ces conditions que l'expression de la reconnaissance par les autres du service rendu par l'usage altruiste que l'individu fait de ses qualités personnelles. Gagner sa vie par son travail serait alors non pas seulement une nécessité vitale mais d'abord le signe socialement objectif de la valeur personnelle des efforts et des talents que chaque travailleur met au services des autres. La rémunération monétaire reconnaît objectivement son mérite altruiste et la position sociale qu'il occupe au regard de ses qualités propres dans la hiérarchie socialement construite des mérites. Mais cette division socialement plus ou moins valorisée et valorisante du travail de chacun signifie aussi que les professions ne sont pas également reconnue comme méritante et donc que tous les travaux ne sont pas également des valeurs . Une activité ne vaut que par comparaison et les travaux les moins qualifiés seront donc méprisés au profit des travaux les plus qualifiants. Tout travail n'est pas une valeur dès lors qu'un grand nombre de professions renvoient à des activités inintelligentes, scotomisée, mécaniques ou routinières et donc lobotomisée (ce qui exige l'amputation d'une partie du cerveau) asservies à des normes ou objectifs imposés. Le travail d'un ouvrier à la chaine ou d'une caissière est sans grande valeur humaine, sauf à le détourner dans le cadre de positives relations au autres, au contraire de celui d'un artisan ou d'un paysan qui exige un savoir-faire complexe et une réflexion plus ou moins innovante dans le cadre de situations et de données environnementales jamais identiques.
Ainsi le travail industriel a largement vidé le travail en général de toute valeur intellectuelle ou spirituelle humaine en transformant les ouvriers et employés, même intellectuels, en simples opérateurs corvéables à merci..
C'est l'industrie des biens et des services soumis à la seule norme externe de la productivité, à savoir de la profitabilité et de rentabilité économique, qui a réellement disqualifié le travail humain et non une prétendue disposition à la paresse. C'est la division technique et sociale du travail en vue de la rentabilité économique et financière maximale pour le plus grand profit des détenteurs des capitaux et des propriétaires des biens de productions qui a généré la misère et la souffrance humaine au travail, jusqu'au suicide parfois, comme manifestations tangibles de sa déshumanisation .
2) Le deuxième niveau de la valorisation du travail, par delà, voire contre, sa finalité économique en terme de valeur ou de plus-value financière, pourrait résider le fait que le travail concernerait les valeurs républicaines (ou démocratiques) considérées comme universelles que sont la liberté, l'égalité et la solidarité. Or en tant que le travail du plus grand nombre des salariés ou employés est soumis à la logique capitaliste tournée vers l'appropriation privée du profit par les détenteurs de capitaux, le travail de la plupart est liberticide et inégalitaire en cela qu'il soumet chacun au despotisme du capital et détruit la solidarité sociale en soumettant chacun, comme vendeur de sa force de travail, sur le marché de l'emploi, à la concurrence avec les autres. Le travail devient donc une marchandise, à la disposition du capital et exige de chacun, pour pouvoir vivre de son salaire, de se vendre et de se soumettre au pouvoir non négociable d'une hiérarchie qui exerce sur lui un pouvoir qui échappe à son contrôle et dont la finalité n'est pas l'intérêt général ou public mais l'intérêt privé des actionnaires. C'est pourquoi le salarié est payé pour accepter la pouvoir de celui qui le paye en faisant de cette servitude une servitude apparemment volontaire régie par un contrat plus ou moins imposé par la nécessité extérieure de gagner les moyens de vivre et d'entretenir et de reproduire sa force de travail . C'est parce que le travail est du point de vue des valeurs éthiques fondamentales dégradant de et pour la personne, au contraire d'une activité de loisir, qu'il est rétribué, à titre de réparation, sous la forme d'un salaire. Si le travail n'était qu'un loisir dont les finalités internes serait celles, altruistes ou non, du travailleur salarié, il serait bénévole. C'est l'aliénation au travail qui seule lui confère une valeur économique !
C'est ainsi que celui qui prend du plaisir à travailler au sens où il réalise dans ses activités professionnelles ou son métier, ses capacités humaines de création originales, de recherche et de découvertes nouvelles, de développement de ses talents et qualités propres, mais aussi qui en fait l'expression de son désir de puissance sur lui-même et les autres peut confondre son travail avec un loisir au point de ne pas considérer sa rémunération comme la motivation principale de son activité. Il se trouve alors doublement récompensé : dans les finalités inhérentes de son travail pour lui-même et la jouissance narcissique qu'il lui procure et dans la reconnaissance extérieure de son talent qui ne joue plus qu'un rôle de confirmation objective et non pas seulement subjective, de sa valeur propre.
Mais peu de professions (die Beruf) peuvent être vécues comme des vocations, voire des missions (die Berufung), moralement valorisantes, dans le cadre capitaliste d'exploitation économique de la force de travail et de la domination hiérarchique, toujours despotique, qu'elle institue. Or certains semblent trouver dans leur travail, aussi aliéné soit-il, une satisfaction paradoxale dont on dit dans les cas extrêmes qu'elle relève d'un trouble ou d'une affection pathologiques appelés névrose du travail ou addiction au travail. Ils semblent avoir besoin d'être doublement aliénés pour se sentir sécurisés, à savoir préservés de l'angoisse de devoir décider du sens à donner à leur vie, aliénés ou dépossédés d'eux-même dans le cadre hiérarchique, les contraintes et les objectifs quantitatifs que leur impose leur activité professionnelle, aliénés quant au but externe de cette activité, gagner le plus possible d'argent en travaillant toujours plus pour consommer toujours plus, au risque de ne pas avoir le temps de profiter du temps libre pour développer des activités de loisirs, les seules en effet authentiquement libérales, car délivrées de la nécessité sociale et économique. Ce temps de loisir est, en effet, le seul temps pour soi et à donner gratuitement aux autres (bénévolat), il est le temps de l'amitié, de l'amour et de la tendresse qui est le seul temps créateur de la vie hors mode d'emploi imposé. Être aliéné au travail pour un décideur par exemple, c'est être aliéné au désir passionnel narcissique du pouvoir social qu'il confère sur les autres, jusqu'à le dépossession de sa personne au nom du personnage sinon prestigieux en tout cas dominant que lui impose la comédie de devoir, à tout moment, s'imposer et affirmer son autorité vis-à-vis de ses subordonnés et ou concurrents ; et cela aux dépens du désir d'aimer et d'être aimé pour lui-même. Posséder les autres, c'est être dépossédé de soi comme sujet/objet de l'amour réciproque des autres. L'amour possessif et dominateur des autres est un leurre, comme le bonheur ou l'amour de soi authentique dans la consommation ostentatoire. Ils ne rencontre que la soumission craintive et/ou la résistance, voire la haine jalouse des autres.
C'est dire que le travail n'est une valeur, au sens des valeurs
républicaines que sont la liberté, l'égalité et la solidarité vis-à-vis
des plus faibles , que lorsqu'il est libéré de la nécessité économique
dès lors que celle-ci s'inscrit dans la logique du profit financier
maximum, source permanente d'injustice, comme l'affirmait déjà Aristote .
Le capitalisme, dominé par la seule logique de la rentabilité
financière est amoral, voire immoral, car par nature aliénant et
servile. Si la logique marchande capitaliste du travail devient la norme
sociétale hégémonique , il transforme les individus eux-même en
marchandise et en marchands d'eux-même comme marchandise exploitable. Il
détruit tant les liens de la solidarité volontaire, que la condition
même de la liberté individuelle qu'est le loisir. Il est alors contraire
à tout lien social de coopération consenti, car il institue la lutte de
tous contre tous, la violence sinon physique du moins symbolique et
politique, l'égoïsme exclusif comme forme paradoxale (contradictoire) de
la sociabilité.
Il nous faut donc dévaloriser le travail pour valoriser les relations
humaines en tant que relations de solidarité volontaire (voir la
bénévolat) et contre la logique capitaliste de l'exploitation du
travail, mettre le temps de travail encore nécessaire au service du
temps de loisir et faire converger l'économie et le progrès technique
vers :
1) l'évolution du travail dans le sens d'un loisir parmi d'autres, c'est à dire dans le sens donc d'une activité fondée, comme chez l'artiste professionnel, sur le plaisir de la création, de la recherche, du développement et de la qualité éthique des relations humaines. Le travail deviendrait une activité à la fois nécessaire et ludique ou esthétique, mais reconnue par une rémunération publique et privée
2) .la réduction du temps de travail, pour ce qui concerne les métiers les moins créatifs et les plus contraignants de la personnalité des salariés ou employés. Cette évolution est déjà inéluctablement déjà inscrite dans les faits , de part les progrès des technologies intelligentes et de l'importance grandissante de l'usage de robots plus efficaces encore que le travail humain. Cela, comme depuis la fin, du XIXème siècle, doit favoriser le développement irréversible du temps pour soi (loisir, retraire) , seul temps de la vie libre, créatrice et aimante, donc pleinement humaine. En cela il est temps, contre la mystification idéologique instillée par prétendue valeur du travail, de faire comme Paul Lafargue, gendre de Marx « l'éloge de la paresse », c'est à dire du refus de travailler et d'être exploité dans l'essentiel de son temps de vie et donc de faire de ce refus, la condition du développement personnel et des capacités (capabilité selon A.Sen)
Conclusion : Tous ceux qui prétendent accorder une valeur morale ou républicaine au travail sans s'interroger sur les conditions sociales du travail comme mode de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme ne font que révéler leur mépris réel pour ceux qui travaillent . Tous ceux qui se gargarisent de la valeur du travail, en masquant le fait massif que le travail, les travailleurs et le chômage sont devenus les variables d'ajustement les plus importants pour maximiser les profits sont des mystificateurs politiques. Tous ceux qui font croire que le chômage massif a pour cause le fainéantise personnelle des chômeurs sont des menteurs publics cyniques. Valoriser le travail dans le système capitaliste, et non le considérer comme une condition ou un mal nécessaires, c'est exiger de renoncer aux valeurs humanistes pour ne considérer comme valeurs que les valeurs économiques et financières et faire de ces dernières les valeurs hégémoniques, en cela immorales, d'une société.
Je ne résiste pas au plaisir de terminer par une citation géniale du plus grand artiste contemporain mondialement connu et vivant en Anjou, François Morellet, auquel la musée d'Angers consacre une salle dont je vous recommande la visite : « On ne peut faire que deux métiers : artiste et dictateur. J'ai choisi le premier ! »
De la contradiction de toute pensée de droite
La pensée de doite prétend justifier les inégalités sociales au nom d'une inégalité naturelle intangible, en tant que celle-ci serait nécessaire à l'ordre public et donc à la paix civile.
Ce faisant elle tente de justifier l'ordre existant inégalitaire
en niant qu'il puisse être fondamentalement contradictoire et en
permanence menacé par ses contradictions internes. Elle est conduite par
là à faire de la répression policière la seule solution, violente, à
ces contradictions sociales déniées.
Mais elle reconnait par cette justification et la montée des moyens de
répression jusqu'au déni des droits humains pour lesquels elle milite :
1) que cet ordre est précisément fondé sur un désordre et que, pour le
figer, il lui faut impérativement faire recours au surréel divin afin
de faire croire aux dominés que cet ordre est bénéfique à tous, c'est à
dire à l'ordre public confondu avec l'ordre social existant. Les dominés
sont invités, voire contraints par la force dite publique, s'ils n'en
sont pas suffisament convaincus, d'accepter cet ordre inégalitaire au
nom de leur propre sécurité.
2) que le réalisme dont se réclame la pensée de droite est fondé en
sous main sur une vision surréelle ou métaphysique de la réalité qui
voit en elle un ordre transcendfant permanent inchangeable et naturel,
c'est à dire biologoque et/ou divin.
3) qu'elle est dans une contradiction performative, dès lors qu'elle
est obligée de mettre Dieu et/ou la nature immuable, comme justification
idéelle, au service de la domination réelle, sans pour autant croire
forcément elle même à l'existence réelle d'un Dieu créateur de la nature
et de son ordre, ce qui était le cas par exemple de Maurras.
Il suffit alors d’exhiber cette contradiction -dont l'histoire de
l'église catholique et du christianisme historique sont l'expression-
pour faire de cette justification irréelle du réalisme, ce qu'elle est :
une mystification idéologique au service d'une domination
fondamentalement injustifiable. C'est pourquoi cette mystification de la
permanence des inégalités naturelles au nom de Dieu est en
permanence auto-démentie par la réalité historique, y compris des
religions.
Le libéralisme économique se charge du reste de ruiner cette vision
inégalitaire de la pensée de droite au nom de l'égalité idéalement
supposée des acteurs économiques.
Cette dernière contre-vérité neutralise la vision de droite. Ce qui fait que le pseudo-libéralisme économique inégalitaire ne sait toujours pas à quel saint se vouer
Les conditions théoriques de l’acceptation du mariage homosexuel
Contrairement à tous ceux qui font de leur croyance dans la dimension sacrée et identitaire du mariage et de la parentalité un argument probant contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité et prétendent l'imposer par le droit aux autres, la question de l'acceptabilité politique de cet élargissement du droit est, selon un point de vue rationnel et laïque, subordonné aux conditions théoriques et idéologiques suivantes :
-
Que l'on refuse de faire de la tradition, religieuse ou non, le fondement du droit
-
Que l'on refuse de faire de la nature biologique le fondement de la différence des droits fondamentaux, dont celui d'éduquer des enfants entre les hommes et les femmes, et donc que la différence biologique ou psychique ne justifient en rien une inégalité des droits.
-
Que l'on considère la dite homosexualité n'existe pas sur le plan psychique, sinon comme une norme sociale (et donc révisable) fondée sur une prétendue nature sexuelle, car, en réalité, chacun ne peut être psychiquement qu'hétérosexuel dès lors que l'on admet qu'aucun désir sexuel d'un individu n'est identique à celui d'un autre.
-
Que l'on admette que la différence biologique des sexes n'impose pas une différence sexuelle des rôles, sinon, jusqu'à maintenant, pour porter l'enfant avant la naissance. Or porter un enfant en fait n'implique pas nécessairement en droit que cet enfant ne doive être élevé que par sa mère biologique.
-
Que l'on considère que deux parents du même sexe biologique peuvent jouer vis-à-vis de l'enfant des rôles différents, sauf à prendre illusoirement un critère biologique comme une norme sociale ou morale.. Ce qui est déjà le cas pour nombre d'enfants élevés par des homosexuels sans que l'on puisse faire de différences avec des couples dits hétérosexuels quant à leur évolution psychique, sexuelle et sociale future.
-
Que l'on admette comme scientifiquement prouvé que les enfants se sexualisent dans la société et leur expérience sociale et relationnelle propre et non en fonction du seul modèle de la famille traditionnelle (du reste en évolution rapide) et donc que ce n'est pas la famille qui détermine et encore moinns décide et doit décider de la vie sexuelle et affective des enfants.
-
Que l'on fasse de la liberté sexuelle de chacun, hors les crimes et agressions sexuels, une liberté fondamentale
-
Que l'on reconnaisse que l'acceptation de l'homoparentalité est à mettre en cohérence logique avec celle de la mono-parentalité et de la pluri-parentalité déjà effectives en droit. Un droit n'est légitime que s'il est fondé sur l'égalité des droits fondamentaux quelles que soient les différences sexuelles, ce qui doit être nécessairement le cas dès lors qu'on ne fait plus de la dite homosexualité une faute ou une maladie justifiant un handicap social ou sociétal..
Il convient donc de s'opposer, avec des argument rationnels et au nom de la laïcité du droit, aux pseudo-arguments de tous ceux qui veulent différencier sur un plan biologique, traditionnel et/ou religieux les droits, en termes d'inégalité des droits, les homosexuels et les hétérosexuels. Il faut, au contraire, par le droit, s'efforcer de promouvoir l'évolution nécessaire de la société pour accroitre la tolérance sociétale vis-à-vis des différences sexuelles, dans le sens de l'exigence de l'égalité des droits humains. En cela, comme en ce qui concerne la peine de mort et l'autorité parentale, le droit libéral doit avoir pour ambition de modifier les faits cristallisés ou verrouillés par le poids archaïque de traditions irrationnelles et injustes...
De la sainte Trinité diabolique de l’économie capitaliste
Le discours de l'idéologie capitaliste dominante nous présente la croissance comme la panacée qui résoudrait tous les problèmes de la société : le chômage, les inégalités, voire les discriminations et les exclusions de toutes formes, en particulier la xénophobie, et les excès du besoin se protéger contre ces maux par une politique sécuritaire qui menace les fondements de la démocratie. Cette notion de croissance est indissociable de celles d'emploi et de compétitivité, lesquelles sont, à la réflexion, très ambiguës et donc pernicieuses
Il se pourrait en effet que cette présentation idéologique de la croissance fasse de ce prétendu remède une des causes des maladies qu'elle prétend traiter. Croissance, emploi et compétitivité peuvent apparaître comme trois idoles passe-partout dont l'évidence même empêche d'en percevoir l'aspect socialement et humainement délétère. Ces trois notions dont on nous bassine jusqu'à l'écœurement tendent à nous persuader, en effet, qu'il nous est interdit de faire la critique de la logique du profit capitaliste auxquelles elles contribuent et à présenter cette critique comme illégitime.. Il convient donc de remettre en question ces notions non seulement en elles-même mais dans leur indissociation pour détecter les effets négatifs, voire délétères, dont le crise actuelle, financière, économique et écologique, mais plus encore sociale et culturelle, ne fait que manifester le danger politique.
La croissance, dans cette idéologie, est un terme technique qui désigne exclusivement l'évolution comptable agrégée dite positive du produit intérieur brut d'un pays (PIB). Or cette croissance met au positif aussi bien les profits spéculatifs que les coûts convertis en profits pour les entreprises spécialisées des accidents de la route, des maladies, les destructions écologiques que produit cette croissance que l'on s'efforce de compenser par des correctifs marchands rentables. Ce qui est logiquement contradictoire. Cette notion est donc tout à la fois irrationnelle et trompeuse en cela qu'elle fait de la question de la croissance une mesure purement quantitative en oubliant celle, qualitative, qui désigne le progrès dans les relations de reconnaissance mutuelle et de coopération que chacun, pour bien vivre, cherche à entretenir avec son entourage écologique et humain. Une telle notion comptable de la croissance fait du profit et de la consommation privées la seule mesure du bien-être, aux dépens de la justice, de l'amitié et de la solidarité entre individus, considérés comme des être sensibles animés par le désir d'aimer et de s'aimer par et dans des relations mutuelles positives ou gagnant/gagnant, aux autres.
|
|
Cette croissance capitaliste en terme de profit micro et macro économique, ne peut « progresser » que si elle fait de la perte de l'emploi, la menace principale pour la survie de ceux, les plus nombreux, qui n'ont que leur force de travail à vendre sur le marché de l'emploi. Employer veut dire ployer sous la domination d'un système nécessairement inégalitaire et des autres humains qui profitent de ce système. Employer implique donc soumettre, en terme d'exploitation de la force de travail des employés, à la volonté de puissance, confondu avec leur désir d'enrichissement, des employeurs que sont au bout du compte les investisseurs capitalistes, c'est à dire soumettre le travail à la logique de profit privé du capital. Ainsi le fameux marché de l'emploi, comme tout marché, met, face aux employeurs, chacun en concurrence avec tous les autres employés dans l'acceptation à la fois contrainte et consentie (via le contrat volontaire de travail de cette domination. Ce qui fait que le salarié n'est pas un esclave vient de cette contrainte consentie, de l'intériorisation de cette contrainte par l'employé, sous la forme d'une engagement volontaire, sous la condition d'une rémunération permettant de consommer ce qui apparaît à tord ou à raison, comme un besoin individuelle indispensable pour mener une vie sociale et symbolique vécue comme décente. Accéder au marché par le crédit qui le ligote est donc la seule manière pour un employé d se faire reconnaître socialement en tant que consommateur pou compenser son aliénation en tant que producteur.
L'emploi, c'est à dire le coût du travail, dans ces conditions, est le premier, car le plus rapide financièrement, facteur de la dite compétitivité qui ferait par exemple que la France serait dépassée par l'Allemagne en terme de compétition industrielle internationale. Il faudrait donc pour maintenir l'emploi réduire son coût et retrouver une compétitivité par rapport à l'Allemagne, voire au pays émergeant à salaires très faibles. Mais on oublie de dire que cette réduction du coût du travail réduit mécaniquement celle de la consommation, comme on le voit précisément sur la marché intérieur en Allemagne. Ce pays est dépourvu de SMIG laissant aux branches le soin de négocier librement les salaires, ce qui profite aux salariés de la grande industrie parce qu'ils sont bien défendus par leurs syndicats co-dirigeants des entreprises et dont les salaires sont supérieurs aux salaires français.
Par contre -et ceci explique cela- cela se fait aux dépens des services dans lesquels les salaires sont plus faibles qu'en France car les salariés ne bénéficient pas de la même protection syndicale en terme d'accord de branche. Ce dont profite, en terme de coûts, l'industrie exportatrice ainsi que du bas coût des salaires dans les pays industriels « satellites » de l'Allemagne en Europe hors zone euro. En Allemagne le coût du quasi-plein emploi est dans le nombre plus élevé de travailleurs pauvres de mini job à 400€ et autre Job à 1€...Ainsi l'Allemagne sacrifie son marché intérieur au marché extérieur et c' est en partie le prix à payer pour obtenir une compétitivité « supérieure » ou moins méritée dans le domaine de l'automobile « made in Germanie » dont l'image relève plus du mythe que de la réalité et dans les machines outils très spécialisées, en effet, pour le moment, supérieures à celles produites ailleurs.
Plus grave encore : la compétitivité en général est fondée par définition sur un jeu gagnant/perdant, mais un tel jeu, dans un marché interdépendant, prépare les conditions de son autodestruction : quand le perdant ne peut plus acheter au gagnant , ou quand celui-là devient aussi performant à son tour, celui-ci voit sa croissance mécaniquement faiblir. Un tel déséquilibre ne peut fonctionner qu'à court terme mais il condamne à terme le gagnant : Nul ne peut être indéfiniment plus compétitif d'au autre sans détruire, à terme, la possibilité même de la compétition.
L'absurdité de la croissance illimitée qui est la condition de survie du capitalisme trouve sa double expression dans la menace écologique, épuisement des ressources et pollution des éléments naturels de la vie, et dans le développement de la dette publique et privée non remboursable qui est le carburant indispensable de son dynamisme, dès lors que cette croissance a pour condition la consommation, le chômage et la précarité d'employés sous payés afin d'optimiser les profits privés des investisseurs. Or cette dette implique le crédit, à savoir de faire crédit et donc la confiance devenue impossible en un système en crise systémique évidente. Comme le disait Marx la crise actuelle du capitalisme n'est autre que la conséquence de la contradiction entre les rapports de production fondés sur l'exploitation du travail salarié et de développement des forces productives qui impliquent que cette croissance serve au bien-être de tous.
C'est dire que l'idéologie capitaliste dominante de la croissance par la compétitivité pense mal, car elle ne se pense pas et qu'elle l'empêche de se penser dans ses contradictions internes. En cela elle n'est qu'une idéologie au service du profit, mais de moins en moins crédible pour ceux et celles, majoritaires, qui sont victimes de ce dernier. Elle ne peut plus faire illusion et les lendemains du capitalisme cynique redevenu à l'état sauvage sur le plan mondial déchantent de jour en jour inexorablement.. Mais gare aux réactions populistes, catastrophiques, régressives et haineuses de cette désillusion.
Sortir de l’affaire Cahuzac par le haut
L'hystérie collective qu'orchestre habilement pour faire l'audience une partie des médias à propos de l'affaire Cahuzac mérite que l'on s'interroge sur ses symptômes et ses causes réelles ou imaginaires.
Il est deux manières de traiter cette affaire :
- Soit on peut faire de Cahuzac un bouc émissaire et une arbre qui cache la forêt pour dédouaner le cours normal des choses et masquer la collusion entre la puissance économique et la pouvoir politique qui est au cœur de la défiance des électeurs vis-à-vis de la démocratie réelle.
- Soit on peut faire de cette affaire un révélateur de ce cours quasi-normal de corruption de la démocratie en système capitaliste pour en changer les conditions de possibilité et de contrôle.
On a tôt fait, dans une certaine presse, de faire de Cahuzac le révélateur de la corruption des responsables politiques de gauche ou de droite dans leur ensemble par un amalgame contraire à au principe du droit libéral de la responsabilité individuelle, sans se demander en quoi tous serait responsables du délit spectaculaire d'un seul. Il va, en effet, de soi pour ces faiseurs d'opinion, que tous les membres de l'exécutif, à commencer par le président de la république aurait dû connaître la faute de Cahuzac et par conséquent ont, soit été victimes de la incompétence en cas de non-savoir, soit ils en étaient informée et ont donc essayé de la couvrir en connaissance de cause pour s'en faire les complices.
Ces deux hypothèses au fond ne sont qu'un argument cosmétique au service de la deuxième alternative du savoir collectif : le savoir absolu de nos dirigeants est de droit puisqu'ils ont le pouvoir suprême. Ils ne peuvent pas ne pas savoir ce que font ses membres et donc sont forcément coupables de les avoir coopter ou nommer à leur poste, à commencer par ce monarque électif de droit divin, sécularisé par la Vème république, qu'est le président de la république.
Or la république implique la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire et donc interdit à un membre du pouvoir, fusse-t-il président de la république, de juger, au lieu et place d'un procès fondé sur des preuves avérées par la procédure elle-même, de la culpabilité d'un individu, fusse-t-il ministre. Selon ce principe, l'inculpation judiciaire d'un responsable politique peut seule, hors une faute politique avérée dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, mettre fin à un mandat ou à une responsabilité politique.
Sur ce plan, rien ne peut être reproché à François Hollande. Quelle qu'ait son intime conviction, elle ne pouvait valoir d'inculpation judiciaire. Par la séparation des pouvoirs qu'impose le droit libéral il ne pouvait condamner politiquement Cahuzac et donc le démissionner pour un faute personnelle qui ne fait pas l'objet d 'une inculpation et encore moins le condamner politiquement hors toute procédure judiciaire. Cela ne veut pas dire que les médias n'auraient pas le droit d'investiguer le cas en question pour faire de la cible de leur enquête un coupable hypothétique, au contraire, car cela est nécessaire au fonctionnement équilibré de la justice face au risque de protection qu'exercerait le pouvoir exécutif sur ces membres et/ou exécutants.
François Hollande, dès lors que l'inculpation judiciaire était prononcée, n'a pas tenté comme dans d'autres cas nombreux semblables avant lui, de faire que Cahuzac y échappe. Il n'a en aucune manière fait obstacle ou entravé la marche de la justice. Il a donc agi comme il le devait en demandant à celui-ci de démissionner de son poste dès lors qu'il était inculpé.
Mais il doit faire plus encore, comme il vient de s'y engager. Derrière le cas Cahuzac se pose le problème politique général de la corruption de la politique par le pouvoir financier, lequel problème est inhérent à toute démocratie représentative sur fond d'économie capitaliste de marché et a été au centre de son discours du Bourget et de l'engagement politique pour lequel il a été élu. C'est sur cette promesse de combattre la corruption de la démocratie par le pouvoir financier ainsi que l'évasion fiscale qu'il faudra juger le président de la république et des ministres et non pas sur ce qu'il croyait savoir ou ne pas savoir de la faute personnelle à signification éminemment politique de son ministre du budget, dès lors que celle-ci et d'autres ne sont pas encore juridiquement soupçonnées et a fortiori avérées.
Le mensonge de Cahuzac ne fait pas de ceux qui ont pût y croire de bonne foi des complices. Ce qui en ferait des complices, ce serait que les responsables politiques de tous les niveaux, qu'ils aient crû ou non à ce mensonge, ne répondent pas politiquement par une régulation appropriée de la finance qui commence par s'attaquer en vue de les éradiquer aux paradis fiscaux et par un contrôle efficace de l'évasion fiscale à la signification politique délétère pour la démocratie de ces faits de corruption et d'évasion fiscale.
En cela la faute Cahuzac ne doit être traitée comme un arbre solitaire sur lequel on s'acharne médiatiquement pour cacher la forêt, mais comme une occasion opportune de traiter la question politique de fond des relations pour le moins perverses quand elles deviennent fusionnelles entre le pouvoir politique et celui de l'économie.
Familles homos, Fourest contre Mariton : 1-0
Dans un débat qui opposait, hier soir, sur LCP Caroline Fourest et Hervé Mariton celle-là l'a emporté par un coup direct imparable qui a conduit au chaos de son adversaire. A la question de celle-ci : « les familles homosexuelles existantes sont-elles pour vous des familles » le député UMP a répondu « Non, ce ne sont que des circonstances ».
Le débat très agressif n'a sans doute pas permis à Caroline Fourest de poursuivre plus avant, elle s'est contentée d'opposer une fin de non-recevoir à ce mépris pour le droit de ces enfants de voir reconnaître leur seule famille réelle ; sans doute lui apparaissait-il suffisant d'avoir démasqué l'hypocrisie de son adversaire qui, pour s'opposer au dit mariage pour tous, invoque en permanence le droit et l'intérêt des enfants. Mais il n'est pas interdit de réfléchir plus avant au delà ce débat, techniquement très confus, voire inaudible, à la signification de cette réponse de Mariton.
De deux choses l'une en effet :
-
Soit les couples homosexuels ne forment pas une vraie famille avec les enfants qu'ils élèvent et éduquent et cette circonstance , comme le soutient explicitement par son argument le député, est malheureuse pour les enfants, dès lors ces enfants sont sans famille et partant en danger grave,. Ce qui est une condition suffisante pour que l'état, comme il en a le devoir, les leur enlève de cette fausse et donc mauvaise famille pour les confier à une vraie et donc toujours bonne famille hétérosexuelle.
-
Soit ils ne forment pas une circonstance suffisamment malheureuse pour les enfants pour les placer ailleurs, mais une circonstance meilleure ou moins mauvaise que celle qui obligerait l'état à les confier à une autre famille, mais alors cela oblige de reconnaître cette famille comme seule responsable de l'éducation de ces enfants et partant de lui reconnaître les même droits et les même devoirs qu'aux autre famille hétérosexuelles ou monoparentales.
Or nous voyons qu'Hervé Mariton ne veut pas et/ou ne peut pas et/ou n'ose pas choisir entre les deux alternatives, ce qui le conduit, au nom de l'intérêt supérieur des enfants, à accepter qu'ils soient confiés, sans pourtant reconnaître aux homosexuel(le)s les droits et les devoirs de vrais parents et d'une vraie famille, à de pseudo-parents homosexuels dont il estime a priori et hors toute preuve qu'ils ne peuvent pas, par principe, être de bons parents.
C'est par cette inconséquence que ce député UMP fait paraître, malgré ses dénégations, son propos pour qu'il est : un propos méprisant les homosexuels en tant que parents de droit, mais sans aller pourtant jusqu'à leur dénier la possibilité de l'être en fait, dès lors qu'il n'exige pas que l'état les confie à une autre vraie et bonne, selon lui, famille. Ce faisant, par sa réponse méprisante, il s'est pris les pieds dans son tapis argumentaire et il a laissé retomber sur lui une pierre qu'il a lui-même, soulevée.
Merci à Caroline Fourest de nous avoir, par sa question aussi incisive que décisive, éclairé sur les dits et non dits des adversaires mous ou « républicains » de mariage pour tous, qui par leur inconséquence, ne peuvent faire que provoquer, à côté d'eux, le déchainement de l'homophobie radicale anti-républicaine.
Liens pour (re)voir l'émission :
http://www.agoravox.tv/actualites/p...
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde-le-debat/vod/146231-le-mariage-pour-tous
Vers une politique de centre-gauche en Allemagne ?
Toute la presse française (et allemande) parle du « Triomphe » de Madame Merkel, réélue, comme nul(le) autre en Europe depuis la crise, pour la troisième fois, avec une majorité relative renforcée. Il n y a aucun doute : son habileté politique est exceptionnelle en particulier pour éliminer, sous un faux air maternel, ses meilleurs amis ou alliés qui pourraient lui faire concurrence ou gêner sa politique, comme on vient de le voir dans le cas du FDP (parti ultra-libéral sur le plan économique, mais « progressiste » sur le plan sociétal) éliminé du parlement, et dont elle avait fait en parole son allié privilégié pour ensuite ordonner à ses troupes de ne pas voter pour lui lors du deuxième scrutin concernant le vote proportionnel.
Il faut rappeler en effet que chaque citoyen a, en Allemagne, deux voix à exprimer lors des élections parlementaires : une voix pour un candidat à élire à la majorité et une voix pour une liste de parti à élire à la proportionnelle. Cette double élection permet à chaque citoyen de panacher son vote par exemple de voter pour la liste d'un parti (ex : FDP), mais aussi de voter pour un candidat d'un autre parti(ex : CDU). Or Madame Merkel, contrairement aux dernières élections législatives et dernièrement à celles du Lander de Basse-Saxe (ce qui avait permis aux sociaux-démocrates et aux verts de gagner cette élection) a demandé expressément et publiquement aux membres de son parti (CDU) et à ses sympathisants de ne plus voter pour le FDP. Le score exceptionnel de son élection exprime donc logiquement la glissement des voix du vote à la proportionnelle d'électeurs qui avait l'habitude de voter à ce scrutin pour le FDP pour provoquer un coalition CDU-CSU-FDP. Il faut donc comprendre que triomphe de Madame Merkel est la conséquence d'une défaite annoncée de la FDP par Madame Merkel en personne. Cette défaite a donc été provoquée par elle pour mettre fin, sans le dire mais en le faisant, à la coalition antérieure et rendre ainsi possible une nouvelle coalition plus au centre- gauche de l'échiquier politique. Quelles sont les raisons qui l'ont conduite à opérer une telle manœuvre, laquelle est en grande partie à l'origine de son succès ?
La première raison est qu'elle a été pendant 4 ans paralysée par sa collision avec les deux partis alliés plus à droite, mais moins adroits, qu'elle, le FDP et La CSU bavaroise, sur les questions familiales et sur celle du SMIG et des retraites. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu gouverner à sa mesure pendant la dernière législature, toujours empêchée de prendre des décisions dans le domaines social et sociétal. La seule décision qu'elle a imposée a été est l'abandon du nucléaire en accord avec les verts !
La deuxième raison, plus profonde, est qu'elle sait, car elle l'a appris par l'expérience de ses législatures précédentes, que l'Allemagne est un pays à la fois social-démocrate et fédéral dans son fonctionnement. La codécision syndicat-patronat dans les grandes entreprises et les négociations rituelles obligatoires dans toutes les branche, ainsi que le besoin de protection sociale, elle qui vient de l'est, de la majorité des allemands font que l'Allemagne ne peut pas se permettre une politique ultra-libérale, sauf à briser le consensus social qui fait une grande partie force du soi-disant modèle allemand dans le domaine industriel. Enfin le fédéralisme impose un consensus pour la plupart des toutes décisions à caractère social entre les lander, c'est à dire le Bundesrat et le parlement fédéral (le Bundestag). La question de la social-démocratie en Allemagne n'est donc pas seulement politique, dont l'enjeu serait de savoir quel parti doit gouverner le pays, mais (car) elle s'inscrit dans les structures sociales allemandes elles-même let es rapports idéologiques qu'elles génèrent, profondément sociaux-démocrate . Ainsi les électeurs allemands ont voulu par leur vote imposer une grande coalition à la chancelière d'abord en élisant un Bundesrat, issu des élections dans différents lander, gauchisant afin de limiter le pouvoir d'une majorité CDU-CSU/FDP au parlement fédéral .trop à droite et qui plus est, impuissante à gouverner du fait des bisbilles incessantes entre les alliès de droite de la précédente législature.
La troisième raison est donc que si madame Merkel et son parti sont de centre-droit, ils ne sont pas de droite comme peut l'être par exemple l'UMP dans sa majorité en France. Son parti reste dans la majorité de ses membres et militants un grand parti populaire inspiré par le « socialisme chrétien » et les églises qui se réclament de lui, y compris l'église catholique en Allemagne dont le pape François, après l'église luthérienne, se fait aujourd'hui un défenseur explicite(« je n'ai jamais été de droite ». S'ils ne sont pas de droite ou ultra-libéral sur le plan économique, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être en tant que grand parti populaire de gouvernement en Allemagne (si tant qu'ils puissent l'être en France).
Pour toutes ces bonnes raisons madame Merkel a eu raison de renverser la table afin de retrouver une majorité de centre gauche plus conforme à ses vœux mais surtout à ceux de la grande majorité des allemands comme l'ont montré toutes les élections locales et les sondages précédant les dernières élections . Son triomphe lui impose d'imposer sa propre voie, avec l'appui des membres et responsables gauchisants de son propre parti (ex : Madame von der Leyne, ex ministre du travail ), à savoir de composer avec le SPD et les verts pour gouverner en cette période de crise et de déchirement de la société allemande dont il fait rappeler qu'elle compteplus de 3 Millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ainsi Madame Merkel, et elle l'a sans doute voulu, n'a plus de majorité à droite pour gouverner ni au parlement fédéral (Bundestag), ni au sénat et dans les régions (Bundesrat). Or, ne l'oublions pas, le régime allemand n'est pas présidentiel, mais parlementaire, (ce qui sans cesse rappelé par la cour constitutionnelle allemande), elle a dorénavant toute légitimité de gouverner au centre-gauche.
Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour François Hollande et son gouvernement de centre-gauche.
Article envoyé de Hildesheim (Basse-Saxe, Allemagne)